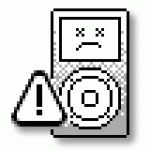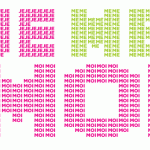Autour de son nombril.
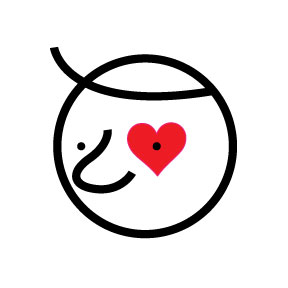 Autour de son nombril, y a ce gars qui se meure tout seul à l’hôpital, sans le sou et sans famille.
Autour de son nombril, y a ce gars qui se meure tout seul à l’hôpital, sans le sou et sans famille.
Autour de son nombril, y a ce garçon qui étudie le ventre vide.
Autour de son nombril, y a cette fille qui vient de se faire jeter aussi bas que son estime d’elle-même.
Autour de son nombril, y a cet immigrant fraîchement arrivé, à la recherche de nouvelles balises.
Autour de son nombril, y a des gens qui vivent des détresses intérieures.
Autour de son nombril, il existe un monde.
Et ce monde a souvent besoin.
Il faut seulement se donner la peine de voir.
De voir plus loin que son nombril.
Et d’agir.
Surtout.
Comme cette femme qui sur Facebook a préparé une petite collecte pour louer une télé pour ce gars seul à l’hôpital.
Comme cette enseignante qui glisse discrètement une enveloppe anonyme dans le casier de cet étudiant affamé.
Comme cette femme qui a recueilli cette fille sous son toit.
Comme cette famille qui aide ce nouvel arrivant à se faire une vie en le traitant comme un des leurs.
Comme ce gars qui décide de prendre des nouvelles d’amis qui en ont besoin.
Ça prend quelquefois qu’un coup de fil.
Ça prend quelquefois qu’une couple de piasses.
Ça prend quelquefois qu’une couple de minutes.
Ça prend seulement un peu de coeur.
Cet organe tout en haut du nombril.
Billets que vous pourriez aimer
Éphémère.
 Je fais dans l’immédiat.
Je fais dans l’immédiat.
Mon métier est de répondre aujourd’hui à des besoins d’hier. Je crée des publicités, des dépliants ou des affiches commandés pour solliciter, informer ou instruire, mais pas pour survivre à leur mandat premier.
La plupart des ces créations disparaitront avec le temps. Elles deviendront rapidement désuètes selon l’urgence de la demande.
Contrairement aux oeuvres d’artistes, ces pièces ne survivront pas aux modes, aux tendances ou seront incompatibles aux nouveaux médias. Y aura même de ces médias qui disparaitront apportant avec eux dans leurs sillons, toutes ces publicités adaptées uniquement pour eux. Qui se rappelle d’UBI, cette créature de Vidéotron. Plusieurs de mes créations dorment ainsi dans la mémoire morte de ces vieilles technologies. Tout comme ces sites web créés au tout début et issus d’une vieille programmation qui sont enfouis dans des disques de sauvegarde, des disquettes ou des cédéroms, qui eux-même s’empoussièrent dans des caisses empilées dans des placards obscurs.
Je fais dans le présent.
Mes slogans sont collés sur ce que vivent les gens, aujourd’hui. Pas demain. Avec les mots d’aujourd’hui. Avec les maux d’aujourd’hui. Des textes composés à partir d’une réalité directe. Ce que j’écris à l’instant présent a de grandes chances d’être inapproprié demain. Pas que nous changions nous-mêmes si rapidement, mais ce qui nous entoure, oui. Les arguments que j’utilise pour vous persuader d’acheter un produit ou de souscrire à un service seront caducs le temps de les écrire. J’exagère? Je vous ai vendu des disques durs de grandes capacités de 100 megs, des cassettes VHS haute définition et des modems ultrarapides de 56k. Je vous ai menti par procuration. Un innocent message qui, avec le temps, se révèle être un pieux mensonge.
Je fais des pubs qui seront vues, lus qu’une fois et puis bye bye. Terminé. Fini. Pour des mandats qui ne reviendront pas. Tu as un machin à vendre, tu fais de la pub, tu le vends, et tu n’as plus besoin de pub. Simple.
Vous n’avez pas vu cette annonce? Dommage. Elle était bien. Vous avez manqué un événement qui ne se reproduira plus jamais. Pouf. Disparu. Fallait être là.
Je fais dans l’instant. Pas après. Juste là. Là. Après, c’est trop tard.
Quand un client me demande de lui créer un concept qui passera le temps, je veux bien. Ce n’est pas par mauvaise volonté, mais je suis incapable d’anticiper le futur. Ce que les gens aimeront et auront besoin dans un horizon de cinq ans. Pas capable.
Quand j’étais à l’université, à la fin des années 80, je passais mes après-midi dans les centres de photocopies à agrandir des logos ou faire des collages pour mes travaux en design graphique. Quand j’avais fini mes devoirs, j’allais tenter de rejoindre des amis, dans un bar quelconque, sans savoir s’ils y seraient. Et quand je tombais sur eux, je prenais de leurs nouvelles directement. Aujourd’hui, mes travaux seraient conçus sur un ordinateur, je texterais mes amis pour leur donner un rendez-vous et devant eux, je passerais mon temps à continuer de texter aux autres. Vous croyez vraiment qu’un concept créé y à peine cinq ou dix ans tiendrait la route pour rejoindre deux clientèles tellement différentes? No way.
Quand j’aperçois encore de vieilles créations réalisées depuis plusieurs années, encore en circulation, je ressens souvent un malaise. J’y vois le travail du temps. La fatigue. Le manque de punch. J’aurais le goût de les retaper, histoire de les rafraîchir. De les dépoussiérer. Je me demande pourquoi le client a laissé glisser en abandonnant celle-ci au lieu de l’avoir amélioré quand c’était encore le temps.
Je me demande pourquoi il n’a pas pensé me rappeler pour le faire.
Peut-être suis-je tout aussi éphémère que mes créations.
Billets que vous pourriez aimer
Partir pour partager.
 Ça fait maintenant dix jours que Salvien a quitté le Cameroun pour venir au Saguenay.
Ça fait maintenant dix jours que Salvien a quitté le Cameroun pour venir au Saguenay.
Il a laissé derrière lui sa mère, sa soeur et ses jeunes frères, ainsi que tous ses amis. Même sa fiancée, qu’il fréquentait depuis quatre ans, est restée à Douala, la capitale économique de cette république africaine.
La température de son corps est passée de +30 à -30 degrés Celsius. J’imagine que son coeur aussi.
Vous vous imaginez ce que représente partir de chez vous sans savoir si un jour, vous y remettrez les pieds? Non, vous n’imaginez pas.
Et ce, en laissant derrière vous tous ceux que vous aimez. En laissant derrière vous votre ancienne vie.
Hier, quand Salvien est venu souper à la maison, ses yeux quittaient la table quelques instants. Son corps était avec nous, mais son esprit traversait les océans.
– Tu es fatigué? On parle trop vite avec notre accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
– Pas du tout. Je vous comprends très bien…
On a parlé de chez eux. On a parlé de chez nous. On a échangé sur nos vies si différentes. Surtout de la sienne.
Depuis son arrivée, tout est nouveau. Le froid, la neige, la bouffe. Cette vitesse auquel nous vivons, cette froideur que certains dégagent, tout est nouveau.
J’ai beaucoup d’estime pour ces immigrants qui laissent leur pays pour venir étudier, habiter, et tenter de se faire une place bien à eux, ici. Leur courage m’émeut. Leur détermination aussi. Mais avant tout, ce sont leur notion de partage qui me fascine le plus. Salvien, comme d’autres que j’ai rencontrés, se sent privilégié d’avoir la possibilité de venir ici. Et du coup, il travaillera fort pour arriver à faire étudier sa soeur, et puis ses frères. Parce que c’est comme ça. Sa mère en lui donnant tout ce qu’elle possédait, a misé sur son fils pour qu’il réussisse à s’accomplir sous de meilleurs cieux, mais il devra aussi passer au suivant. Le partage est ce qui m’a le plus marqué quand j’ai foulé le sol africain. On partage, même si on a peu. Ici, on garde tout, même si on a beaucoup.
Ce schème de la responsabilité, je l’ai senti aussi chez Mike Lee. Ce restaurateur de Jonquière, d’origine chinoise, avec qui j’ai eu le privilège de prendre une couple de verres de saké lors d’une activité sociale. Tout jeune, Mike cousait pour aider sa mère, dans ce petit appartement familial de Montréal. Le maigre salaire qu’elle ramenait à la maison ne lui permettant pas de nourrir ou vêtir la marmaille, alors, le soir elle devait accumuler les petits boulots. C’est le plus vieux, Mike qui, malgré ses 10 ans, aidait maman dans ses journées interminables. Mike a travaillé et travaille encore beaucoup. Pour sa famille. Et sa famille élargie. Parce que c’est ainsi que ça se passe.
Pas d’apitoiement. Pas de lamentation. Du retroussage de manches. Du crachat dans les mains et on capitalise.
Quand je rencontre des Salvien, des Laetitia, des Khady, des Mike, ça me passionne. Ça me sort du quotidien et surtout du laxisme que certains de mes concitoyens dégagent, le nez collé sur leurs petites réalités à gémir sans cesse. Ce sentiment que rien n’est gagné d’avance, qu’il faut travailler pour arriver à ses fins. Qu’il faut faire des sacrifices et ne pas attendre que tout tombe du ciel, par enchantement. Ce sentiment-là je le trouve souvent chez ces gens qui n’ont pas une vie facile, mais qui apprécie chaque moment de celle-ci.
L’obésité nord-américaine ne se vit pas seulement au niveau de la bedaine.
Lève-toi et bouge, dirait mon ami Pierre Lavoie.
Photo @ Dreamstime
Billets que vous pourriez aimer
Le rêve est une seconde vie.
 Cindy est décédée mercredi. Le lendemain de Noël. Elle avait 26 ans.
Cindy est décédée mercredi. Le lendemain de Noël. Elle avait 26 ans.
Elle était atteinte de la fibrose kystique. Maladie génétique qui touche les voies respiratoires et digestives entraînant un épaississement du mucus sécrété dans les bronches, les sinus, l’intestin, le pancréas, le foie et le système reproducteur.
J’ai rencontré Cindy, il y une dizaine d’années, lorsque j’ai réalisé le film «Le rêve est une seconde vie». Un documentaire commandé par CORAMH (un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine des maladies héréditaires au Saguenay-Lac-St-Jean), ce film avait pour but de démontrer le quotidien des personnes atteintes de telles maladies. Des malades ou des parents d’enfants atteints s’étaient livrés sans pudeur à notre petite équipe, répondant généreusement à toutes nos questions, même celles pas toujours faciles portant sur leurs intimités.
– Ton rêve, ça serait quoi, Cindy?
Celui d’avoir des enfants.
Elle avait répondu de sa petite voix enrouée, comme si elle était à bout de souffle, cet état si caractéristique des personnes atteintes de la fibrose kystique. Assise dans son lit d’hôpital, en plein gavage, elle nous avait raconté les aléas de sa maladie. Le nombre incalculable de médicaments à prendre, ses visites impromptues et régulières à l’hôpital comme le jour de notre rencontre, le claping qu’elle devait s’imposer pour libérer ses poumons embarrassés. Elle nous avait aussi parlé de son chum qui la supportait tellement, qui lui remontait le moral dans ses moments de découragements.
Elle était toute menue, si frêle, dans ce grand lit immaculé. Fragile, certes, mais en même temps, si résiliente pour son jeune âge. Je me souviens de l’avoir entendu dire qu’elle se trouvait plaintive (!), qu’elle n’avait souvent pas la force de se battre. Je n’en revenais pas. Son quotidien était rempli de règles à suivre, de barrières, de médicaments à prendre, de deuils à réaliser. Et elle, du haut son minuscule corps malade, elle avait cette certitude qu’elle pouvait être plus forte.
Ce sentiment, toutes les personnes croisées pendant le tournage me l’ont partagé. Alors que je m’attendais à interviewer des gens abattus, sans espoir, j’ai plutôt rencontré des gens d’une force incroyable, luttant contre leurs corps, leurs peurs et une société pas toujours adaptée pour eux.
Quand Anne, la directrice de CORAMH à l’époque, m’avait approché pour la réalisation de ce documentaire, j’avais menti sur mon expérience dans un tel mandat. Mises à part ces quelques réalisations de publicités, je n’avais jamais produit un tel document. Mais je voulais le faire. Égoïstement, je savais que ce film changerait ma perception par rapport à la maladie et surtout me ferait rencontrer des gens incroyables. Je ne m’étais pas trompé.
Vingt heures d’entrevues pour une demi-heure de film. Écoutées des vingtaines de fois afin de ne rien manquer et de rendre du mieux que je pouvais ces rencontres inoubliables. Ces heures à réécouter des confidences, à revoir ces larmes apparaître au bord des yeux, de voir ses poings se refermer sur des colères non assouvies. Des heures à comprendre que l’humain est fort quand on l’attaque, qu’il est capable de vivre l’invivable. Cette volonté de se battre, de ne pas laisser le destin avoir le dessus.
Aujourd’hui c’est aux proches de Cindy de se battre. Leur combat commence. Celui de tenter d’oublier, de se ressasser les bons moments, de reprendre le cours de leur vie en conservant les meilleurs souvenirs pour les moments les plus difficiles. Survivre à la perte d’un être cher, c’est se retrouver en face de soi-même.
Cindy n’aura pas réussi à réaliser son rêve.
Le rêve est une seconde vie avait dit Gérard de Nerval.
Souhaitons à Cindy que cette seconde vie soit encore plus belle que dans ses rêves.
> Pour faire un don à Fibrose Kystique Canada
Billets que vous pourriez aimer
Bonne fête, maman.
 – Va falloir que vous accouchiez ici, madame!
– Va falloir que vous accouchiez ici, madame!
– Pas question!
Ma mère a serré les jambes du mieux qu’elle pouvait. Me privant ainsi d’une sortie plus rapide que prévue.
Je n’allais pas naître dans une ambulance. Ho non. Thérèse était trop fière pour ça. Pas question d’ouvrir les cuisses devant ces deux ambulanciers. On devait se rendre à l’Hôpital de Chicoutimi, coûte que coûte. Aucun compromis possible.
Tu vas attendre ton tour, mon petit bonhomme, accroche-toi, maman veut pas.
Quand le médecin, appelé au milieu de la nuit par mon père, nous a accueillis à l’hôpital, en soulevant sa robe de chambre, il a précipité ma mère en salle d’accouchement. J’allais naître quelques minutes après.
On allait passer Noël ensemble, tous les deux. Papa et Monique fêtaient chez grand-maman avec le reste de la famille, alors que toi, dans ta chambre d’hôpital et moi, à la pouponnière, on allait commencer à se connaître entre deux biberons.
Cette histoire, je t’ai entendu me la raconter à toutes mes fêtes. Une histoire sans fin dont je ne me lasse jamais. Le début d’une belle histoire. Une histoire d’amour.
Il avait dû encore neiger, à l’aube de cette journée de fin d’année. En cet avant-veille de Noël. J’imagine que la rue Petit devait être embourbée sous la neige. Cette petite ruelle, coincée entre la majestueuse Église Christ-Roi et les miteux Entrepôts Joron, à quelques pas du pont Sainte-Anne. Une petite rue quelconque du «Bronx» de Chicoutimi, en plein coeur d’un quartier défavorisé du centre-ville, où le parfum des voitures se mélangeait à celui de la friture du casse-croûte Joachim.
J’arrivais dans ce minuscule logement au coeur de cette minuscule famille où j’allais compléter le quatuor standard des années 60. Deux parents, une petite fille et un petit gars. La fille avec les traits de son père et le garçon avec les traits de sa mère.
Je te ressemble tellement, maman. Et pas seulement du visage.
Nous partageons cette même sensibilité qui nous fait verser une larme facilement, comme nous partageons tout autant cette force qui nous a permis de passer à travers un paquet d’épreuves. On attribue, à tort, une trop grande émotivité à de la faiblesse. Nous sommes le contraire des durs aux coeurs tendres : notre première couche de sensibilité cache un noyau solide comme le roc qui fait de nous des exemples de résilience capable d’avaler l’impossible. Fragile à l’extérieur. Fort à l’intérieur.
Nous sommes des «toughts», maman. Même si ça paraît pas. Nous, on le sait.
Et de la force, Thérèse, il t’en a fallu une somme considérable quand tu m’as laissé quitter la maison pour la grande ville, alors que j’avais à peine 18 ans. Après avoir déjà perdu un enfant, plusieurs parents auraient agi autrement. Mais toi, tu as réussi à faire abstraction de ta peine et de tes peurs pour me permettre de prendre mon envol. Tu savais que j’étouffais, que j’avais cette soif de liberté à l’intérieur de moi, tu le sentais. Tu m’as laissé la prendre, au lieu de me retenir. Et tu l’a fait même si ça te brisait le coeur. Sans aucun reproche, sans que je me sente coupable de le faire.
En t’oubliant, tu m’as laissé toute la place. Tu m’as laissé me définir tout seul. Tu m’as laissé devenir moi.
Quand, dans d’autres circonstances, j’ai dû, moi aussi, me résilier à me séparer de mes enfants, de faire mon deuil de les perdre, c’est chez toi que je suis allé pleurer. C’est toi qui m’a appris qu’on ne perd pas les gens qu’on aime parce qu’ils ne sont pas présents physiquement avec nous. Qu’on n’a pas à vivre le quotidien et la routine pour avoir des relations solides. Qu’il faut tout simplement être là, au bon moment quand le besoin se fait sentir.
Comme avec toi. Tu as toujours été là.
Tu dois bien te douter que je braille quand je te raconte tout ça. Comme tu dois brailler en me lisant.
Mais nous ne sommes pas que des braillards. Ho que non. Nos fous-rires et cette façon de faire de l’ironie sur les travers de la vie, c’est un truc qu’on a dans le sang, toi et moi. On pleure tout autant qu’on rit. À grands éclats. Parce que la vie, ce n’est jamais tout noir, ni tout à fait blanc. Parce qu’il faut se botter le cul. Qu’il faut l’aimer la vie… « et l’aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants » chantait Renaud.
Aujourd’hui j’ai décidé de renouveler une vieille tradition que mon parrain Jean-Roch, ton frère, avait initiée avec votre mère, y a une quarantaine d’années. Celle d’envoyer des fleurs, le jour de son propre anniversaire, à celle à qui il devait la vie. Pour la remercier simplement d’avoir toujours été là. D’avoir fait les sacrifices. D’avoir fait ce qu’il faut.
Aujourd’hui, je suis bien conscient que je te dois ce que je suis devenu.
Ma fête, c’est aussi la tienne.
À Noël, on se retrouvera encore tous les deux, comme y a près de cinquante ans.
Papa et Monique avec grand-maman et quelques membres de la famille, là-haut. Alors que toi, entre deux drinks, tu me raconteras comment j’étais mignon à l’hôpital avec ma couronne de cheveux blonds et ses rires qu’on avait déjà commencé à se partager.
x x x
Billets que vous pourriez aimer
Sans technique, le talent n’est rien qu’une sale manie*
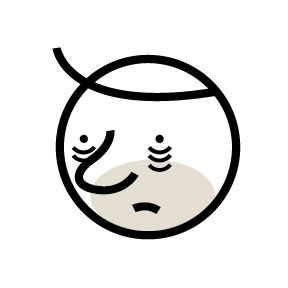
Si vous voulez m’insulter, dites-moi que j’ai du talent.
Et si vous voulez m’abattre pour de bon, dites-le-moi après une semaine de 80 heures.
Dans tous les métiers où la créativité est au coeur du processus de réalisation, la notion de talent apparaît comme une solution magique. L’équation talent = réussite n’est jamais remise en question. On oublie que derrière ce talent, il y a beaucoup d’heures de travail, de pratique et d’acharnement. Que derrière la figure magnifique d’une athlète de patinage artistique, y a des chutes et des rechutes et des blessures. Inspiration vs transpiration. Le talent, c’est bien, le travail, c’est mieux.
Un talent sans travail, c’est une terre fertile qu’on ne sème pas.
À 10 ans, j’avais un talent fou d’illustrateur que je n’ai pas entretenu; aujourd’hui, je dessine, certes, mais si je me compare à mes vieux potes qui aujourd’hui en ont fait leur métier, je ne suis pas là. Pendant qu’ils passaient des heures à pratiquer, la face collée sur une feuille vierge, moi je perdais mon temps à autres choses, en les regardant me dépasser. Par manque d’ambition? Peut-être. Par paresse? Sûrement. Quand je regarde les réalisations de ces amis, jamais je ne me dis qu’ils avaient plus de talent que moi, j’envie plutôt la hargne et les efforts qu’ils ont dû déployer pour arriver où ils sont aujourd’hui et je n’ai personne à plaindre que moi-même. J’ai encore souvent beaucoup de mal me donner des coups de pied au cul pour avancer. J’ai le côté cigale développé…
Aujourd’hui, je gagne très bien ma vie. Mais pour y arriver, je travaille très fort. Je ne me plains pas. Travailler fort étant relatif, je ne fais rien de physique. Bien qu’à notre époque, on se blesse plus souvent à la tête. À l’intérieur de celle-ci. Les cicatrices sont moins visibles, mais plus dommageables.
Trop souvent, dans les métiers de la création, on place le talent à l’avant-plan. Tout près du concept de l’inspiration.
Haaa, l’inspiration. Si j’avais à choisir le mythe véhiculé le plus récurant dans mon domaine, c’est bien celui de l’inspiration ou de la pensée magique.
Les clients imaginent que nous attendons toute la journée que descende une petite flamme du ciel et que celle-ci nous révèle l’idée recherchée. Padam!
C’est rarement comme ça.
Pour une idée trouvée facilement, vous en avez une vingtaine d’autres qui vous compactent le cerveau autant qu’un jab de Georges St-Pierre. Une idée, ça se travaille. Ça se force. C’est un accouchement; vous me direz que certains prennent peu de temps, mais la grande majorité se font dans les douleurs et des délais de fous.
Prenez ce blogue, vous croyez qu’il s’écrit tout seul? Sur le coup de l’inspiration. J’ai une cinquantaine de textes commencés qui ne seront jamais publiés et lus, des textes cachés sous le radar de Google, des textes qui à moins que j’y mette les efforts nécessaires pour les rendre intéressants, se perdront dans la cache de mon ordinateur. Parce que je n’ai pas le temps d’ajuster ma pensée, de trouver les bons mots.
Le chanteur Nick Cave écrivait que « l’inspiration est un mot utilisé par les gens qui ne font pas grand-chose. Je vais dans mon bureau chaque jour et y travaille. Que cela me tente ou pas. » Je pense comme lui et que c’est comme ça que ce font les choses. Tu as un mandat à livrer, une idée à trouver, force-toi le cul, pis avance. Griffonne, écrit, provoque les choses. Regarder le mur, en espérant que l’idée arrive toute seule c’est attendre la foudre pour se faire un feu. Prends ton silex et gosse une roche. Crée tes propres étincelles.
Parler uniquement de talent pour justifier une idée géniale, c’est diminuer la sueur derrière l’effort. Qu’on a aucun mérite parce qu’on a du talent. Et c’est tout faux.
* Le titre vient d’une chanson de Georges Brassens, « Le Mauvais Sujet Repenti », dans laquelle le chanteur donne des trucs à une prostituée. Le parallèle est intéressant pour un gars qui travaille dans la pub…
Billets que vous pourriez aimer
Cons-brioleurs.
 Dans le dernier mois, je me suis fait voler deux fois.
Dans le dernier mois, je me suis fait voler deux fois.
À deux reprises, des individus sans scrupules se sont emparés de biens qui ne leur appartenaient pas en me dérobant sans gêne.
Je ne tomberai pas dans les détails. Je ne vous raconterai pas qui ou quoi ni comment. Ce n’est pas le but de mon commentaire et ce n’est pas important. Ce n’est pas une chronique de faits divers, ni un billet qui se voudrait à caractère vengeur.
Ce texte est uniquement une réflexion sur les impacts de tels gestes sur mon quotidien et les répercussions de ceux-ci sur mes valeurs.
Car s’il y a un côté négatif outre celui de se voir chaparder ses avoirs, c’est bien celui de se sentir violé, d’une certaine façon. Pas dans le terme le plus usuel du mot; je ne voudrais pas ici minimiser ce geste abominable en le comparant à un vol de pacotilles, mais dans son sens le plus large, celui de se voir envahi et trahi par un ou des individus.
Et c’est là, selon moi, le grand malheur du vol.
Celui de perdre ce lien de confiance en l’autre. Celui qui nous pousse à accentuer la garde. À devenir suspicieux et craintif et ainsi refermer ses frontières personnelles en vue de se protéger.
J’ai eu l’opportunité de voyager dans pas mal de places dans le monde. Rarement dans des environnements aseptisés. J’ai réussi à me fondre dans des populations dont je ne baragouinais que quelques mots appris pour me débrouiller. J’ai rarement eu peur. J’ai toujours le sentiment (peut-être utopique!) que le monde est majoritairement bon. Que les cancres, voleurs et malfrats sont avant tout l’exception. Que la violence peut se développer n’importe où – chez son voisin, dans un quartier huppé, comme dans un quartier pauvre d’un pays perdu. Les statistiques me démentiraient peut-être, mais mon expérience de vie et de voyageur jusqu’à maintenant, me fait croire le contraire. C’est pourquoi, chez moi comme ailleurs dans le monde, je tente d’aborder les personnes que je rencontre la première fois en leur donnant le bénéfice du doute. Comme si je leur disais «Tu pars à zéro, alors ne me déçois pas ». J’avoue que ce n’est pas toujours facile. Certains ont le don de montrer une image d’eux-mêmes qui ne donne pas le goût de vérifier si la première impression est la bonne, mais je tente de donner la chance au coureur.
Alors quand on est bafoué par un geste aussi malveillant que le vol, on cesse de faire confiance à autrui en devenant suspicieux et c’est dans l’humanité en général qu’on perd confiance. On fait payer d’honnêtes gens pour le crime de voyous, comme on se prive de rencontrer des gens parce que d’autres nous ont trahis ou blessés. De la même manière que dans une relation de couple, où la nouvelle flamme paie pour les erreurs commises par la précédente. Comme dans une punition de groupe où tout le monde subit pour l’erreur du petit con. On peut faire le même parallèle avec toutes ces histoires de corruption: au-delà des fonds détournés à des fins frauduleuses, c’est la perte de nos illusions par rapport à nos institutions politiques qui me fait le plus de peine. Quand on marque au fer rouge tous les politiciens et qu’on devienne cynique par rapport à toutes leurs décisions.
Quand on ne fait plus confiance qu’à sa garde rapprochée, on se prive de rencontrer des personnes qui pourraient changer notre vie positivement. On ne peut être ouvert et fermé à la fois.
Pour en finir avec ces deux malheureux événements, ce qui me fait doublement chier c’est que je me considère avant tout comme un type de nature généreux. Ma porte est toujours ouverte aux amis, je fais des dons, je m’implique et je gâte les gens que j’aime. Je suis toujours prêt à rendre service. À m’oublier pour les autres. Et comme je suis de moins en moins matérialiste avec le temps, les trucs qu’on m’a dérobés, je les aurais peut-être offerts à mes voleurs s’ils m’avaient convaincu qu’ils étaient indispensables à leur vie. Qui sait.
Mais ils en ont décidé autrement.
Dommage.
Dommage pour eux.
Dommage pour moi.
Dommage pour tout le monde.
« Pour toutes ces raisons vois-tu, je te pardonne
Sans arrière-pensée après mûr examen
Ce que tu m’as volé, mon vieux, je te le donne
Ça pouvait pas tomber en de meilleures main »
– Georges Brassens
Billets que vous pourriez aimer
Suivre son étoile.
 C’est drôle la vie.
C’est drôle la vie.
Parfois, le destin te fait des clins d’oeil que tu ne remarques pas toujours. Et puis, tout à coup, au moment où tu ne t’y attends pas, bing! ça te revient. Un léger déclic dans ta tête qui réveille ton disque dur.
À la suite de la publication de mon précédent billet, j’ai reçu un courriel avec en pièce jointe, une photo. Il venait de ma cousine Annie. La photo: une roche que sa tante Jeannine avait peinte sur le bord du fleuve aux Escoumins, sur la Côte-Nord, il y a plusieurs années. Sur celle-ci, elle avait peint: CHOISIR ET SUIVRE SON ÉTOILE. « La roche à tante Jeannine, ce n’est pas n’importe quelle roche. C’est une roche porteuse de rêves. » qu’Annie a ajouté à la fin de son jolie petit mot.
Les souvenirs que j’ai de Jeanine et des Escoumins sont bien placés quelque part dans ma mémoire. Les pêches miraculeuses de morues dès l’aube, les goélands qui nous courtisaient, nos cueillettes d’étoiles de mer à marée basse quand l’eau glaciale du fleuve St-Laurent s’infiltrait dans nos bottes à tuyau trop courtes. Je me souviens de Jeanine ou de sa soeur Judith, cassant un oursin pour nous faire goûter nos premiers sushis, qu’on crachait subtilement aussitôt qu’elles avaient le dos tourné.
En me rappelant ces petits moments de l’enfance, cette mignone synchronicité m’a fait sourire. Je trouvais ça chouette que la phrase que j’avais choisie pour signer les pubs de l’Équipe étoile entrepreneuriale du Saguenay—Lac-Saint-Jean, « toi aussi, suis ton étoile » avait déjà été utilisée par Jeannine, des années auparavant.
Une belle coïncidence. Toute simple.
Simple?
Je le pensais aussi, jusqu’à ce que je regarde la photo que j’avais sélectionnée pour illustrer ce billet : une vielle photo de moi, en train de peindre des roches. En regardant de plus près celle-ci, j’ai réalisé que cette photo avait été prise aux Escoumins, dans le chalet de… Jeannine. Sur le cliché, on voit dans le reflet du miroir, mon père en train de me photographier et dans son dos, Jeanine qui regarde la scène. Cool, non?
Je ne suis pas superstitieux, je suis du genre sceptique, mais ce genre de coïncidences me fait sourire.
Ça me plait de penser que la vie n’est pas une ligne droite et que de petites histoires banales te marquent sans que tu t’en rendes compte. Que ce soit par des gens que tu as croisés, des événements que tu as vécus, même si ce ne sont que des actes sans prétention. Des gestes semés sur ton chemin qui t’ont dirigé comme des panneaux de signalisation, te faisant subtilement modifier ton trajet.
Faut surtout pas forcer le destin, mais le laisser nous guider comme le vent dans une voile sur un navire, tout près des Escoumins.
Billets que vous pourriez aimer
Entrepreneurs de bonne heure.
 « Jeune, je dessinais partout et inventais des histoires pour faire rire mes amis. Aujourd’hui, mes logos sont affichés partout dans le monde et mes slogans font vendre… » — Marc Gauthier, designer graphique — Traitdemarc™.
« Jeune, je dessinais partout et inventais des histoires pour faire rire mes amis. Aujourd’hui, mes logos sont affichés partout dans le monde et mes slogans font vendre… » — Marc Gauthier, designer graphique — Traitdemarc™.
En me servant de ma propre expérience, c’est le concept que j’ai présenté au comité des communications de l’Équipe étoile entrepreneuriale du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Un beau projet qui met de l’avant sept super personnalités-entrepreneurs qui rencontreront des centaines de jeunes de la région afin de les sensibiliser en les initiant au domaine des affaires en se basant sur leurs propres expériences.
Selon moi, un entrepreneur est avant tout une personne comme tout le monde, sauf qu’à la différence des autres, celui-ci a décidé de suivre son étoile. Tout jeune, il a su persévérer, recommencer, avancer en mettant son talent et sa détermination à profit. On dit souvent que le labeur porte fruit, mais il peut être avant tout synonyme de bonheur. Et ce, depuis toujours. Plus il commence jeune à s’y intéresser, plus les chances de réussir sont bonnes. Un entrepreneur de bonne heure est un entreteneur de bonheur.
Avec ce concept, mon but premier était de démontrer aux jeunes qui rêvent d’entreprendre que tout peut mener aux « affaires ». Que l’administration et la comptabilité peuvent être des domaines qui te laissent indifférent comme tu peux être rêveur, brouillon, sportif ou artiste et quand même avoir le gène entrepreneurial en toi. Il n’y a surtout pas un chemin unique, une seule voie qui mène au succès. Une seule branche à l’école pour y parvenir. Chacun peut y accéder s’il y croit vraiment. Qu’il est possible que ce soit ton acharnement à apprendre le piano ou les heures à pratiquer des figures sur la glace qui font de toi une personne qui fera son bout de chemin dans la vie. Que tes qualités qui tu réussiras à développer tout jeune, te suivront et ne pourront que s’améliorer avec le temps.
À partir de documents d’archives personnels (photos, vidéos), les membres de l’Équipe Étoile nous dévoilent donc comment ils étaient tout jeune, comment ils ont su évoluer dans le temps en mettant de l’avant leurs talents, leurs forces et leurs persévérances. La notion entrepreneuriale peut être difficile à assimiler pour un plus jeune. Mais il peut reconnaître, parmi les Étoiles, ceux avec qui ils partagent des passions, et ce même si celles-ci ont été vécues à des époques différentes. Ce qui rend l’expérience encore plus ludique. Un jeune sportif se reconnaîtra quand il réalisera qu’un entrepreneur qui a réussi, pratiquait le même sport que lui très jeune. Un autre, plus axé sur le domaine des arts saura faire le pont entre ses passions et celles d’un mentor plus âgé surtout s’il partage les mêmes. Au contraire de présenter les entrepreneurs comme des gens « hors de l’ordinaire », des superhéros inaccessibles, j’ai préféré les présenter tels qu’ils étaient en tant qu’un ti-cul d’une douzaine d’années, bien avant de devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. Comme dans la notion du plus petit dénominateur commun, se comparer aux mêmes âges est plus juste que le faire avec trop d’écart.
Les sept membres de l’Équipe ont dû fouiller dans leurs vieilles photos afin de dénicher celles qui les représentaient le mieux à différentes étapes de leur vie. Comme j’avais fait la démarche personnellement avant eux, je me suis rendu compte que bien que nous changeons physiquement, nous demeurons ce que nous étions tout petits. C’est fascinant de voir qu’on a pas beaucoup changé de personnalité, que nos petits jeux de l’époque nous menaient lentement à ce que nous sommes devenus, aujourd’hui. Comme si toutes ces années nous auraient préparés à éclore, en accumulant chaque jour un peu plus de maturité.
Comme disait l’auteur Alexandre Jardin, dans son livre magnifique Le Petit Sauvage : « On ne se doit qu’à l’enfant qu’on a été ».
> L’Équipe étoile entrepreneuriale du Saguenay—Lac-Saint-Jean sur le web et sur Facebook
Billets que vous pourriez aimer
iDull.
 Je n’aime pas vos idoles.
Je n’aime pas vos idoles.
En fait, je n’aime pas vos idoles pour les mêmes raisons qui vous les font aimer.
Avec qui ils couchent, ce qu’ils bouffent, où ils vont en voyage, ce qu’ils pensent des conflits internationaux, je n’en ai rien à foutre.
Prenez ce sportif récemment déchu que je ne nommerai pas. On l’a hissé au rang de dieu, parce qu’APRÈS son cancer, il a gagné un grand prix cycliste. Je ne diminue pas qu’il ait été malade, vous voyez, mais ce n’est pas son cancer des couilles qui m’a impressionné, mais plutôt ces mêmes couilles qu’il lui ont servi pour a grimper les côtes à plus de 50 km/h. Dopé? Ouais. Je n’en ai rien à foutre non plus. Faut être aveugle, pour penser qu’il était le seul.
Prenez ce chanteur populaire qui a changé de nom à quelques reprises. Je peux aimer l’artiste, triper sur son sens musical ou le qualifier de génie; je peux admirer sa façon de se réinventer, de tout reprendre du début au lieu de répéter les mêmes recettes, son art et sa créativité peuvent me fasciner, mais ça s’arrêtera là. Qu’il soit con comme un balai en entrevue, qu’il lance baliverne par dessus baliverne quand on le questionne, ça me laisse de glace. Parce que je n’en ai rien à foutre de ce qu’il peut penser de la vie. Rien à foutre. J’aime le musicien, le chanteur, l’artiste, mais sinon, niet. L’homme et la femme qu’ils peuvent être ne m’intéressent pas. Ces opinions me sont sans intérêt. Qu’il milite pour la survie des hérons en zone de déboisement ou de la libération de prisonniers politiques ne rende pas sa musique meilleure à mes oreilles.
Les revues à potins pullulent de conseils, de trucs, de théories à la noix sur nos «grandes vedettes». Comme si le talent d’acteur ou de chanteur venait toujours avec celui de la pertinence et de l’intelligence. Comme si leurs opinions étaient aussi bonnes que le sont leurs chansons. Hey. Wake up. Je m’en fous de ta recette de tartare de bœuf tout autant que tes livres préférés, si j’apprécie ton art c’est parce que tes textes, tes airs sont venus me chercher. Pas parce que tu élèves cinq chiens et que tu vis sur une terre dans le Nord gaspésien.
Je ne comprends pas pourquoi, ça vous intéresse autant. Vraiment pas. Pourquoi chercher à connaître leurs opinions sur des trucs dont ils n’ont pas de connaissances plus que vous. Leur statut de vedette vous impressionne à ce point? Ce statut leur donne obligatoirement un VIP d’intelligence et de pertinence?
Si je veux une opinion scientifique sur un truc, je préfère la recevoir d’une personne qui s’y connaît dans le domaine.
Bien que je n’aime pas les idoles, ce que j’aime encore moins c’est la façon dont vous vous les crucifiez sur la place publique quand ils agissent d’une manière que vous considérez mal. Ça me rend mal à l’aise. Parce qu’il faut se le dire, vous aimez tout autant les châtier que les aimer. Proportionnellement, je dirais. Plus vous avez aimé et plus vous les haïssez. Vous vous vengez? Vous pétez votre coche parce que vous vous considérez floué? Vous aviez tellement mis d’amour et d’espoir en eux qu’ils vous ont déçus? Ha bon.
Je lisais récemment que les scientifiques n’avaient pas la cote du public. Qu’on se méfie des chercheurs. Qu’on a des doutes sur la rigueur des journalistes. Mais quand vient le temps de s’interroger sur des questions qui nous interpellent, on aime bien avoir l’avis d’une personnalité. De l’idole de service. Toujours prêt à donner son opinion. À prendre la parole.
Ça doit expliquer pourquoi les talk-shows m’emmerdent.