Chroniques malaysiennes 06 – People

– Je me demandais, y’a des conflits entre les gens par rapport à ce que tu me racontais hier?
Brandon à pris le temps de prendre une puff de sa cigarette pour me répondre que non.
Non. Les musulmans sont privilégiés par rapport à l’achat de terrains, de possession d’immeubles, mais Brandon qui ne l’est pas, me dit que c’est correct comme ça. Et que la plupart des gens pensent comme lui.
Brandon est chinois et c’est le gérant du petit hôtel où j’ai débarqué à Kuching. On avait jasé pas mal la veille de mon départ pendant que je prenais une bière et lui fumait une cigarette, on a parlé d’un paquet de trucs et on a continué le lendemain puisqu’il s’était offert de nous accompagner un peu partout à Kuching en cette dernière journée.
On a en profité pour jaser chacun de nos quotidiens. À la fois si différents, mais tout autant tellement semblables.
Prenons par exemple, le cas des premières nations. Les natifs, comme on les appelle ici. Dans l’état du Sarawak, on dénombre pas moins de six ethnies qui habitaient l’île de Bornéo avant la colonisation. Brandon pense que ces groupes ont fait une erreur en acceptant de l’argent et des maisons pour pallier à leurs héritages ancestraux. Qu’au lieu de ça, ils auraient pu s’éduquer et en profiter pour se développer eux-même.
– Same thing in Canada, Brandon. And in a lot of countries where i have been.
Brandon a sourit.
Voilà l’essence même du voyage.
Découvrir. Apprendre. Échanger.
Si vous visitez uniquement des lieux, vous manquez l’essentiel du voyage.
De toute façon, les lieux sont souvent mieux dans les livres. Les photos y sont toujours meilleures que les vôtres. Vous pouvez y aller aussi directement sur Google Map. Zoomer. Tourner à gauche. À droite. Regarder cet immeuble, cliquer dessus et lire tout ce qui le concerne sur Wikipedia.
Je sais pas.
Pour moi, c’est pas voyager.
Il vous manque l’essentiel.
Ceux qui habitent ces lieux.
Comment ils vivent. Qu’est-ce qu’il mangent. Ils font quoi comme travail.
Ils sont pour la plupart, comme vous. Avec ou sans famille. Une blonde ou pas. Divorcé. Sans travail. Trop de travail. Monoparental. Les côtoyer vous fait réfléchir à votre propre existence. Votre vie. Sans jouer le jeu des comparaisons, il faut savoir relativiser pour éviter des conclusions biaisées par rapport à ses propres expériences. Apprendre sans juger, quoi.
Voyager c’est ça.
Sentir le parfum du durian, ce fruit emblématique de la Malaisie. Ce fruit qu’on dit qu’il ne faut pas se fier à son odeur dégoûtante, si prononcée qu’il est interdit dans avoir en sa possession dans les transports en commun et dans les hôtels. Mais faut surtout y goûter. Je l’ai fait. Ça goûte la marde. En fait, c’est pire que le sentir, car la texture est pareille à du vomi de bébé. Mais fait y goûter. Pour le savoir.
Les odeurs de voyage m’enivrent.
Celle des caniveaux secs qui vous remontent dans le nez quand vous marchez sur un grillage d’égout. Celles du street food. Barbecue improvisé au coin d’une rue. Toutes ces étales dans les marchés publics où ces poissons vous regardent sans que vous sachiez leurs noms. Il faut aussi y goûter. Passer par dessus le dégoût et foncer. Parlez au pêcheur, il vous passionnera.
Plus des trois quart de mes repas en Malaisie ont été pris dans la rue. Assis tout croche sur une table bancale, à commander des trucs sans savoir c’était quoi. À demander au serveur, vous, vous mangeriez quoi. A me tromper rarement. À bouffer des trucs dont je vais m’ennuyer pendant l’année qui vient.
Et tous ces gens autour qu’il faut découvrir.
J’ai parlé avec des Polonais, des Italiens, des Français, des Allemands, des Chinois, etc. Name it. On fait le tour du globe rapidement quand on parle aux gens autour de soi. On appelle ça : voyager en double.
Si c’est dépaysant? Pas à peu près.
Épeurant? Bof. Je sais pas.
Je pars du principe que les gens ont de bonnes intentions dans la plupart des cas. À moins de jouer les matamores dans des quartiers malfamés dans le milieu de la nuit, je pense que les gens sont bons. Et en t’adressant à eux de cette façon, tu viens de mettre la table à une relation saine. Si tu débarques avec ton attitude sauvage de touriste avec du cash qui veut être reconnu et adulé comme un conquistador, tu donnes un ton négatif à une relation naissante. Qui veut tisser des liens avec un trou de cul?
Voyager c’est aussi apprendre à se connaître.
À se découvrir soi-même.
Voyager, c’est thérapeutique.
Et malheureusement, ça a une fin.
Jusqu’au prochain.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques malaysiennes 05 – Cher colonel
Cher Colonel Sanders,
je t’écris cette lettre en sachant très bien que tu es enterré (on t’a même peut-être panné, qui sait…) quelque part dans l’état du Kentucky. Tout jeune, je t’ai vu à Chicoutimi, tu étais venu inaugurer un nouveau resto Poulet Frit à la Kentucky. C’était ton nom à l’époque. Avant de te cacher sous les lettres PFK. Ou KFC, partout ailleurs dans le monde. Je me souviens, tu étais débarqué à bord d’une longue limousine blanche. Tu ressemblais à deux gouttes d’eau à la tirelire à ton effigie que j’avais dans ma chambre.
Quand je pense à toi, j’ai de beaux souvenir en tête. Ces longues files en avant de ton resto, le jour de la fête des mères. Ces midis entre amis, quand j’étais au secondaire, pour pallier quand on nous servait de la bouette à la cafétéria de l’école. Et aussi, cette odeur que ton resto dégageait au début du quartier où mes parent avaient finalement acheté une maison.
De beaux souvenirs.
J’en ai aussi de moins bons.
Ce sentiment qu’après avoir ingurgité ta merde pannée, j’ai le goût de m’acheter un nouveau foie en Inde sur Ebay. La certitude que tu es responsable d’une grande partie de l’obésité morbide de tout un continent. Mais celle qui me frappe encore plus depuis que je suis en Malaisie : mais qu’est-ce que tu fais dans ce pays?
Ici, tu es partout. Partout.
Dans tous les aéroports, les centres-villes, les centres d’achats. Partout. Je ne t’ai pas croisé sur les Îles, mais je suis certain que tes emballages flottent quelque part sur la mer de Chine.
Tu fais quoi ici, bordel?
Tu es ici au confluent de trois grandes cultures gastronomiques: celles de l’Inde, de la Chine et de la Malaisie. On est à mille lieux de ta salade fluorescente, ta sauce brune douteuse et tes épices de merde qui camouflent uniquement le goût du gras de ton poulet.
Sors un peu de ton paradis de la graisse et suis-moi. Je te fais un tour guidé des alternatives culinaires de ce beau pays.
Pour commencer, pour déjeuner, tu pourrais essayer un Nasi Lemak. Ici tout le monde bouffe ça. Un riz cuit dans du lait de coco, aromatisé de piments, d’anchois frits, d’un œuf cuit dur et d’arachides. Enveloppé dans une feuille de bananier, tu as l’impression de recevoir un cadeau. Le prix? Ridicule. Et c’est vraiment bon. Et très nourrissant. Si tu es plus du type pain, vas-y pour le Roti Canai, une crêpe qui ressemble un peu à du pain naan indien. Un pain de farine avec du beurre ghee, cuit sur la plaque et servi avec un curry. Plus gras un petit peu, à peine, mais vraiment bon.
Si tu vas manger sur Jalan Olor à Kuala Lumpur, c’est facile à trouver – y a un de tes restos avec ta grosse face, juste à côté – tu te trouveras en plein cœur des hawkers de KL. Ici, tu auras l’embarras du choix. Tu pourras manger des palourdes au sambal olek, qui te font suer jusque dans le fond de la gorge. Si tu veux pas te salir les mains, tu peux préférer manger de la raie, avec la même sauce. Tu la détacheras doucement à la baguette et tu tempèreras le piment en mangeant du riz parfumé. C’est bon…. Surtout si tu manges la peau. Oui oui, comme ton poulet.
À Penang, tu pourrais profiter des pêcheurs qui débarquent soir et matin et opter pour manger des coquilles. Cuites à la vapeur rapidement avec rien d’autre, pas de sauce, rien. Elles sont crissement difficiles à ouvrir, je te l’accorde, mais quand tu réussis, c’est le bonheur. Ça goûte la mer, le sel, le frais. Si tu es du type plus aventurier, un colonel ça doit l’être, vas-y pour les bigots. Ces gros escargots cuits dans une sauce épaisse. Quand tu vas en commander tu les vois bouger, se gluer l’un sur l’autre, et 5 minutes après, ils sont dans ton assiette. Avec ta baguette, tu les pousses au complet dans ta bouche pour lécher la sauce, ensuite comme elle est propre, tu coince la coquille sur tes lèvres et tu aspires l’intérieur. C’est pas facile. La bête est récalcitrante. Et un peu caoutchouteuse. Mais voilà tout son charme. Dans le même registre, attaque-toi aux couteaux, les cuttlefish, tout aussi goûteux. Et tout ça pour le quart du prix d’une de tes merdes.
On continue dans le poisson, si tu veux bien, c’est mon dada. Si tu passes par Cameron Highland, il faut que tu débarques au resto Kougen. Le proprio porte un chandail écrit Canada. Il est adorable. Tu commandes, comme moi, des petits Shishamo. Ce sont des poissons qui ressemblent étrangement à nos éperlans, sauf qu’elles (!) sont enceintes. Les poissons ont le bedon plein d’oeufs, comme une farce. Tu les manges au complet. C’est délicieux. Et si tu fais comme moi et que tu laisses les têtes dans ton assiette, monsieur Canada va te dire : iou have tou eat ze head tou. Fais-le, il a raison. Tout est bon. Ici, à Kushing, laisse-toi tenter par une salade Umai. C’est ce que les mexicains appellent une ceviche, ce poisson cuit dans le jus de lime; mais ici, on y ajoute du concombre et des piments qui font pleurer des yeux.
Le poulet, tu connais? Ici on le frit aussi. Tout autant qu’on le cuit à la vapeur, au four, au tandoori, on le saute, flambe, laque, en soupe, en riz, en pâtes, en dumpling.
Si tu es plus du type bœuf, go pour le Redang, ce mélange indonésien d’épices et de lait de coco qui te transforme un rôti de palette en filet mignon. C’est épicé, certes, mais avant tout riche en saveurs. J’en ai même mangé dans une pizza, en regardant du foot. Avec trois ou quatre Tiger, la bière locale, tu ne t’ennuieras pas de ta salade de nouilles.
En parlant de nouilles… Faut vraiment que je te parles des plats de nouilles d’ici? En soupe, frites, ou sautées, avec légumes, poisson, œufs, poulet, name it. Tu peux manger différent chaque jour avec les mêmes ingrédients. T’as qu’à changer d’étales, de quartier. Ou de ville. Et les nouilles se réinventent. Pas certain pour tes recettes secrètes, mon colonel.
Alors, ça te dit? On va bouffer?
Tu vas voir, tu vas t’en lécher les doigts, mon Harland.
Et ça goûtera pas le suif.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques malaysiennes 04 – Arrêter
Dormir.
Sur la plage de sable blanc.
Sur la galerie du chalet.
Dans le lit.
Je dors l’après-midi.
La nuit.
Pas de farces, pour un insomniaque, dormir la nuit, c’est le pied.
Je dors.
Je ne fais que ça depuis que j’ai mis les pieds sur Besar, la plus grosse, mais la moins achalandée des Îles Perhentian.
Faut dire qu’il a fallu se lever tôt et prendre un avion de Penang vers Kota Bharu, partager un taxi avec un couple de jeunes français avec qui nous avons discuté en anglais quinze minutes avant de réaliser que tout le monde, à part le chauffeur, parlait français, et nous nous sommes dirigés vers Kuala Besut, situé à une heure de l’aéroport. Sur la route, j’ai vu mes premières maisons en bois. Un peu comme en Amérique du Sud, la plupart des habitations ici sont en ciment, mais sur cette route de campagne, j’ai aperçu plusieurs petites maisons construites avec des matériaux différents. On dit de Kota Bharu, qu’elle est la ville la plus traditionnelle de la Malaisie et qu’elle est très religieuse. Je ne pourrai pas vous dire si c’est vrai, j’en aurai visité que son aéroport et cette route de campagne. Arrivé à Kuala Besut, ce petit village côtier, nous avons pris un bateau jusqu’aux îles. On ne trouve pas de gros resort sur ces îles, mais de petites habitations, comme notre chalet, avec tout ce qu’il faut : un lit, un petit frigo et une douche/toilette. Rien de luxueux, mais à moins de 50 pieds de la mer de Chine qui a besoin d’une Tv et d’un séchoir à cheveux? Pas moi.
En plus, ici, je dors. C’est un boni. Et y a pas de prix pour ça.
Perhentian veut dire arrêter en malais. Ça s’invente pas.
Et c’est exactement ça que j’ai l’impression de faire. Arrêter pour la première fois depuis des mois.
Pour vrai.
Une vraie remise à zéro. Avec l’envie de reprendre chaque minute passée à regarder le plafond pendant mes longues nuits d’insomnie.
Il est 21h30.
Un orage soudain vient de s’abattre. Les vents balaient les arbres autour. La pluie frappe la fenêtre du chalet. Les éclairs frappent la mer pour y mourir. Les orages sont comme les épreuves de la vie: elles frappent sans avertissement et bouleversent soudainement tout ce qui était calme autour de soi.
Dans mes écouteurs, joue Burial. Come Down To Us. Une toune qui se marie parfaitement à la pluie et l’Asie.
Le tonnerre est assommant. Il fait vibrer le chalet. J’adore les orages. Parce qu’ils sont invariablement suivis par un accalmie. Le calme après la tempête.
Je suis heureux d’être ici. Sous cette pluie. Au loin.
Des fois, j’ai l’impression de me retrouver uniquement quand je suis loin de chez moi. Ailleurs. J’étais petit, enfant, et déjà j’étais toujours prêt à déguerpir. À m’en aller. Comme si la sédentarité me pesait.
L’inconnu est palpitant. Ce sentiment de perdre ses balises. Sa routine. Détourner les heures qui s’empilent sur son bilan. Ces minutes précieuses qui s’égrainent de sa vie. Je ne veux pas les passer à regarder des reprises. Ni à revivre les mêmes choses. Non. Je veux du nouveau. Même des orages.
C’est cool les orages.
On dort bien sous l’orage.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques malaysiennes 03 – Muskol No.5
Elles doivent avoir entre 15 et 20 ans. Difficile de placer un âge sur les asiatiques.
Elles sont cinq. Cinq petites Malaises à rigoler dans le bus qui relie Kuala Tahan à Cameron Highlands. Elle sont belles à voir. Avec leurs foulards multicolores, leurs sourires coquins et leurs yeux pétillants. Elle nous suivent depuis qu’on a pris le bateau en destination de Taman Negara. Sur le quai, quand je les voyais se photographier avec leurs téléphones, je leur ai offert d’en prendre une où elles seraient toutes présentes sur la photo. Elles ont accepté en riant et se sont placées bras dessus bras dessous, une avec les doigts en Peace and Love et une autre avec grimaces, démontrant leurs personnalités distinctives. Clic. Moment de bonheur. Ma fille avec ses amies. Sans les hijabs.
Et voilà que je les retrouve, trois jours après, en route comme nous pour Cameron Highlands.
Dans le fond, le monde est petit. Tu t’en rends compte quand tu le visites. Et si dans le fond, je suis incapable de donner un âge à ces petites, c’est peut-être parce que les voyages forment la jeunesse.
Le monde est beau à voir.
Je me disais ça quand j’entendais la pluie tomber sur le toit de notre chalet en plein coeur du parc Taman Negara. «Parc National» en malais. C’est le plus grand parc de la Malaisie avec plus de 4500 km carré. Ses forêts, vieilles de plus 130 millions d’années regorgent de plus de 250 variétés d’animaux et de milliers d’espèces d’insectes. Malgré les deux randonnées, dont une nocturne, nous n’en n’avons pas vu beaucoup. Période sèche oblige. J’aurais aimé vous dire que j’avais un serpent dans ma botte, comme Woody, mais mis à part ce minuscule petit verdâtre qui pendait sur une branche au-dessus de notre tête pendant notre marche de nuit, il aura fallu se rabattre sur le son lointain des guibons et les cris stridents des oiseaux et insectes.
– Tiz snéke iz small. Dis-je au guide.
– Yez, but veri danzerousse, répond le guide.
– Let’z continu, d’abord.
Pour se rendre au parc, on doit se taper quatre heures de bus et trois de bateau. Mais ça vaut la peine. Ce parc est magnifique. Une forêt luxuriante si dense qu’on peut difficilement voir plus loin qu’un mètre en avant de soi.
Nous l’avons visité par les eaux à bord d’une petite embarcation qui nous a amené jusqu’à une cascade ou on a pu faire baisser la température de nos corps pour la première fois depuis KL. N’eut été des millions de guêpes qui me tournaient autour pendant que je me séchais sur une roche, j’aurais pu penser que le paradis ça pourrait ressembler à ça. Sans les bzzzzzzzz.
Parlant de bzzzzzzzz. À la brunante, vaut mieux se parfumer au Muskol no.5. J’ose pas imaginé pendant la saison des pluies.
Le chalet qu’on avait loué ressemblait à ceux de la Sepaq dans les parcs du Québec. Vraiment bien. À la différence qu’au lieu d’avoir des ratons laveurs autour, ce sont plutôt les macaques qui en sont maîtres des lieux. En fin de journée, en route pour une douche (froide) méritée, y’avait un attroupement de ces singes à quelques mètres de notre chalet. Pas très farouches, ils ne s’occupaient presque pas de nous. Sauf un. Un gros mâle agressif nous a montré les dents en se ruant sur nous. Histoire de protéger son clan.
– Ok bonhomme, je te laisse tes femelles, je veux juste passer.
Disons que ça c’était dans ma tête. J’ai plutôt reculer de 10 pas, en disant à ma blonde:
– Tiens, et si on faisait un détour par cette trail, ça semble plus beau par là.
Moi aussi, je voulais protéger mon honneur.
Et ma femelle.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques malaysiennes 02 – Terima kasih
Terima kasih.
Me semble que ce n’est pas compliqué.
Terima kasih. Deux mots. Cinq syllabes. Merci en malais.
J’ai finalement dit au chauffeur de taxi « thank you ».
Fuck le dictionnaire. Y a un mois, j’ai acheté un Berlitz Anglais/Malais, histoire de me débrouiller un peu pendant mon séjour, mais je n’ai même pas réussi à apprendre les 10 mots qui apparaissent en quart de couverture. 10 mots indispensables : oui, non, pardon, svp, merci, où sont les chiottes, etc.
Bref, ici on parle anglais.
– Ouėre iz ze chiotte?
– Zère, near ze kitzen…
Ha le plaisir des chiottes sur la route.
Toujours surprenantes. Un resto de bord de route avec des toilettes nickel, un resto tout propre avec des chiottes de chiottes. Aller à la toilette, en voyage, c’est ouvrir un cadeau-surprise, à chaque fois. Et pour continuer l’analogie, assure-toi d’avoir du papier pour emballer le cadeau. Au cas.
Bref, ici presque tout le monde parle anglais.
Faut dire qu’avec le paquet de nationalités qui habitent le pays et tous ces touristes qui y débarquent, fallait bien se trouver une langue pour se comprendre. La Malaisie est peuplée principalement par trois groupes ethniques : les Malais d’origine (50 %), les Chinois (24 %) et les Indiens (7 %). Faut éviter de mélanger les mots malais et malaysiens. Les malaysiens étant les habitants de la Malaisie, toutes ethnies confondues. Y a eu pas mal de brasse-camarade entre ces différents groupes, mais depuis les années 70′, l’année de l’ammoooouuuurrr, il semble que tout soit rentré dans l’ordre et que la plupart, même s’il ne sont pas enclin à s’identifier malaysiens ou malaysiennes, préférant garder leurs propres identités, ont tout de même appris à vivre ensemble et à se respecter.
Y a un côté sympathique de voir tous ces gens de cultures différentes, partager un pays. Si j’étais de mauvaise foi, j’aurais tendance à faire des comparaisons avec chez nous. Mais comme je suis en vacances et que je suis bien ici et que je m’ennuie pas trop de chez nous, je vais vous laisser à vos propres conclusions.
L’anecdote du taxi, m’a fait réfléchir sur mon propre rapport avec les langues. Comment je me comporte quand je dois utiliser une autre langue que la mienne et faire la conversation. La vérité? J’ai l’impression d’être un imposteur.
Je suis comme le Zelig de Woody Allen. Cet homme-caméléon qui, au contact d’une autre personne, prenait son accent et ses traits pour devenir son double.
C’est ce que je suis. Une éponge. Une papier carbone. Un photocopieur.
Je suis un peu comme ça avec les langues.
Prenez Guillaume, ce jeune Français bavard (je sais que c’est un pléonasme..) qui m’a empêché de dormir/écrire/lire en me faisant la discussion dans le bus pendant tout le trajet de trois heures vers Jerantut. Travaillant en Australie, il est venu passer une semaine en Malaisie. Aussitôt que je me suis mis à lui parler, j’ai commencé à modifier mon vocabulaire et employer des mots que je n’utilise jamais. Pétard. Du coup. Alors. Je me suis même mis à avoir un accent directement sorti des films de Pagnol. Gênant. Si Guillaume s’était appelé Georges et qu’il était né dans une banlieue londonienne, j’aurais pris l’accent de Downton Abbey et utilisé des mots comme shocking. Pathétique.
Zelig, je vous dis. Ridicule. Et j’y suis pour rien, je vous assure. Ça ne vient naturellement. C’est encore plus troublant.
Ça explique sûrement pourquoi je n’ai jamais jugé les vedettes québécoises qui font un tabac en France et qui se mettent à parler en cul-de-poule. Je fais pareil. Je dirais même pire. Parce que je suis pas une vedette et que ça me prend que 5 minutes pour être assimilé sans être en immersion totale. Alors quand vous vous foutiez des Diane Tell et des Stéphane Rousseau, moi je riais jaune en regardant ailleurs.
Par solidarité.
Pas de farces, je m’écoute parler et je m’énerve moi-même.
Bordel de merde.
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques malaysiennes 01

Je suis un œuf cuit sur une plaque.
Il faudra décoller mes sandales avec une spatule.
Chow Kit. Kuala Lumpur. Malaisie. Red district.
Quartier typique de Malaisie. Je peux pas dire si c’est vrai, j’y suis que depuis hier.
Assis à une table de plastique, je prends une Tiger. Une bière locale. Mon voisin avec qui je partage la table n’a même pas levé les yeux quand on m’a assis à celle-ci avec lui. Il sale son eau tonic machinalement. Juste derrière nous, un enfant trisomique mange du vermicelle et ça le fait rigoler de me voir. J’ai bu ma bière d’un trait. Un gars sort du Saguenay, mais on sort jamais le Saguenay du gars. Autour de moi, Chinois et Malais et quelques Indiens. Rien qui me ressemble. J’écoute, mais comprends rien aux discussions des tables d’à coté. Je suis à l’autre bout du monde. Tant mieux. Ça fait souvent du bien de rien comprendre.
Il fait chaud. Très. Avec le facteur d’humidité, on frise le 50. J’ai voyagé dans pas mal de places, mais là je frappe un mur. Mes vêtements me collent à la peau. J’ai l’impression de nager debout. Je rêve de m’imperméabiliser les aisselles avec une couche de Varathan.
Kuala Lumpur n’est pas une ville où l’on peut respirer. Entourés de béton, on a l’impression d’être dans un tube de ciment. L’humidité est à son comble. Chaque pouce carré est habité. Quand je vois un arbre, j’ai le goût de le féliciter d’aspirer tout ce diesel pour nous. En quittant l’appartement ce matin, ça sentait aussi la fumée. Comme chez nous quand nous subissons des feux de forêts au nord. J’avais lu que cette boucane venait tout droit d’Indonésie. Pendant les brûlis annuels des agriculteurs indonésiens. J’en sais trop rien. Je sais seulement qu’il ne faut pas être asthmatique pour habiter ici.
KL, comme on dit ici, n’est pas tout à fait pour marcher non plus. Les artères piétonnières sont souvent petites ou inexistantes. Les scooters et les voitures sont les maîtres des lieux. Traverser un rue est une course à obstacles ou les feux de circulation sont des parures, tout autant que les bandes jaunes sur l’asphalte.
Avant de m’assoir à cette table avec mon inconnu saleur de tonic, je suis allé faire une virée au marché de Chow Kit. Si, en voyage, certaines visitent les musées, moi je visite toujours les marchés publics. Et là, disons que j’ai été servi à point. Un toit bancale de tôle, des étales de poissons vivants, des poulets accrochés, des morceaux de viandes débités avec ferveur. Les sandales dans le jus de cequiquouledepartout, des odeurs qui te réveilleraient un mort, mais surtout des marchands qui y travaillent. Cigarettes au bec, on assomme des poissons récalcitrants, on arrache des cœurs de poulet, ça rit fort, avec leurs bouches édentées. Pris quelques clichés avec permission.
– ouére are iou from?
– Canada. I’m french canadian…
– Haaaa, canada…
Les gens sont très gentils. On cherche toujours à nous orienter. Ouére dou iou want to go. Les filles me sourient. Life is cool.
Bizarrement, l’événement le plus traumatisant depuis que je suis parti, s’est déroulé à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Un homme en colère à enguirlandé sa femme devant tout le monde. «Grosse conne!» qu’il lui criait à deux pouces des oreilles. Ça ma mis à l’envers pendant des heures. Depuis que je suis en Malaisie j’ai croisé beaucoup de femmes voilées. Certaines couvertes des pieds à la tête, avec uniquement ce petit grillage pour voir un peu, mais je n’ai jamais senti une agression aussi sévère que celle de ce Français qui engueulait sa femme.
Drôle les perceptions, hein?
Billets que vous pourriez aimer
Le vide
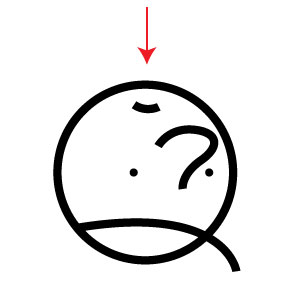 – Tu es certain que ça va? Ton dernier texte m’a fait peur, tu sais…
– Tu es certain que ça va? Ton dernier texte m’a fait peur, tu sais…
– C’est le premier texte que tu écris que je n’aime pas…
– Hey Marc, pas te connaître, je me dirais le mec qui a écrit ça, va se suicider.
Des remarques sur mon précédent billet.
Un texte que je pensais avoir écrit au second degré. Exagérant mes travers. Amplifiant un matin où tu te lèves du mauvais pied. Ce texte, même si senti, était bourré de clichés. Oui, un billet d’humour noir, mais surtout un texte qui détonnait avec l’image que je projette.
M. Sourire.
Positif. Posé. Rigolo.
L’image que je projette.
Ça paraît bien.
J’ai pourtant une part de moi plus sombre. Plus cachée.
Que je garde pour moi. La plupart du temps.
Ça vous surprend?
Hier, un ami annonçait sur Facebook qu’il prenait un congé au travail. Congé de maladie. Dépression ou burn-out. Impossible de savoir.
J’ai aimé lire ce statut.
Pas aimer qu’il soit malade. Ça, je n’aime pas. Mais d’écrire qu’il l’était, j’ai trouvé le geste beau. Et important. Parce que ce n’est pas une tare. D’être dépressif, angoissé, en détresse. Ni un truc tabou qu’il faut cacher à tout le monde. Non. Pas plus qu’il ne faut cacher qu’on est diabétique.
La maladie mentale est une maladie. Point à la ligne.
Une maladie qu’il faut soigner, certes, mais avant tout démystifier.
Une maladie qui se contrôle. Guérir? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais d’avoir la possibilité d’en diminuer les impacts négatifs sur sa vie et celles de ses proches, ça, j’en suis certain.
À la mort de ma sœur, mon père a sombré dans une dépression. Incapable de vivre les émotions qu’un tel drame apporte. Pas outillé sentimentalement, il a tombé dans le vide.
Comme on peut se noyer dans un chagrin trop profond.
Des amis autour de moi ont vécu ou vivent, eux aussi, des épisodes plus noirs de leurs vies.
Certains en vivent encore au quotidien. Un combat souvent difficile pour les uns, mieux contrôlé pour les autres.
Les gens que je connais qui sont aux prises avec le vide n’ont pas de points en commun par rapport aux causes de leurs désarrois. Non, ce ne sont pas tous des workholics, non ils n’ont pas tous vécu des peines d’amour, des mortalités ni de grandes déceptions, mais ils ont en commun un débalancement chimique au niveau du cerveau. Ça parait bête de dire ça comme ça, mais voyez ça comme le sucre par rapport au diabète.
Non, ce ne sont pas des personnes faibles. Ho non. Je peux vous parler de mon chum fort comme un bœuf, avec des mains grosses comme ma tête. Ni non plus des crétins. Je peux vous parler de cet autre ami, brillant dans son domaine, un chef de file, un chercheur. Comme cet autre, ce musicien, capable d’exprimer ses sentiments dans son art, mais incapable de les gérer par lui-même.
En y pensant bien, ces gens ont tout de même un point en commun. Celui d’avoir pris la décision d’en parler à leurs proches. Je ne veux pas utiliser le mot « courage » parce cette notion rapporte trop à un geste hors du commun. Alors que je pense qu’il faut davantage démontrer qu’en parler devrait être facile. Qu’aucun jugement ne viendra interférer avec ces confidences. Et c’est la clé importante. Nos jugements. Ou plutôt notre absence de.
Moi?
Je sais pas.
Mais il me semble que je serais dispo à ça. Il me semble avoir tout ce qui faut pour tomber dans le vide. Des années de reflux sentimentaux, des bogues de moi par rapport à moi non réglés, une masse de travail hors-norme, un manque de sommeil chronique, etc. Il me semble que j’ai à l’intérieur de moi tous les ingrédients dont un gars a besoin pour se concocter un passage à vide. Un cocktail à saveur de remise en question.
Et si ça m’arrivait, une chose est certaine : je ne voudrais surtout pas qu’on me juge.
Toi?
Billets que vous pourriez aimer
Mauvaise journée
 Y’a des jours où tu as l’impression d’être, comme dirait mon chum Alain, un pou dans la mélasse.
Y’a des jours où tu as l’impression d’être, comme dirait mon chum Alain, un pou dans la mélasse.
Pain in the ass comme disent les Anglais.
Rien ne va.
6h30. Les chiffres du cadran illuminent ta face.
Déjà.
Dans le lit, tu as la forme d’un bretzel. On dirait que tu es tombé d’un immeuble de 100 étages. Tes bras sont déconnectés tout autant que tes jambes. Tu es démembré. Si tu étais mort pendant ton sommeil, l’autopsie prouverait que tu t’es battu toute la nuit avec les bibites dans ta tête.
Le chien occupe 60% du territoire, ta blonde, 30%. Il t’en reste 10%, éparpillé un peu partout. Et ce même si tu représentes 50% de la masse totale. Ce qui explique ton état bretzel.
Tu t’es couché à 2h30.
Ton livre de chevet te scie la joue. Tu t’es endormi dessus.
Littéralement.
Ta bave servant de signet.
Ce livre dont tu devras relire les 50 dernières pages parce que tu les as lues dans un état semi-comateux en t’obstinant, les yeux dans l’eau, que tu finirais ce soir-là les 300 dernières restantes.
Tu te réveilles et à la radio, y a déjà un truc qui te fait chier.
Les nouvelles. La voix nasillarde de l’animatrice. Le mot mal prononcé qui te reste dans l’oreille. La toune poche. La météo.
Fuck.
Tu te dis que le monde, c’est lourd.
Tu te traines tout de même à la salle de bain.
Le miroir est inévitable.
Malgré les crottes dans tes yeux, tu vois tout ce qui dépasse et pend.
Les cheveux sont en broussailles et ils vont le rester.
Tu urines pendant 3 heures.
Tu te dis: fuck, ma prostate.
Je devrais me lever la nuit.
Bla-bla.
Tu te le dis sans y croire. T’aimes mieux l’entendre dire par ton doc quand il a son doigt dans ton cul. Pain in the ass.
Tu te places face à l’évier qui pompe l’eau chaude du sous-sol.
Tu évites le miroir. Pas deux fois. Pas cave à temps plein.
Tu t’ébouillantes la face avec l’eau qui a finalement décidé d’atteindre le point d’ébullition pendant que tu analysais, avec ta main, l’état de ta barbe que tu n’avais nullement l’intention de couper malgré son état qui te fait ressembler à un chercheur d’or qui ne s’est pas lavé depuis 3 mois.
La face rouge, les yeux rouges, tu te brosses les dents en oubliant de fermer la bouche. Et de changer à l’eau froide.
Tu reviens à la chambre.
Regarde tes vêtements.
Jeans pâle. Jeans foncé. Jeans délavé. Pantalon. Tu prends le pantalon. Mets le pantalon. Enlèves le pantalon. Mets le jeans pâle.
Prends le premier t-shirt sur la pile. Pâle. Mets le t-shirt pâle. Réalises être ton sur ton. Tu changes le jeans pour plus foncé. Celui qui te fait un gros cul. Mais tu changes plutôt le t-shirt et tu prends le foncé.
Fuck.
Tu irais travailler à poil.
Si ce n’était de tout ce qui pend et dépasse.
Tu trouves finalement un truc qui fitte… dans la noirceur de la chambre. Mais à la lumière de la cuisine, ça craint. Mais tu te dis que tu vas passer la journée tout seul au bureau. Anyway.
What the fuck, hein?
Tu regardes la cafetière.
Y a de l’espoir.
Le café c’est l’héroïne du lève-tôt.
Ça, tu te dis, ça va me sauver la vie.
Vide.
Normal.
Ta blonde t’a demandé de t’en occuper avant d’aller se coucher.
T’aurais le goût de brailler. De te mettre en bretzel sur le tapis. Et tu repenses à ta nuit dans cette position et tu te dis que tu seras mieux au bureau, finalement.
Ton auto pue.
Tu regardes partout. Y a rien de vivant, à part toi, dans cette auto.
Tu ramasses un café et un muffin au MacDo.
Un lait, un sucre. Aux carottes.
Tu as l’impression que les ingrédients sont tous bons, mais pas dans le bon ordre.
Tu arrives au bureau.
Ton bureau pue.
Fuck.
Il est 7h30 et tu te demandes déjà comment tu vas réussir à passer à travers.
Au premier téléphone, ton client te demande si ça va.
– Super journée, tu lui réponds, l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt! Si je peux aller te rencontrer? Bien sûr J’arrive ! Tu raccroches en riant. En te brûlant sur ton café trop sucré, ton muffin en carton dont les graines tombent sur ton kit plus ou moins agencé.
Fuck.
Billets que vous pourriez aimer
Les trois mousquetaires

Nous n’étions pas destinés à être ensemble.
Quatre gars de milieux différents.
De quartiers, mais tout autant de statuts sociaux. Petit gars du centre-ville, un autre de Chicoutimi-Nord, un de Notre-Dame et un autre du quartier derrière les centres d’achats. 4 gars avec des métiers aux antipodes. Finance, droit, vente au détail, communication. Un qui aime la moto, l’autre Petula Clark, un qui adore la pêche aux saumons et l’autre qui lit de la bande dessinée.
C’est à se demander ce qu’ils ont en commun.
Rien.
Sinon ce lien unique d’être allé à la même école secondaire.
Pourtant, on n’est même pas devenus amis très jeunes. Ça aurait pu faire une belle excuse, expliquer cette rencontre comme une erreur de jeunesse, mais même pas. En fait, je ne me souviens pas trop où et quand cette belle amitié à vu le jour. Début vingtaine? Début trentaine? Pas tellement important, je dirais. Car aujourd’hui, je dirais depuis toujours.
Car j’ai l’impression qu’ils sont là depuis le début.
Et qu’ils le seront toujours.
Des gars à qui on raconte tout.
Des gars qui écoutent sans juger.
On raconte nos bonheurs comme nos malheurs. Sans aucune inhibition.
Nos soirées bien arrosées sont des histoires épiques dignes des contes de Cervantez. Nous sommes des Don Quichotte. Nous nous battons contre des moulins à vent. Nous sommes des hommes de taverne. Nous nous abreuvons même la vie. À grandes lampées. Chacun à notre manière, nous racontons nos vies avec autant de rires que de pleurs. Nos aventures sont épiques et nos plans rarement réfléchis. Quatre gars au bord de la cinquantaine, avec des cœurs dans la vingtaine, les yeux dans l’eau, qui parlent des vraies affaires.
Ou des affaires ordinaires.
Parce qu’on est comme ça aussi.
Des gars.
Dans tout ce qu’ils ont de plus insignifiant.
Dans tout ce qu’ils ont de plus édifiant.
Les mousquetaires de Dumas. Un pour tous et tous pour un. Notre amitié comme seul arme. Prêt à affronter des armées.
Dans le taxi qui me ramenait à la maison, je leur ai envoyé un texto truffé de fautes causées par l’alcool:
Y’a des jours ou je me dis quoiqu’il arrive dans la vie, je sais que vous serez toujours là. Et ça me rassure. Je vous aime.
Et je me suis évanoui.
Repu. En me flattant la bedaine.
Mais heureux.
Comme devait l’être Dartagnan.
Billets que vous pourriez aimer
Souvenirs sur 10 km
 Ce soir, j’ai enfilé mes espadrilles et suis parti courir dans le temps.
Ce soir, j’ai enfilé mes espadrilles et suis parti courir dans le temps.
km 1
En montant la rue Racine, en face de l’ancien Lycée du Saguenay avec du techno à plein volume dans les oreilles, j’ai tout de même cru entendre le rire de jeunes filles.
J’ai tout de suite eu une pensée pour la chanson de Vincent Delerm « Les filles de 1973 ont trente ans ».
Celles qui ont vu trois fois Rain Man
Celles qui ont pleuré Balavoine
Celles qui faisaient des exposés
Sur l’Apartheid et sur le Che
Celles qui ont envoyé du riz
En Ethiopie, en Somalie
Celles qui disaient « tu comprends pas »
Elles s’appellent Isabelle, Katia, Nathalie, Lucie comme on s’appelle tous Jean, Luc et Marc.
On a 12 ans et on va dans des écoles non mixtes. Comme l’amour nourrit le cœur, au lieu de manger, on échange nos heures de repas pour courir à mi-chemin entre nos deux écoles. Pour se cruiser. Avec l’espoir qu’elles soient là. Souvent on revient bredouille. La plupart du temps, je dirais. Mais on y retourne. Avec l’espoir au ventre. Et les hormones au plafond.
Nos premiers amours. Maladroits. Sans lendemain. Pourtant si intenses.
J’ai eu le cœur qui s’est mis à battre plus intensément. Mes mollets se sont contractés. J’ai grimpé la rue du Séminaire jusqu’à Jacques-Cartier. Juste en face du Cégep de Chicoutimi.
km 2
– N’ouvre surtout pas les yeux, Marc! J’arrive!
En plaçant mes mains sur mes yeux, j’ai entendu crier mon oncle qui descend à vive allure la pente enneigée du Grand Séminaire de Chicoutimi, devenu aujourd’hui le cégep.
Quand tu vis dans le centre-ville, tu profites des espaces verts de proximité. Comme ces pentes en plein coeur de la ville. En glissant sur mon Crazy Carpet™, j’ai enfilé directement dans une touffe de ronces. Les épines piquent ma peau, mon visage, et je suis pris, telle une mouche, dans une toile d’araignée. Robert m’agrippe le bras et me tire doucement pour me libérer de mon piège végétal.
J’en sors avec le visage tuméfié et plus de peur que de mal tandis que mon oncle Robert, lui, craint pas mal plus la réaction de ma mère en voyant ce visage égratigné. C’est tout de même un moindre mal, car si les arbustes n’arrêtaient pas ma descente, je me retrouvais dans le trafic.
C’était l’époque des mitaines de laines avec nos poignets rouges sciés par le froid et nos habits de neige non isolées qui nous laissaient transis dans nos caleçons gaufrés et surtout détrempés.
C’était l’époque des grandes familles qui prenaient soin de l’un ou l’autre de ses membres.
km 3
Au trot, j’ai descendu la rue Jacques-Cartier jusqu’à l’ancienne track de chemin de fer et bifurqué sur la rue Price.
En entendant le train qui s’en vient, je cours derrière la maison d’Alain, mon ami du primaire. Le fils du denturologiste Carrier. Ça m’a toujours fait rire. Carrier. Denturologiste. Sa famille et lui, habitent tout près du tracel, tout en bas de la côte Price. Dans cette maison unifamiliale, il y’a une salle de jeu immense avec une piste de course électrique. Je n’ai ni l’un ni l’autre. Encore moins de maison. Chez nous, on vit à quatre dans un minuscule appartement, en haut de chez ma grand-mère. Dans mes yeux d’enfant, je suis impressionné par toute cette richesse. Alain a tout. Sa chambre déborde de jouets de toutes sortes.
J’ai traversé la rue Price, monté une butte, toujours sur le chemin de l’ancienne voie ferrée, foulant le sol rocailleux sous cette arche improvisée, créée par les arbres.
km 4
Au-dessus du mur de ciment couvert de graffitis, j’ai aperçu les logements sociaux qui ont remplacés l’école St-Philippe où j’ai fait la majeure partie de mes études au primaire. Une école ordinaire avec un train qui passait quasiment dans la cour.
J’ai revu l’espace d’un instant les profs Jocelyne-qui-mâchait-ses-joues et Candide-qui-craquait-des-genoux. J’ai revu aussi Fortuna Ouellet qui m’avait enseigné en première année. Une vieille fille qui habitait derrière chez nous, en face de l’épicerie. Quand je suis revenu dans la région, il y a une vingtaine d’années, j’ai travaillé dans un bureau situé juste en face de son logement. Elle y habitait encore. Elle n’avait pas changé d’un poil. J’en avais convenu qu’elle avait toujours été vieille. Ou que le temps n’avait agi que sur moi. Uniquement sur moi.
J’ai traversé le boulevard Université pour rejoindre la rue Dubuc pour passer devant La Pulperie.
km 5
Avant d’être un musée, la Pulperie de Chicoutimi était notre terrain de jeux.
Sans crainte du danger, on y escalade les poutres d’acier, traversant du haut de nos 10 ans, la rivière située à plus de 90 pieds plus bas. On fait le tour du bassin d’eau en se tenant sur la rampe, glissant quelquefois le pied dans l’eau. On ne sait même pas nager. Insouciants. Invincibles. Le danger n’existe pas. Ou on en est simplement si peu conscients. On part flâner toute la journée sans que nos parents s’inquiètent. On revient au repas, sans se faire questionner sur l’endroit d’où on vient. Tant qu’on est à l’heure pour souper.
J’ai traversé le pont en face de l’église Sacré-Cœur, il y avait des enfants dans le skatepark aménagé sous le bassin. J’avais envie de leur dire que j’avais joué là moi aussi, il y a une quarantaine d’années. Et j’ai changé d’avis en me disant que j’étais dans le quartier tought de mon enfance.
km 6
Je pédale sans regarder derrière moi. J’ai les yeux dans l’eau et un suçon collé dans les cheveux. Pour être certain que je vais me souvenir de ne pas revenir dans le coin, les trois gars m’ont frotté la tête avec pour s’assurer qu’il reste bien en place, englué dans ma blonde tignasse.
Ça m’apprendra à me risquer en zone de combat.
En vélo, je me suis aventuré au petit dépanneur du Bassin, sur la rue Bossé. J’ai autour de 8 ans. Quand j’en suis sorti, on m’a tout de suite convié au combat. Je ne suis pas des leurs. Comme je suis monté sur un frame de poulet, je bondis sur ma bécane et préfère la fuite. En me filant un coup de pied, le plus grand de mes agresseurs a eu le temps de sortir un lollipop baveux de sa bouche et me le sacrer dans les cheveux.
Cette nuit là, je me suis couché en regardant le plafond et en me grattant le fond de la tête dégarni, à l’endroit même où ma mère avait enlevé au ciseau, les couettes collées de sucre.
J’ai pris le chemin du parc qui longe la sortie du pont Dubuc, traversé le boulevard jusqu’au rond-point qu’on appelait la goutte d’eau.
km 7
J’ai atteint les HLM. Les deux tours hideuses, au bout de la rue Racine. Quand on les a construites, j’avais à peine sept ou huit ans.
Deux immeubles à logements tout justes derrière la rue Smith.
J’ai un ami qui demeure dans cette rue délabrée. Je le vois seulement à l’école ou dans les ruelles de nos jeux d’enfants. Un midi, je me pointe près de chez lui et je vois son frère. Je le suis jusque chez lui afin de savoir où sa famille habite. Je monte les marches du logement insalubre, jusqu’à sa porte d’entrée, cogne et demande à voir Jean-Claude à un gros monsieur en camisole pas trop fraîche. Mes yeux restent fixés sur cette cuisine sale où sont jonchées, ici et là, de grosses bouteilles de bière vides et des assiettes encrassées. J’observe cette absence de meubles, de déco et de vie. Jean-Claude se pointe et c’est sous les cris et jurons de son père qui nous demande de sacrer notre camp dehors au plus criss que l’on courre à l’extérieur. Il me dit qu’il déteste son père.
Je pense avoir réalisé à ce moment précis, du haut de mes trois pommes, ce que représentait la pauvreté et la misère sociale. Chez nous, on n’était pas riche, mais on n’était pas pauvre, non plus. J’avais deux parents qui prenaient grand soin de moi, me gâtaient en me guidant du mieux qu’ils pouvaient.
Aujourd’hui, quand je cours près de cette rue, je pense souvent à Jean-Claude. Me demandant ce qu’il est devenu. On dit qu’il est difficile de se sauver de son propre destin, surtout s’il est malsain. J’espère que lui a pu.
J’ai tourné sur St-Anne et j’ai filé sur la rue Petit.
km 8
Je passe devant la maison de Sonia, de Serge, d’André, ces amis que j’ai revus un peu ici et là, à travers les années qui nous séparent de l’enfance.
Dans ma tête, je revois la table tournante du père de Serge, sa collection de Bécaud prônant sur le meuble du salon. Je vois le garage du père de Sonia ou on va se cacher pour jouer au docteur. Mais je ne vois pas le bloc ou André habite, disparu depuis le temps, dans un incendie. J’imagine qu’il a brûlé en une minute, comme une brindille sèche d’automne. L’immeuble était tellement vieux et sec.
J’aperçois notre minuscule logement, mais j’y croise surtout Laurette, ma grand-mère chérie que j’ai tellement pleurée.
Cette femme de caractère, forte comme un arbre centenaire, malgré sa chétivité. Cette vieille fille de 32 ans qui avait pris en charge la famille de son veuf de mari pour créer sa propre famille. Laurette à qui je vais conter mes histoires. Avec mes cheveux droits sur la tête, mes pantalons déchirés, elle dit aux autres membres de la famille que je suis original. Sans me juger. Je suis son préféré, je le sais. Je descends toujours la voir, chaque jour que je peux. Je déjeune avec grand-papa, le faisant rire.
Même rendu à Montréal, quand je descends deux jours à Chicoutimi, voir mes parents, je passe chez elle. Je m’assois sur la chaise à ses côtés, la regardant filer sa laine à travers ses doigts croches.
J’ai vécu des jours plus sombres ou j’aurais aimé qu’elle soit encore là. Pouvoir lui raconter les trucs qu’on ne disait à personne, profitant de sa surdité pour avouer nos pires travers.
J’ai quitté la rue Petit en essuyant la sueur qui me coulait dans les yeux. La chaleur a cette vertu de cacher nos sentiments les plus profonds. J’ai pris le chemin du boulevard Saguenay.
km 9
Devant le vieux pont de Sainte-Anne, j’ai foulé le sol de la zone portuaire.
En fermant les yeux, le parc a disparu et laissé place aux immenses contenants d’essence qui jonchait la place avant sa grande réfection des années 90.
Le Vieux-Port comme on l’appelle n’est pas visité par les jeunes familles et les marcheurs, mais par une faune beaucoup plus bigarrée. Toxicomanes et prostitués s’y donnent rendez-vous. Mon ami Yohan en a fait un sujet d’article fascinant dans le journal étudiant. Il décrit sa rencontre avec un étudiant qui fait des passes pour payer ses études. Alors que la presse néglige ce drame, ce jeune homme de 17 a mis ce secret au grand jour.
Le hasard a fait qu’on s’est retrouvés tous les deux, Yohan et moi, à Montréal à partager un logement. On dit que notre jeunesse nous forme. Je pense que c’est bien vrai. Yohan a continué à s’intéresser aux autres et travaille toujours dans le domaine communautaire. Brave homme.
km 10
J’ai quitté la zone portuaire, en longeant le Saguenay, profitant de la brise et de l’odeur de la marée basse.
Je suis revenu sur mes pas.
À mon point de départ.
En ayant eu pourtant l’impression d’avoir fait un si long voyage.


















