L’enfer c’est rarement les autres.
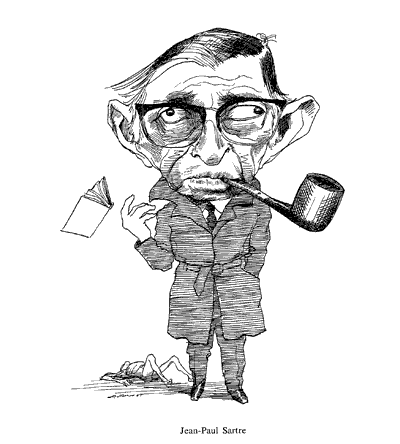 Sartre affirmait dans sa pièce Huis Clos que « l’enfer c’est les autres ». Le monde en général a tendance à lui donner raison, préférant laisser à autrui la raison de leurs soucis. À défaut de faire de l’introspection et de reconnaître ses torts, l’humain a la mauvaise manie de jeter le blâme sur n’importe qui sinon qu’à lui-même. Comme un gamin qui se défend à la moindre incartade, on préfère nier l’évidence et accuser à tort le monde entier de ses échecs. Ce n’est pas moi qui a fait ça, mais ce sont les circonstances qui ont produit ce résultat. Je suis la victime des événements. Je ne suis pas responsable. Aveugle de ses propres agissements, l’humain a l’accusation facile quand vient le temps de se défendre. L’attaque étant la meilleure défensive. Il serait faux d’affirmer que nous vivons dans un cercle aseptisé et complètement imperméable aux influences d’autrui. Nous sommes sollicités et influencés par les autres, comme nous les sollicitons et les influençons. C’est donnant donnant. Il y va de même pour les responsabilités.
Sartre affirmait dans sa pièce Huis Clos que « l’enfer c’est les autres ». Le monde en général a tendance à lui donner raison, préférant laisser à autrui la raison de leurs soucis. À défaut de faire de l’introspection et de reconnaître ses torts, l’humain a la mauvaise manie de jeter le blâme sur n’importe qui sinon qu’à lui-même. Comme un gamin qui se défend à la moindre incartade, on préfère nier l’évidence et accuser à tort le monde entier de ses échecs. Ce n’est pas moi qui a fait ça, mais ce sont les circonstances qui ont produit ce résultat. Je suis la victime des événements. Je ne suis pas responsable. Aveugle de ses propres agissements, l’humain a l’accusation facile quand vient le temps de se défendre. L’attaque étant la meilleure défensive. Il serait faux d’affirmer que nous vivons dans un cercle aseptisé et complètement imperméable aux influences d’autrui. Nous sommes sollicités et influencés par les autres, comme nous les sollicitons et les influençons. C’est donnant donnant. Il y va de même pour les responsabilités.
Les entreprises, étant administrées par des humains, ont tendance à partager les mêmes imperfections que ceux-ci. Ainsi, peu d’entre elles reconnaissent leurs torts quand leur arrive un événement désagréable. À un client dont la commande est en retard, on jette le blâme sur les transports. À un faible retour sur un investissement, on accuse les marchés. On blâme la température, la récession, les grandes surfaces, les magasins en ligne. La compétition devient l’ennemi numéro 1. La source de tous les problèmes. Si ça ne va pas dans notre sphère d’activité, c’est que les concurrents n’agissent pas avec respect en brisant les lois (non écrites) du marché, qu’ils nous copient ou qu’ils aient accès à des avantages dont ils sont les seuls à bénéficier. L’enfer c’est les autres. Jamais nous. Maudite compétition.
C’est plus facile d’accuser les autres que de provoquer une auto-évaluation et de jouer son propre destin. Personne n’aime être pris en défaut. Personne n’aime se rendre compte que c’est lui le coupable. Nier sa responsabilité et dénigrer est plus simple. Reconnaître ses torts n’est pas un exercice agréable. Se diagnostiquer comme étant l’unique responsable, ou du moins en partie, d’une mauvaise situation prend une certaine dose de courage et de modestie. Pourtant, n’est-ce pas ce à quoi l’on s’attend d’une personne proche en qui a fait confiance? Un ami qui affirme s’être trompé en rapport avec une situation déplaisante vécue reçoit normalement un meilleur accueil qu’un autre qui déclare n’avoir rien à se rapprocher. Faute avouée, à moitié pardonnée. Même chose en affaires. Quand une multinationale comme BP, en rapport à son déversement monstre de pétrole dans l’océan, ment que tout est sous contrôle et que tout va pour le mieux dans le colmatage de la brèche, il agit comme un élève qui cache sa fronde dans son dos devant une vitre cassée. S’il garantit, au contraire, faire l’impossible sans pouvoir être en mesure de savoir quand et comment il va y arriver; il agit en personne (ou en entreprise) responsable préférant la difficile vérité au mensonge facile.
Comme humain ou entreprise, chaque geste posé amène son lot de conséquences. Heureuses ou malheureuses. Si nous sommes tributaires des bons coups que nous réussissons au cours de notre vie, il faut avoir l’humilité de reconnaître ses moins bons. La perfection n’existe pas. Quoiqu’en pensent certains.
À croire que le pire ennemi qu’une entreprise peut avoir pourrait s’avérer être lui-même. À défaut de s’en prendre vainement à ses concurrents, si elle décidait de s’attaquer à ses propres démons, une entreprise n’y gagnerait-elle pas? N’est-il pas plus facile de s’améliorer que de demander aux autres de se dégrader? Au lieu de se raconter des histoires et se faire croire que les autres sont l’unique responsable de ses malheurs, il faut se regarder dans la face et revoir ses stratégies. S’améliorer n’est pas la meilleure arme pour se défendre de la compétition, de se démarquer de celle-ci de réussir?
Dans ma vie professionnelle, j’ai rencontré plusieurs compagnies qui au lieu de jeter leur dévolu sur la concurrence comme responsable de leur difficulté à percer le marché, se sont réinventées à la suite d’auto-diagnostics sévères. Même si ce n’était pas toujours facile. Laisser l’enfer… aux autres, comme ça il vous restera une marge pour atteindre le paradis.
> Jean-Paul Sartre par l’illustrateur David Levine
Billets que vous pourriez aimer
L’effet Velveeta.
 Cet après-midi je faisais remarquer à ma copine qu’une telle personne avait changé d’attitude du tout au tout vis-à-vis moi. Il n’était pas devenu soudainement un grand ami, mais il m’apparaissait beaucoup plus sympathique et agréable que par le passé. Ma conclusion était simple : il avait changé. Pour le mieux. Après tant d’années, il avait enfin compris que son comportement n’était pas le plus cordial et qu’un changement s’imposait; ce qu’il avait fait en apportant des améliorations majeures à sa personnalité. J’en étais persuadé; jusqu’à ce que ma blonde me manifeste bêtement un scepticisme sur ce constat simpliste en me balançant : « … et si c’était toi qui avais changé? »
Cet après-midi je faisais remarquer à ma copine qu’une telle personne avait changé d’attitude du tout au tout vis-à-vis moi. Il n’était pas devenu soudainement un grand ami, mais il m’apparaissait beaucoup plus sympathique et agréable que par le passé. Ma conclusion était simple : il avait changé. Pour le mieux. Après tant d’années, il avait enfin compris que son comportement n’était pas le plus cordial et qu’un changement s’imposait; ce qu’il avait fait en apportant des améliorations majeures à sa personnalité. J’en étais persuadé; jusqu’à ce que ma blonde me manifeste bêtement un scepticisme sur ce constat simpliste en me balançant : « … et si c’était toi qui avais changé? »
Ouin. Vu de même. J’avoue que je n’avais pas pensé à cette alternative. Je me suis mis à me rappeler certains épisodes de ma relation avec cet individu et mes arguments prouvant qu’il ait changé se sont effrités lentement pour laisser place à une auto-évaluation quelque peu sévère. Dans ma conclusion tardive, j’avais omis combien l’on est trop souvent d’accord avec soi-même. Tellement, que l’on oublie que les autres évoluent en satellite autour de notre nombril. Que contrairement à ce que l’on pense la faute d’une situation négative n’est pas toujours attribuable à autrui, mais bien au contraire, à soi-même. Que ce que l’on perçoit comme changement chez les autres n’est peut-être inconsciemment qu’un réaiguillage de nos perceptions personnelles qui ont évoluées. J’appelle ça l’effet Velveeta.
Quand j’étais enfant, je raffolais de ce fromage orange enveloppé dans un papier ciré et déposé dans une boîte de carton jaune. J’habitais avec mes parents, l’appartement au-dessus de chez mes grands-parents et je descendais souvent déjeuner chez eux. Mon grand-père mangeait de ce fromage-là tous les matins. Il nous préparait des rôties de pain cuit sur la sole et nous appliquions notre délicieux fromage sur celles-çi. C’était un moment magique. La preuve est que je m’en souviens encore. Il y a quelques années, alors que je faisais l’épicerie, je suis tombé au hasard des allées sur cette fameuse boîte de fromage et je n’ai pas pu résister à m’en procurer. Le lendemain matin, j’ai tenté de recréer ce petit rituel d’enfant, en me préparant à déjeuner comme « dans le temps ». Quand j’engouffrai ma première bouchée, je ne pus me convaincre de la garder dans ma bouche plus longtemps. Le fromage jaune dans ma bouche avait une texture de plastique et un goût de composé chimique. Mon rêve a pris le bord, en même temps que le fromage fût recraché. Cette expérience gastronomique était à des années-lumières de mes souvenirs. C’était dégueulasse et aucunement comme je me l’imaginais. Au début, je me suis mis à penser que Kraft avait changé la recette et que le « nouveau Velveeta » n’arrivait pas à la cheville de l’ancien. La conclusion était pas mal plus primaire que ça : c’était moi qui étais nouveau dans cette expérience. C’était moi qui avais « évolué ». C’était moi qui avais affiné mon bagage gastronomique et était dorénavant capable de saisir les subtilités culinaires. Le goût du fromage Velveeta n’avait rien à voir là-dedans. Il n’avait pas été modifié depuis 40 ans. Mais moi, si.
Cette conscientisation n’est pas qu’applicable aux produits que nous consommons, mais aux gens que nous côtoyons, les lieux que nous visitons et les entreprises avec qui nous faisons des affaires. Nous sommes souvent sévères avec ces produits ou ces personnes par rapport à des changements perçus alors qu’ils ne sont imputables qu’à nous mêmes. Certes, le monde évolue, mais rarement au même rythme que nos perceptions. Si vous en doutez et que vous avez l’estomac solide, faites comme moi le test Velveeta.
Billets que vous pourriez aimer
Ca va pas changer le monde.
 Marc Cassivi de La Presse tentait une explication, dans sa chronique cinéma d’hier, sur le fait que l’on voit toujours les mêmes comédiens dans les films québécois. En résumé, son point de vue tenait, entre autres, sur le fait qu’un film est plus facilement finançable quand une vedette connue y prend l’affiche et qu’il y a moins de risque pour un réalisateur de faire appel à un « king pin » qu’à un jeune premier. Même si ce jeune premier pouvait s’avérer un choix plus judicieux et plus convaincant pour tenir ce rôle.
Marc Cassivi de La Presse tentait une explication, dans sa chronique cinéma d’hier, sur le fait que l’on voit toujours les mêmes comédiens dans les films québécois. En résumé, son point de vue tenait, entre autres, sur le fait qu’un film est plus facilement finançable quand une vedette connue y prend l’affiche et qu’il y a moins de risque pour un réalisateur de faire appel à un « king pin » qu’à un jeune premier. Même si ce jeune premier pouvait s’avérer un choix plus judicieux et plus convaincant pour tenir ce rôle.
Cette chronique a inspiré Rock-Détente pour sa question Facebook du jour: « Pourquoi y a t’il toujours les même acteurs dans les films québécois? » Je n’ai pas pu me retenir et j’ai répondu : « Pour les mêmes raisons que votre station repasse toujours les mêmes chansons des mêmes chanteurs/ses… ». Sensiblement pour les mêmes raisons que les producteurs de films : ne pas faire de vague, créer une zone de confort pour ne pas déstabiliser les auditeurs en leur présentant des trucs qu’ils reconnaissent facilement. C’est pourquoi on entend inlassablement les mêmes trucs à la radio depuis des années; l’industrie nous dicte ce que l’on doit écouter / aimer / acheter. Ça donne des radios « mainstream » (quel mot ennuyant!) qui ne vous font rien découvrir de neuf, sinon d’apprécier encore plus d’avoir un iPod dans l’auto.
Il en est de même pour la littérature. Chaque année, un ou deux livres (la plupart du temps des livres américains) deviennent LE livre qu’il faut lire absolument. Normalement, ce livre devient LE film qu’il faut voir. Avec l’Acteur du moment. Dans une discussion dernièrement, avouant candidement que je n’avais pas lu un de ces livres à la mode, j’étais quasiment perçu comme un abruti. Comme si je passais à côté de quelque chose de primordial et d’important…
Ça vous rassure de lire ce que tout le monde lit? D’écouter ce que tout le monde écoute vous fait sentir bien? Moi, ça m’emmerde un peu. Je flush le contenu de mon iPhone aux deux semaines. Je n’écoute jamais une chanson en boucle. Les « Best Seller » me laissent tiède. Les films d’Hollywood, aussi. Je fouille sur internet et dans les magazines spécialisés pour découvrir de nouveaux talents, des nouveaux auteurs; je suis toujours à la recherche du coup de foudre créatif, celui qui te brasse dans tes conventions. Il n’y a rien de plus génial que de découvrir de nouvelles tendances, des nouveaux sons, des façons différentes de nous présenter de vieux concepts. De goûter à de nouvelles saveurs. De découvrir des cultures différentes. C’est toujours bon? Non, pas tout le temps. Ce qui est nouveau n’est pas nécaisserement toujours bon. Ce n’est pas aussi facile que ça. Quand on sort des sentiers battus, quand on brise les normes on fait toujours face à nos paradigmes et ils sont souvent difficiles à percer. C’est pourquoi beaucoup de gens ont besoin de se faire rassurer par les autres sur leurs choix. Si tout le monde aime ça et que moi aussi, j’aime ça, c’est que c’est bon. Simple équation.
Il en est de même dans le métier que je fais. Suivre une tendance est souvent plus facile que de la créer. Plus facile, mais surtout plus rassurant. Combien de campagnes de pub se ressemblent? Combien de concepts sont les petits de grandes idées? Certaines compagnies se complaisent à ressembler à leurs concurrents, ça les réconforte de jouer la même sérénade; ça ne les distingue pas, mais ça les sécurise dans leurs choix. Il y en a d’autres pourtant qui forcent à sortir lot. Ils ne le font pas toujours de la bonne manière, mais ils essaient. Être le premier à tenter un truc nouveau n’est jamais facile : les mêmes personnes qui préfèrent le statuquo jugent sévèrement les tentatives d’innovation des autres. Si certaines compagnies sont gauches dans leurs façons de se renouveller, il en demeure pas moins qu’ils provoquent et stimulent leur marché, ce qui en soit est déjà mieux que de suivre une parade déjà vue.
Billets que vous pourriez aimer
Absence de Marc™
 J’ai de la broue dans le toupet. C’est ce qui m’a retenu à l’écart de cet espace depuis quelques semaines. J’ai une vingtaine de billets brouillons non terminés et non publiés qui perdent lentement leur notion d’actualité. Des billets écrits par rapport à des projets sur lesquels je travaille présentement… et d’autres du type réflexion censurés l’espace d’un instant ou simplement en attente de relecture. À suivre.
J’ai de la broue dans le toupet. C’est ce qui m’a retenu à l’écart de cet espace depuis quelques semaines. J’ai une vingtaine de billets brouillons non terminés et non publiés qui perdent lentement leur notion d’actualité. Des billets écrits par rapport à des projets sur lesquels je travaille présentement… et d’autres du type réflexion censurés l’espace d’un instant ou simplement en attente de relecture. À suivre.
Je n’ai pas pris officiellement de vacances cet été. Mis à part ce long week-end à NY, je prendrai uniquement des journées ici et là. Je ne pense pas que ce soit la solution idéale. Dans quelques semaines ou mois, je vais regretter de ne pas avoir fait un voyage et d’avoir ainsi arrêté le moteur (et surtout le cellulaire) pour une couple de semaines. À suivre.
Je n’ai pas été absent qu’ici. Depuis mon retour du Grand Défi Pierre Lavoie, j’avais aussi complètement arrêté de rouler ou courir. Comme si ma mission accomplie, je n’avais plus à m’entraîner… En enfilant mes espadrilles vendredi et dimanche, ça m’a fait du bien. Et ça m’a fait mal aussi. Le cardio ça se gagne difficilement, mais se perd en un rien de temps. À suivre.
Mon bureau est dans un état lamentable. Des feuilles de papier traînent ici et là. J’ai des colonnes de verres à café empilés l’un dans l’autre. Des notes gribouillées jonchent la table ou mon Mac trône. Mon écran a plus d’empreintes de doigts que de pixels. Des moutons bêlent sous mes divans, mon plancher est sablonneux et je n’ose ouvrir la porte de mon frigo de peur d’y rencontrer l’évolution d’un sandwich oublié. Il faut décrotter cet endroit avant qu’un client vienne me rencontrer. À suivre.
Je lis quatre livres en même temps. Une page de temps en temps. Les derniers numéros des magazines auxquels je suis abonné sont empilés sur mon bureau à la maison, toujours dans leurs emballages plastifiés. Il sont tous prêts des livres, non lus, achetés à Barcelone, Londres…et New York. Il faudra bien un jour que je prenne le temps de tout lire ça ou que j’arrête simplement d’en acheter. À suivre.
Toutes les fois que je descends dans le sous-sol de ma maison, j’aperçois la toile vierge que je veux peindre pour mon salon. Si je me souviens bien, je l’ai acheté il y a maintenant 5 ans. Cinq ans. Faudrait bien que je m’y mette. À suivre.
J’ai l’impression d’être à côté de mes pompes. Il me semble qu’un secouage de puces s’impose. Un grand virage. Un tsunami. Un coup de pied au cul. À suivre.
Billets que vous pourriez aimer
Le paresseux appelle chance le succès du travailleur.
 Prenez ça comme une montée de lait ou comme un signe d’incompréhension et d’intolérance, mais je ne suis plus capable d’entendre le monde parler de la chance comme étant l’unique élément du succès d’un tiers. Pu capable. Y a pas une journée où à la suite de l’affichage d’un profil Facebook d’un de mes potes annonçant une bonne nouvelle que je ne lis pas en commentaire : « Hoooo t’é ben chanceux! » « Ahhhh, maudit chanceux, va! » Hey. Y a toujours ben des limites à mettre les bons coups des gens sur le compte de la chance, bordel. En plus de dénaturer la réalisation, ça enlève tout le mérite à la personne concernée. Shit. À une amie qui lâche son boulot au Saguenay pour tenter un nouveau projet à Montréal : « Chanceuse de pouvoir déménager, moi je pourrais pas! ». Ha non, tu pourrais pas? Pfff. Tu penses que ç’a été facile pour mon amie de tout lâcher pour poursuivre son rêve??? À un autre ami qui annonce fièrement qu’il s’en va un mois en Europe : « Chanceux, toujours les mêmes en vacances! ». Chanceux? Take The Money And Run, My Friend. Tu as idée des efforts que ça lui a pris pour faire ça???!!! De mon côté, quand je pars en voyage et qu’on me fait remarquer que je suis chanceux d’être mon propre patron, « d’être à mon compte » et de pouvoir partir à ma guise (!), je rappelle aux gens les 80 heures de travail sur plusieurs semaines que j’ai dû enligner pour pouvoir partir… en sans solde. Parce qu’un consultant, ça n’a pas de salaire fixe. Je ne me lamente pas une miette. J’adore ce que je fais et ne ferais jamais rien d’autre, mais de banaliser le geste, de réduire les efforts que les gens font pour arriver à leurs fins me fait suer. Créez votre propre « chance » et laissez aux autres le mérite de leurs réalisations. Cessez de vous lamenter en pleurnichant au monde entier de ne pas avoir de chance et foncez. Faites de quoi. J’ai des clients qui se réinventent tous les jours. Des clients qui n’attendent pas que la compétition les somme de bouger avant de le faire. J’ai des amis qui prennent des initiatives qui les sortent de leur zone de confort. Des amis qui prennent des risques. Des chums qui mettent leur petit train-train en péril, histoire d’améliorer leur sort. Ce que vous analysez comme de la chance, moi j’appelle ça du mérite. Et pour le gagner ce mérite, faut y mettre les efforts. Il faut y croire et se jeter dans le vide. Quitte à prendre des risques. Gagner à la loto, c’est peut-être de la chance, mais je n’ai jamais vu personne gagner sans avoir acheté un billet…
Prenez ça comme une montée de lait ou comme un signe d’incompréhension et d’intolérance, mais je ne suis plus capable d’entendre le monde parler de la chance comme étant l’unique élément du succès d’un tiers. Pu capable. Y a pas une journée où à la suite de l’affichage d’un profil Facebook d’un de mes potes annonçant une bonne nouvelle que je ne lis pas en commentaire : « Hoooo t’é ben chanceux! » « Ahhhh, maudit chanceux, va! » Hey. Y a toujours ben des limites à mettre les bons coups des gens sur le compte de la chance, bordel. En plus de dénaturer la réalisation, ça enlève tout le mérite à la personne concernée. Shit. À une amie qui lâche son boulot au Saguenay pour tenter un nouveau projet à Montréal : « Chanceuse de pouvoir déménager, moi je pourrais pas! ». Ha non, tu pourrais pas? Pfff. Tu penses que ç’a été facile pour mon amie de tout lâcher pour poursuivre son rêve??? À un autre ami qui annonce fièrement qu’il s’en va un mois en Europe : « Chanceux, toujours les mêmes en vacances! ». Chanceux? Take The Money And Run, My Friend. Tu as idée des efforts que ça lui a pris pour faire ça???!!! De mon côté, quand je pars en voyage et qu’on me fait remarquer que je suis chanceux d’être mon propre patron, « d’être à mon compte » et de pouvoir partir à ma guise (!), je rappelle aux gens les 80 heures de travail sur plusieurs semaines que j’ai dû enligner pour pouvoir partir… en sans solde. Parce qu’un consultant, ça n’a pas de salaire fixe. Je ne me lamente pas une miette. J’adore ce que je fais et ne ferais jamais rien d’autre, mais de banaliser le geste, de réduire les efforts que les gens font pour arriver à leurs fins me fait suer. Créez votre propre « chance » et laissez aux autres le mérite de leurs réalisations. Cessez de vous lamenter en pleurnichant au monde entier de ne pas avoir de chance et foncez. Faites de quoi. J’ai des clients qui se réinventent tous les jours. Des clients qui n’attendent pas que la compétition les somme de bouger avant de le faire. J’ai des amis qui prennent des initiatives qui les sortent de leur zone de confort. Des amis qui prennent des risques. Des chums qui mettent leur petit train-train en péril, histoire d’améliorer leur sort. Ce que vous analysez comme de la chance, moi j’appelle ça du mérite. Et pour le gagner ce mérite, faut y mettre les efforts. Il faut y croire et se jeter dans le vide. Quitte à prendre des risques. Gagner à la loto, c’est peut-être de la chance, mais je n’ai jamais vu personne gagner sans avoir acheté un billet…
Start Spreading The News, I am Leaving… Tomorrow. Je m’en vais tester ma capacité à vivre sous l’humidité excessive de New York. Mais j’y vais aussi pour ses restos, ses boutiques, ses shows… De retour mardi. Chanceux, moi? Mets-en!
Billets que vous pourriez aimer
Women like my type.
 Hum. Allez, je ne veux pas faire mon macho ni me vanter, mais c’est exactement ce qui se passe dans un dossier sur lequel je travaille depuis une couple de mois. Les femmes raffolent du caractère que je leur propose depuis le début de ce contrat. Elles adorent la poésie de mes lettres…
Hum. Allez, je ne veux pas faire mon macho ni me vanter, mais c’est exactement ce qui se passe dans un dossier sur lequel je travaille depuis une couple de mois. Les femmes raffolent du caractère que je leur propose depuis le début de ce contrat. Elles adorent la poésie de mes lettres…
Je vous taquine. Il n’est pas question de moi, mais de « type ». De typo. De typographie, en bon français. Le mandat sur lequel je planche est une refonte graphique totale pour un client très connu de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous saurez le nom de celui-ci quand ça sera terminé. Ce qui est particulier, c’est que je travaille avec 3 femmes et qu’elles ont toutes les trois développé un goût poussé pour la belle typo, s’exclamant sur la forme d’un t capital par rapport à une minuscule; du délié* d’une lettre par rapport à une autre. Trouvant qu’une minuscule est trop frêle et que la majuscule est trop sévère. Je trouve ça cool. En fait, j’aime bien quand mes clients mettent leurs grains de sel et s’intéressent au projet en se l’appropriant. J’aime ça perdre le contrôle. Et c’est tout à fait normal, parce que moi j’ai d’autres mandats qui m’attendent tandis qu’eux devront vivre avec toutes ces nouvelles règles que l’on établit. Si ils sont directement responsables et d’accord avec les décisions qui se prennent, ils seront plus en mesure de les appliquer et d’en assurer la pérennité. C’est logique.
Pour revenir à ses clientes qui aiment les belles lettres, ce qui me plaît par-dessus tout c’est la reconnaissance, de leur part, des particularités spécifiques et communicationnelles de la typographie. Leur compréhension quant au choix des graisses** et surtout de la possibilité de créer des contrastes, des couleurs, uniquement en jouant avec celles-ci. Comprendre aussi la possibilité d’unicité quant au choix typographique. Je tente de plus en plus d’inculquer à mes clients la pertinence de s’approprier une fonte particulière afin de se donner une image bien à eux. C’est souvent subtil pour bien des gens, mais le travail se fait quand même. Prenez le cas de refonte graphique de Bell. La mise en place de sa nouvelle plateforme graphique a été réalisée avec une typographie construite uniquement pour l’entreprise. En plus de lui donner une couleur tout ce qu’il y a de plus personnel, elle permet à la longue, une reconnaissance immédiate de la marque. Si c’est vrai pour une grosse entreprise comme Bell qui dépense énormément en publicité, ça l’est encore plus pour une plus petite. Moins une entreprise investit en publicité, plus elle se doit d’être rigoureuse quant à sa la reconnaissance de sa marque. Facile pour une entreprise comme Nike de changer de « look » selon sa gamme de produits avec sa capacité publicitaire, moins facile pour une entreprise microscopique avec un budget rudimentaire. Simple calcul.
Un de mes premiers billets parlait de l’importance de la typographie dans la communication graphique. C’est l’élément qui départage le plus les autodidactes des professionnels du métier : le choix typographique, le respect de la forme, le bon crénage*** », etc. En plus, ça plaît aux femmes. Sometimes, woman fall in love with a great type…
* Le délié correspond en typographie à la partie la plus fine d’un caractère, en opposition au plein (typographie). Le délié correspond à la largeur de ligne d’une plume tirée horizontalement, et a été repris par les typographes pour la création de caractères.
** En typographie, la graisse est l’épaisseur d’un trait ou d’un caractère. En augmentant la graisse d’un caractère maigre, on obtient un caractère demi-gras, puis gras, et ainsi de suite.
*** Dans le domaine typographique, le crénage (kerning) est l’ajustement de l’espace entre les lettres d’une police à chasse variable. Dans une police bien crénée, l’espace entre deux lettres est identique, quelle que soit la paire de lettres considérée. Dans une fonte de caractère (numérique) créée dans les règles de l’art, le crénage est fait manuellement par le fondeur pour toutes les paires de caractères une à une. Dans le cas contraire, les logiciels de gestion de fonte peuvent le faire automatiquement, mais cela donne un moins bon résultat.Les paires de caractères doivent être testées et réglées dans les deux combinaisons possibles (par exemple ab et ba), l’espace à droite et à gauche de chaque caractère étant souvent différent en fonction de sa forme. Enfin, certaines lettres doivent se toucher comme les doubles t, double f ou fi (tt, ff, fi) : ce sont les ligatures.
(source Wikipédia)
Billets que vous pourriez aimer
Mon défi à moi.
 Grenville, Québec — Samedi, 19 juin – 22 h 30. Pour la troisième fois en moins d’une demi-heure, je dois aller faire pipi. Je veux bien croire que j’ai bu pas mal d’eau depuis les dernières heures, mais pas autant pour provoquer un tel déluge. Je soupçonne un brin de nervosité. Derrière les portes fraîchement peintes rouge pompier des salles de bain de la bibliothèque municipale de cette petite bourgade de 750 habitants, je me contorsionne du mieux que je peux pour me soulager. Pas facile de pisser quand on porte un bib et un jersey de vélo. En me lavant les mains, je regarde mon visage dans le miroir, un mélange de fatigue et de stress sous les yeux. Je suis à moins d’une demi-heure de prendre part à ma troisième étape pour le Grand Défi Pierre Lavoie, la plus importante pour moi : les 95 km reliant Grenville à Gatineau, de 23 h 15 à 2 h 45. Mon étape précédente — Victoriaville — Drummondville m’a pompé à bloc, faisant tomber une charge de stress énorme que je traînais depuis le début de mon aventure. Je vérifie les poches de mon jersey: j’ai mon Ventolin, des blocs énergiques et une banane préépluchée — j’ai pas pris de chance, je ne me sens pas encore l’agilité de le faire avec une main en roulant à plus de 30 km/h dans un peloton de 300 cyclistes… J’enfourche mon vélo et me rapproche des cyclistes déjà enlignés dans le peloton. Je vois arriver Jay, le nounou-chauffeur-coordonnateur de notre équipe, avec la lumière que je dois apposer sur mon vélo. Pendant cette épreuve de nuit, chaque cycliste en a une d’accrochée à sa monture. Rien de nouveau pour moi, j’ai fait le dernier tiers de mon épreuve de la veille (Québec-Ste-Marie) avec ce bidule sur le guidon. Jay, comme à son habitude, m’encourage en me disant que ça ira bien. Je le crois, à moitié. Alors que les derniers cyclistes s’accrochent au peloton de départ, Pierre Lavoie s’adresse à la population les remerciant de leur accueil et nous rappelant les consignes de sécurité pour notre étape. On commence à détecter une frénésie parmi les cyclistes, le départ est imminent. Le QG, cet immense véhicule qui nous précède sur la route se place tranquillement. L’animateur nous annonce le départ dans moins d’une minute. Certains cyclistes prennent une dernière gorgée, d’autres clipsent un pied sur une pédale pendant que je regarde Jay et ma partenaire Nathalie de qui je prends le relais, me faire des thumbs up. 5, 4, 3, 2, 1… Voilà, on est parti. Notre troupeau désorganisé roule quelques centaines de mètres avant de se discipliner. Quelques cyclistes prennent le peloton avant d’assaut, tentant désepéremment de rejoindre la tête, histoire de bénéficier de l’effet de traction maximum sans subir l’effet élastique du fond. Ça dépasse dans tous les sens. Je passe des premiers rangs au milieu, mais je m’en fous. Je maîtrise mieux comment ça fonctionne maintenant et me faire dépasser n’a plus un effet négatif sur ma course; je sais comment me gérer par rapport aux autres. Le parcours fut fantastique. 155 cyclistes roulant de nuit, trois par trois, traversant des villages où des habitants encore sur leur balcon à cette heure si tardive, nous saluent et nous encouragent. Nous avons gagné Gatineau, notre objectif, avec quelque huit minutes d’avance, sans encombre. Dans les douches de l’école qui nous reçoit, les cyclistes parlent de leurs parcours, racontent comment ça s’est passé pour eux. Certains vont déjeuner tout de suite, d’autres, comme moi, prennent le chemin de leur VR pour dormir une couple d’heures avant la prochaine étape.
Grenville, Québec — Samedi, 19 juin – 22 h 30. Pour la troisième fois en moins d’une demi-heure, je dois aller faire pipi. Je veux bien croire que j’ai bu pas mal d’eau depuis les dernières heures, mais pas autant pour provoquer un tel déluge. Je soupçonne un brin de nervosité. Derrière les portes fraîchement peintes rouge pompier des salles de bain de la bibliothèque municipale de cette petite bourgade de 750 habitants, je me contorsionne du mieux que je peux pour me soulager. Pas facile de pisser quand on porte un bib et un jersey de vélo. En me lavant les mains, je regarde mon visage dans le miroir, un mélange de fatigue et de stress sous les yeux. Je suis à moins d’une demi-heure de prendre part à ma troisième étape pour le Grand Défi Pierre Lavoie, la plus importante pour moi : les 95 km reliant Grenville à Gatineau, de 23 h 15 à 2 h 45. Mon étape précédente — Victoriaville — Drummondville m’a pompé à bloc, faisant tomber une charge de stress énorme que je traînais depuis le début de mon aventure. Je vérifie les poches de mon jersey: j’ai mon Ventolin, des blocs énergiques et une banane préépluchée — j’ai pas pris de chance, je ne me sens pas encore l’agilité de le faire avec une main en roulant à plus de 30 km/h dans un peloton de 300 cyclistes… J’enfourche mon vélo et me rapproche des cyclistes déjà enlignés dans le peloton. Je vois arriver Jay, le nounou-chauffeur-coordonnateur de notre équipe, avec la lumière que je dois apposer sur mon vélo. Pendant cette épreuve de nuit, chaque cycliste en a une d’accrochée à sa monture. Rien de nouveau pour moi, j’ai fait le dernier tiers de mon épreuve de la veille (Québec-Ste-Marie) avec ce bidule sur le guidon. Jay, comme à son habitude, m’encourage en me disant que ça ira bien. Je le crois, à moitié. Alors que les derniers cyclistes s’accrochent au peloton de départ, Pierre Lavoie s’adresse à la population les remerciant de leur accueil et nous rappelant les consignes de sécurité pour notre étape. On commence à détecter une frénésie parmi les cyclistes, le départ est imminent. Le QG, cet immense véhicule qui nous précède sur la route se place tranquillement. L’animateur nous annonce le départ dans moins d’une minute. Certains cyclistes prennent une dernière gorgée, d’autres clipsent un pied sur une pédale pendant que je regarde Jay et ma partenaire Nathalie de qui je prends le relais, me faire des thumbs up. 5, 4, 3, 2, 1… Voilà, on est parti. Notre troupeau désorganisé roule quelques centaines de mètres avant de se discipliner. Quelques cyclistes prennent le peloton avant d’assaut, tentant désepéremment de rejoindre la tête, histoire de bénéficier de l’effet de traction maximum sans subir l’effet élastique du fond. Ça dépasse dans tous les sens. Je passe des premiers rangs au milieu, mais je m’en fous. Je maîtrise mieux comment ça fonctionne maintenant et me faire dépasser n’a plus un effet négatif sur ma course; je sais comment me gérer par rapport aux autres. Le parcours fut fantastique. 155 cyclistes roulant de nuit, trois par trois, traversant des villages où des habitants encore sur leur balcon à cette heure si tardive, nous saluent et nous encouragent. Nous avons gagné Gatineau, notre objectif, avec quelque huit minutes d’avance, sans encombre. Dans les douches de l’école qui nous reçoit, les cyclistes parlent de leurs parcours, racontent comment ça s’est passé pour eux. Certains vont déjeuner tout de suite, d’autres, comme moi, prennent le chemin de leur VR pour dormir une couple d’heures avant la prochaine étape.
Des histoires comme celle-ci, tous les coureurs du Grand Défi Pierre Lavoie en ont plein la tête depuis leur retour. Chacun a fait « son défi » dans le Défi. Chaque cycliste a réussi à aller plus loin que ce qu’il pensait pouvoir réaliser. C’est ce qui rend cette expérience unique selon moi.
Je tiens à remercier Chlorophylle de m’avoir inclus dans leur équipe. Merci à mes partenaires : Marc, Régis, Nathalie, Katy et Jay. Merci aux 150 bénévoles du Grand Défi qui nous ont dorlotés tout le long du parcours. Merci à Pierre Lavoie pour ce grand défi qu’il a décidé de partager…
Billets que vous pourriez aimer
Le Monde veut te voir.
 C’est sous ce thème que le Festival des Rythmes du Monde lançait sa programmation 2010, aujourd’hui même. Devenu un véritable produit d’appel touristique pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme le démontre son adhésion au club sélect du RÉMI (Regroupement des événements majeurs internationaux du Québec), le FIRM fera danser et chanter la population du 29 juillet au 8 août prochain. Pour l’occasion, un nouveau présentateur (Loto-Québec), une nouvelle image et un tout nouveau site internet.
C’est sous ce thème que le Festival des Rythmes du Monde lançait sa programmation 2010, aujourd’hui même. Devenu un véritable produit d’appel touristique pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme le démontre son adhésion au club sélect du RÉMI (Regroupement des événements majeurs internationaux du Québec), le FIRM fera danser et chanter la population du 29 juillet au 8 août prochain. Pour l’occasion, un nouveau présentateur (Loto-Québec), une nouvelle image et un tout nouveau site internet.
Le thème «Le Monde veut te voir» prend tout son sens quand on comprend que c’est l’occasion qui s’offre au Festivalier : celle de se faire visiter par des gens de cultures différentes. C’est comme voyager à l’envers. Le Monde vient visiter le Saguenay par ses artistes, chanteurs et musiciens. Pour ceux qui ont déjà participé au Festival, la deuxième signification du slogan est facile à comprendre : y a du monde à voir et à rencontrer!
Pour l’image, comme à mon habitude pour le Festival j’ai mis l’accent sur la couleur, le mouvement… et une touche d’humour. En créant un personnage à partir d’instruments de musique multiethniques, cela me permettait de pouvoir faire dire le slogan à celui-ci et de rendre le design plus sympathique.
Pour le site internet, programmé par Jonathan Dubé (pas de site… cordonnier mal chaussé!), une nouveauté intéressante est celle de pouvoir créer son propre horaire afin de ne rien manquer pendant ces deux semaines intensives. Il faut le visiter souvent puisque plein de nouveautés viendront s’y greffer jusqu’au festival.
Pour ce qui est des artistes à ne pas manquer (et c’est un choix bien personnel…) : Diblo Dibala du Congo, Ky-Mani Marley (le fils de Bob…) de Jamaïque, Wesli d’Haïti, Kaba Huro de la Bulgarie… et bien sûr les Gipsy Kings!
Si vous planifiez des vacances au Saguenay, la fin juillet est le meilleur temps et vous ferez d’une pierre deux coups en découvrant des cultures, des rythmes et surtout, des gens différents!
Billets que vous pourriez aimer
Merci™
 Thérapie 2.0.
Thérapie 2.0.
Merci pour tous ces bons mots; ici, sur le blogue de Patrick Lagacé, par mail et sur Facebook ou de vive voix. J’ai décidé de vous répondre par ce billet au lieu de le faire un à un. Par pudeur, j’imagine. J’avoue qu’écrire le précédent billet, si difficile soit-il a eu un effet assez bénéfique sur moi. De le diffuser, encore plus. J’ai toujours été mal à l’aise de raconter ou de discuter de cet épisode de ma vie. À 14 ans, j’avais plié ce souvenir, tel un petit mouchoir, et l’avait placé dans un coin de ma tête. En tentant de le cacher. Comme si c’était une tare. Je fuyais les discussions que mes parents voulaient engager. Je les fuis encore, ma mère vous dirait. Mais disons que ce témoignage est un début d’ouverture de ma part. Après 31 ans. Ce qui m’a fasciné dans vos commentaires, outre ceux des parents qui faisaient de l’introspection par rapport à leurs propres enfants, ce sont ces gens qui ont vécu des tragédies semblables, qui ont côtoyé la mort d’un proche. J’ai senti par leurs témoignages que je les avais peut-être aidés à sortir eux aussi de leur bulle l’espace d’une petite lecture. Prenons-le comme une thérapie de groupe… en ligne.
Parent Étoile
Un commentaire qui m’a particulièrement touché est celui de Sylvie Hamel; elle s’occupe de jeunes qui vivent des deuils. Je trouve ça bien qu’un organisme de la sorte existe. Quand on est plus jeune, je ne pense pas que nous ayons la force nécessaire pour relativiser et le résultat est souvent que la blessure reste béante sans espoir de guérison. Si ce billet sert à faire connaître le travail de Mme Hamel, ça n’aura pas été en vain. Si vous avez 2 minutes, visitez son site…
Marc vs. Traitdemarc
Je comprends que certains d’entre vous arrivent sur ce site parce que vous vouliez connaître un peu mieux mon travail, vérifier mes compétences, voir mon porte-folio, avoir un juste portrait de la business que je fais. Et vous voilà tombé sur un témoignage thérapeutique. Et c’est tant mieux. Je pense que nous travaillons avant tout avec des individus, pas des compagnies. Que les relations que nous bâtissons comme client/fournisseur ne le sont pas uniquement sur des compétences, mais sur des valeurs partagées. Que vous connaissiez cet épisode de ma vie maintenant, vous donne juste un peu plus d’info sur la personne que vous vous apprêtez à engager. Un portrait plus global qu’une carte d’affaires et un CV blanc comme neige. Human Touch.
> L’illustration vient du site de Parent Étoile
Billets que vous pourriez aimer
En 1979, je suis devenu un homme.
Falardeau. 9 juin 1979 2 h du matin. On cogne à la porte de notre roulotte. Comme chaque été, notre petite famille commençait sa saison de camping et nous avions, pour l’occasion, élu domicile sur le terrain municipal de Falardeau. En fait, je dis famille, même si elle n’était pas vraiment complète : mon père, ma mère et moi étions déjà sur place, mais ma soeur devait venir nous joindre plus tard dans la fin de semaine.
Le 9 juin 1979 à 2 h du matin, on a cogné à la porte de cette roulotte et notre vie a basculé.
À l’extérieur, mon oncle Philippe disait à travers la porte qu’il devait parler à mon père, que c’était important. Ma mère, à l’intérieur, tout en s’habillant lui criait qu’il pouvait parler devant elle et qu’elle voulait savoir, elle aussi. Elle savait déjà de toute façon. En ouvrant la porte, ma mère aperçut son frère, la face livide, accompagné de deux policiers. On venait nous annoncer l’inconcevable. On venait nous annoncer que sur la route qui menait au terrain de camping, un accident avait eu lieu. Un accident mortel.
Le 9 juin 1979, à 2 h du matin, ma mère sous le choc, m’a réveillé en me brassant et me disant : « Marc, réveille-toi, ta soeur a eu un accident voiture, ta soeur est morte… » Morte. Je ne comprenais rien. J’étais endormi. J’avais peur. Je pleurais. Dans la roulotte ma mère et mon oncle étaient en larmes, mon père restait immobile et les policiers nous demandaient de les accompagner dans leur voiture.
Dans le voyage qui nous ramenait à la maison, blotti entre mes parents, y avait une phrase qui se répétait à l’infini dans ma tête : « ta soeur est morte… ». « … ta soeur est morte… ». Un écho funéraire. Notre famille complète pouvait dorénavant tenir sur la banquette arrière d’un Crown Victoria. À ma droite ma mère était inconsolable. À ma gauche, mon père était complètement ailleurs. Luttant contre des années de sentiments refoulés, je sentais qu’une explosion à l’intérieur de lui allait se produire. En 1979, un homme, ça ne pleurait pas. En 1979, un homme n’avait pas les outils nécessaires pour réparer un coeur, surtout pas le sien.
Le 9 juin 1979 vers minuit, en route vers le terrain de camping, l’ami de ma soeur négociait une courbe dangereuse à une vitesse élevée et perdait le contrôle de sa voiture. Quelques heures plus tard, sur la même route, en sens inverse, nous tentions tant bien que mal de garder la route de notre propre vie.
Il y a eu beaucoup de publicités de la part de La Société de l’assurance automobile du Québec. Des pubs dures. Des pubs extrêmes. Des pubs à la limite du tolérable. Mais aucune n’est venu me chercher comme celle-là. Peut-être parce que j’ai maintenant des enfants à l’âge que ma soeur est décédée. Peut-être que je réalise maintenant quel parcours difficile mes parents ont dû affronter après cette épreuve difficile. Comment les dommages collatéraux de ces accidents sont immenses et indélébiles.
J’ai longtemps gardé cette histoire au creux de moi. Très peu de mes amis m’ont entendu la raconter. Avec le temps, va, tout s’en va, disait Ferré. Avec le temps, on apprend surtout à comprendre des trucs, à mieux cerner les gens. À comprendre que ces épreuves les façonnent et changent des vies. Que de les partager peut aider les autres à mieux comprendre les leurs.
Le 9 juin 1979 à 2 h, je suis demeuré, à l’extérieur, un adolescent de 14 ans enjoué et boutonneux, mais à l’intérieur un homme qui, comme son père, n’avait pas encore la maturité pour avaler son destin en une si grande bouchée…



















