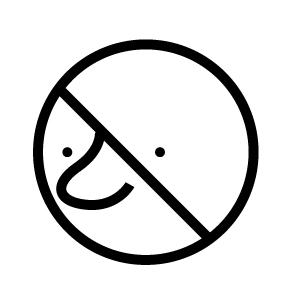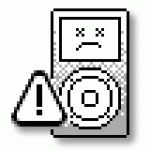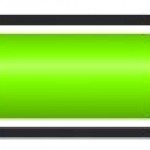Mini-Wheat
 Je suis capable du meilleur. Comme du pire.
Je suis capable du meilleur. Comme du pire.
Gentil comme deux. Teigneux comme pas un.
J’ai autant de caractère que je suis mou.
Je suis de conversation insatiable. Vous chercherez le bouton pause sur ma gueule. Bla bla bla. Introuvable. Je suis aussi muet qu’une carpe. Yeux absents. Silencieux.
Je suis workaholic. Alignant les heures de travail. 12 heures par jour. 7 jours sur 7. Je suis lâche comme un âne. Préférant regarder pousser le gazon, plutôt que de le couper. Une larve.
Je ris à m’en décrocher la mâchoire. Je pleure à m’en fendre l’âme.
Je cours 15 km sans boire. Je bois à être incapable d’aligner deux pas.
J’ai encore des articles de cuisine que ma mère m’a légués quand j’ai quitté le nid familial à 19 ans. Je suis capable de dépenser une fortune pour un gadget que je n’utiliserai jamais.
J’aime le soleil au lever. J’adore m’endormir sous la pluie.
J’écoute de la musique partout : au bureau, à la maison, dans mon auto, en course. J’adore me retrouver tout seul dans le silence.
J’ai des clients qui me trouvent performant. J’ai des clients qui me courent après.
Pour les artistes, je suis en business. Pour le gens d’affaires, je suis un artiste.
Je mange bien. Je mange de la marde.
Je suis de droite, économiquement parlant. Je suis de gauche, socialement parlant.
J’aime aider les plus démunis. Comme je voudrais parfois leur botter le cul.
Je suis d’une simplicité involontaire. Je suis d’une complexité volontaire.
Je suis ici à rêver d’ailleurs. Je voudrais être ailleurs pour m’ennuyer d’ici.
Je ne voudrais pas vieillir. Je ne voudrais pas revivre ma jeunesse.
Je ne m’ennuie pas de mes enfants. Je pleure quand je les vois.
Je suis patient, capable de recommencer un truc des milliers de fois. Je capote à l’idée de refaire la même routine.
Parfois je trouve la vie si lourde. Parfois je constate que le temps passe trop vite.
Je suis trop vieux pour faire ça. Je suis trop jeune pour penser à ça.
Les jeunes m’énervent parce qu’ils ont raison. Les vieux m’emmerdent parce qu’ils ont raison.
Dans une grande ville, j’aime les parcs. En forêt, la ville me manque.
Je voudrais être quelqu’un d’autre. Je trouve que les autres ne sont pas mieux que nous.
Je suis un solitaire qui aime le monde.
Je ne fais pas l’unanimité.
On m’aime. On ne m’aime pas.
Je suis plein de contrariétés.
Full.
Je suis un Mini-Wheat.
Sain. Malsain.
Moins funny qu’une Froot Loops. Moins plate qu’une Special K.
Capable d’être sérieux. Incapable de l’être.
Éclectique.
Tissé d’une fibre de blé. Enrobé de sucre.
Et fier de l’être.
Côté positif. Côté négatif.
Un amalgame de qualités et de défauts.
Ying et yang. Noir et blanc. Abbott and Costello.
Je me méfie des gens unidimensionnels. Aux idées arrêtées. Incapables d’incartades. Comblés dans leurs certitudes. Convaincus de leurs croyances. Rarement plurielles.
Je pense que nous sommes multidimensionnels. Des diamants aux facettes multiples. Capables de refléter des nuances différentes. Surtout aptes aux actions irrationnelles, aux idées nouvelles. Surtout plurielles.
Je suis un Mini-Wheat.
Billets que vous pourriez aimer
Le ton des mots
 J’ai écrit ce courriel avec l’aplomb d’un avocat.
J’ai écrit ce courriel avec l’aplomb d’un avocat.
J’ai relu chaque phrase, en prenant le temps de changer un mot précisant mal ma pensée, en choisissant un autre pour le remplacer pour m’assurer que l’idée générale de mon propos soit respectée et encore plus précise.
Je l’ai gardé dans ma boîte de brouillons quelques jours.
Une boîte à bouillon. Parfaite pour mariner des mots. Ça leur donne du goût et une consistance. Ça permet de donner de la saveur à un texte. Une pertinence. Ajoutez une pincée de virgules et le tour est joué.
J’ai ressorti le courriel pour une dernière lecture. J’en ai profité pour ajouter quelques smiley pour m’assurer que les endroits dans le texte où mon discours était plus léger seraient perçus comme tels. C’est comme ajouter du rire en canne dans un sitcom. Hey, c’est le temps de rire si tu ne le savais pas. On n’est jamais trop prudent quand on écrit un texte important. Quand on veut éviter toutes mauvaises interprétations.
Relire son texte. Cliquer sur envoyer. Pioup. Courriel en route. Attendre la réponse.
Qui ne vient pas.
Au bout de quelques jours, j’appelle la personne auquel le courriel était destiné.
– Allo, tu vas bien? T’as reçu mon mail?
– Oui. J’ai décidé d’attendre une couple de jours avant de te répondre. Le temps de le digérer. Pour ne pas écrire sous le coup de l’émotion…
– Heu… On parle du même courriel? Celui de lundi?
– Ouais. Je savais pas trop quoi en penser.
En penser quoi?
Coudonc.
Cette missive était claire comme de l’eau de roche. Des mots choisis un à un, avec parcimonie. J’ai jardiné dans Le Larousse. Des phrases construites avec la précision d’un chirurgien. Des blagues faciles à comprendre, avec des petites binettes (comme l’OQLF veut qu’on écrive emoticon), pour savoir que ce petit bout de texte est mis là pour adoucir le ton du discours. Dans un ton déjà hyper molo.
Selon moi.
Faut croire qu’il était uniquement sans ambiguïté pour moi. Pas pour son destinataire.
En cette ère numérique où jamais mots ne se seront autant échangés: par courriel, texto, tweet et statuts Facebook, combien de mauvaises compréhensions, imbroglios créés à coup de mauvaise sémantique, intonation, ponctuation, syntaxe?
Toute cette littératie. Le niveau de celui qui écrit, de celui qui reçoit. Tous ces mots aux différentes significations, écrits sur le coup de la colère, ou celui de l’humour. Tous ces degrés de lecture où l’ironie est perçue comme une insulte, ou un compliment exprimé comme une gifle.
Tous ces mots qui se changent en maux.
Tu m’énerves. Ça peut dire que tu me tombes sur les nerfs. Ça peut aussi dire que tu me plais. Tout dépend du contexte.
Vous envoyez un courriel que vous considérez anodin et vous déclenchez une guerre nucléaire. Boum. L’effet papillon multiplié par 1000. Un mot mal placé et vous changez le rythme d’un échange. Guerre et paix. Guère et pet. Et voilà. Vous êtes dans la merde.
Quand tu t’adresses à une seule personne, ça peut aller. Surtout si tu la connais, car tu peux adapter le niveau du texte à celui du lecteur. Quand tu t’adresses à une foule, comme on le fait en pub, vous imaginez le nombre d’interprétations auxquels votre slogan ou campagne peut avoir? C’est fou. Et déroutant.
Vous voulez savoir comment s’est terminée mon histoire?
La personne ne me parle plus. Fin. Plus de nouvelles. Rien. Malgré mes explications directes, mon point de vue exprimé au téléphone. Rien n’a changé. Son point de vue est demeuré le même. Intrinsèque. Mon courriel est resté logé dans sa gorge. Incapable de le digérer. Intolérance à ma grammaire. Lettre morte. Oraison funèbre. Fin.
Les paroles s’envolent et les écrits restent.
Imaginez quand ils sont, en plus, mal compris.
Ça devient des restes d’écrits qui s’envolent sans paroles.
Billets que vous pourriez aimer
Les mille et une vies
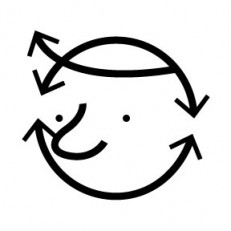
J’ai déjà acheté un banc de scie. Une scie sauteuse. Une scie circulaire. Une scie à onglets. Quatre ou cinq perceuses. Des équerres. Des serre-joints. Mille et un machins. Vis, clous, armatures et bois.
J’ai déjà été un vrai gars.
Comme mes chums.
Avec une remise et un établi.
Le samedi matin, j’allais chez Rona et chez Canadian Tire où je croisais des gars comme moi.
Dans une autre vie, j’étais un gars de maison. Avec tous ses outils accrochés fièrement au mur, le sac à clous à la ceinture, le crayon sur l’oreille.
Aujourd’hui, juste l’idée de visser une ampoule me lève le cœur.
Je déteste rénover.
Regarder la circulaire d’une quincaillerie me fait autant bander que tous les tomes de Fifty Shades Of Grey. En images.
Mes outils sont éparpillés un peu partout. Je n’ai souvent aucune idée à quoi servait un truc que j’ai acheté des années auparavant. Et je m’en fous.
Je ne suis plus là. Ma vie est ailleurs.
Je me suis déjà acheté un sac de golf. Des bâtons à l’unité sur eBay. Driver. Sand Wedge. Putter. Des quantités de sortes de balles. Pour corriger une déviation. Aller plus loin. Rouler plus longtemps. Nike. Taylor Made. Tiltest.
On jouait le samedi matin aux aurores. Toujours les mêmes quatre compères. On allait déjeuner vers 6h et jouer sur les terrains qu’on réussissait à réserver dans des villes différentes. Éric, Michel, Steve. Sous le soleil. Sous la pluie.
Puis, j’ai sauté une semaine.
Deux.
Un mois.
Un été.
En allant dans la remise, j’ai vu mon sac.
Un écureuil a bouffé la serviette accrochée à celui-ci. Mes bâtons sont demeurés couverts de boue. Celle de ma dernière partie jouée sous la pluie. Mon sac se balançait sur un clou comme un pendu. Effigie d’une vie antérieure.
Dans une autre vie, j’étais un golfeur. Un très mauvais.
Aller au golf, maintenant? Bof. Une fois par année, avec des chums pour une activité caritative. Un prétexte pour les voir à l’après-golf. Uniquement.
Quand j’ai commencé ma carrière en pub, j’étais de toutes les activités de réseautage d’affaires. Les soupers de Chambre de Commerce. Le serrage de mains. Échanges de cartes de visite. Promesses de rendez-vous. Contrats accordés par référence.
Avec mes pantalons à plis et mes chemises à rayures. Je n’y étais pas très à l’aise, mais fallait y être. Pour les affaires. Alors, le soldat en moi y allait.
Je n’y ai pas mis les pieds depuis des années.
Et je fais toujours des affaires. Même si je rencontre des gens tout en oubliant de leur donner des cartes.
Dans une autre vie, j’étais un homme d’affaires.
Plus maintenant.
Je suis toujours dans le même domaine, mais je suis différent. On m’engage parce qu’on aime bien ce que je fais. Mon style. Ma vision. Pas parce que j’ai payé un verre ou soupé dans une activité. Je travaille en short ou en jeans. En t-shirt. Souvent mal rasé. Les cheveux en bataille. En me faisant demander, chaque jour, si je suis en vacances.
J’ai déjà détesté l’hiver à m’en confesser.
J’ai déjà adoré l’hiver à lisser une patinoire à -35 tous les soirs pour amuser les enfants.
J’ai déjà redétesté l’hiver parce qu’il était simplement long à en plus finir.
J’ai quitté la région pour habiter la ville en crachant au sol, jurant ne jamais y revenir. Pour y revenir. J’ai détesté la campagne jusqu’à ce que j’y habite pour affirmer que je n’y retournerais jamais. Je ne voulais pas d’enfants, j’en ai deux merveilleux dont je ne voudrais jamais me séparer.
À l’aube de mes cinquante ans, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu plein de vies différentes.
À aimer des trucs que je déteste aujourd’hui.
À détester des choses que j’adore aujourd’hui.
Des moments enivrants, difficiles, joyeux, affreux ou déroutants. Bien pépère, le cul dans un gros fauteuil confortable ou à la limite du vertige, la fesse sur une chaise bancale sur un fil de fer.
Tels des chats, nous avons cette faculté de revivre. De retomber sur nos pattes. Malgré des chutes dont on ne croyait jamais se remettre. Au lieu de s’écraser, à rebondir ailleurs. Plus loin. À avancer ou reculer. Nos vies ne sont pas linéaires ni chronologiques. On peut apprendre la mort tout jeune et commencer une carrière à l’âge de la retraite. Nos vies se succèdent. À grands coups de reniements. À grands coups de jamais et de toujours. Pour finalement prendre des directions insoupçonnées. À se remodeler selon les gens qui nous entourent, les passions qu’on découvre, avec la maturité qui nous rassure de plus en plus sur nos choix.
Je ne sais pas où je serai dans cinq, dix ou vingt ans.
Sûrement dans un autre cycle.
Ailleurs. Un peu plus près de moi.
Billets que vous pourriez aimer
Le vide
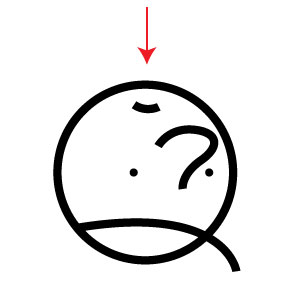 – Tu es certain que ça va? Ton dernier texte m’a fait peur, tu sais…
– Tu es certain que ça va? Ton dernier texte m’a fait peur, tu sais…
– C’est le premier texte que tu écris que je n’aime pas…
– Hey Marc, pas te connaître, je me dirais le mec qui a écrit ça, va se suicider.
Des remarques sur mon précédent billet.
Un texte que je pensais avoir écrit au second degré. Exagérant mes travers. Amplifiant un matin où tu te lèves du mauvais pied. Ce texte, même si senti, était bourré de clichés. Oui, un billet d’humour noir, mais surtout un texte qui détonnait avec l’image que je projette.
M. Sourire.
Positif. Posé. Rigolo.
L’image que je projette.
Ça paraît bien.
J’ai pourtant une part de moi plus sombre. Plus cachée.
Que je garde pour moi. La plupart du temps.
Ça vous surprend?
Hier, un ami annonçait sur Facebook qu’il prenait un congé au travail. Congé de maladie. Dépression ou burn-out. Impossible de savoir.
J’ai aimé lire ce statut.
Pas aimer qu’il soit malade. Ça, je n’aime pas. Mais d’écrire qu’il l’était, j’ai trouvé le geste beau. Et important. Parce que ce n’est pas une tare. D’être dépressif, angoissé, en détresse. Ni un truc tabou qu’il faut cacher à tout le monde. Non. Pas plus qu’il ne faut cacher qu’on est diabétique.
La maladie mentale est une maladie. Point à la ligne.
Une maladie qu’il faut soigner, certes, mais avant tout démystifier.
Une maladie qui se contrôle. Guérir? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais d’avoir la possibilité d’en diminuer les impacts négatifs sur sa vie et celles de ses proches, ça, j’en suis certain.
À la mort de ma sœur, mon père a sombré dans une dépression. Incapable de vivre les émotions qu’un tel drame apporte. Pas outillé sentimentalement, il a tombé dans le vide.
Comme on peut se noyer dans un chagrin trop profond.
Des amis autour de moi ont vécu ou vivent, eux aussi, des épisodes plus noirs de leurs vies.
Certains en vivent encore au quotidien. Un combat souvent difficile pour les uns, mieux contrôlé pour les autres.
Les gens que je connais qui sont aux prises avec le vide n’ont pas de points en commun par rapport aux causes de leurs désarrois. Non, ce ne sont pas tous des workholics, non ils n’ont pas tous vécu des peines d’amour, des mortalités ni de grandes déceptions, mais ils ont en commun un débalancement chimique au niveau du cerveau. Ça parait bête de dire ça comme ça, mais voyez ça comme le sucre par rapport au diabète.
Non, ce ne sont pas des personnes faibles. Ho non. Je peux vous parler de mon chum fort comme un bœuf, avec des mains grosses comme ma tête. Ni non plus des crétins. Je peux vous parler de cet autre ami, brillant dans son domaine, un chef de file, un chercheur. Comme cet autre, ce musicien, capable d’exprimer ses sentiments dans son art, mais incapable de les gérer par lui-même.
En y pensant bien, ces gens ont tout de même un point en commun. Celui d’avoir pris la décision d’en parler à leurs proches. Je ne veux pas utiliser le mot « courage » parce cette notion rapporte trop à un geste hors du commun. Alors que je pense qu’il faut davantage démontrer qu’en parler devrait être facile. Qu’aucun jugement ne viendra interférer avec ces confidences. Et c’est la clé importante. Nos jugements. Ou plutôt notre absence de.
Moi?
Je sais pas.
Mais il me semble que je serais dispo à ça. Il me semble avoir tout ce qui faut pour tomber dans le vide. Des années de reflux sentimentaux, des bogues de moi par rapport à moi non réglés, une masse de travail hors-norme, un manque de sommeil chronique, etc. Il me semble que j’ai à l’intérieur de moi tous les ingrédients dont un gars a besoin pour se concocter un passage à vide. Un cocktail à saveur de remise en question.
Et si ça m’arrivait, une chose est certaine : je ne voudrais surtout pas qu’on me juge.
Toi?
Billets que vous pourriez aimer
Mauvaise journée
 Y’a des jours où tu as l’impression d’être, comme dirait mon chum Alain, un pou dans la mélasse.
Y’a des jours où tu as l’impression d’être, comme dirait mon chum Alain, un pou dans la mélasse.
Pain in the ass comme disent les Anglais.
Rien ne va.
6h30. Les chiffres du cadran illuminent ta face.
Déjà.
Dans le lit, tu as la forme d’un bretzel. On dirait que tu es tombé d’un immeuble de 100 étages. Tes bras sont déconnectés tout autant que tes jambes. Tu es démembré. Si tu étais mort pendant ton sommeil, l’autopsie prouverait que tu t’es battu toute la nuit avec les bibites dans ta tête.
Le chien occupe 60% du territoire, ta blonde, 30%. Il t’en reste 10%, éparpillé un peu partout. Et ce même si tu représentes 50% de la masse totale. Ce qui explique ton état bretzel.
Tu t’es couché à 2h30.
Ton livre de chevet te scie la joue. Tu t’es endormi dessus.
Littéralement.
Ta bave servant de signet.
Ce livre dont tu devras relire les 50 dernières pages parce que tu les as lues dans un état semi-comateux en t’obstinant, les yeux dans l’eau, que tu finirais ce soir-là les 300 dernières restantes.
Tu te réveilles et à la radio, y a déjà un truc qui te fait chier.
Les nouvelles. La voix nasillarde de l’animatrice. Le mot mal prononcé qui te reste dans l’oreille. La toune poche. La météo.
Fuck.
Tu te dis que le monde, c’est lourd.
Tu te traines tout de même à la salle de bain.
Le miroir est inévitable.
Malgré les crottes dans tes yeux, tu vois tout ce qui dépasse et pend.
Les cheveux sont en broussailles et ils vont le rester.
Tu urines pendant 3 heures.
Tu te dis: fuck, ma prostate.
Je devrais me lever la nuit.
Bla-bla.
Tu te le dis sans y croire. T’aimes mieux l’entendre dire par ton doc quand il a son doigt dans ton cul. Pain in the ass.
Tu te places face à l’évier qui pompe l’eau chaude du sous-sol.
Tu évites le miroir. Pas deux fois. Pas cave à temps plein.
Tu t’ébouillantes la face avec l’eau qui a finalement décidé d’atteindre le point d’ébullition pendant que tu analysais, avec ta main, l’état de ta barbe que tu n’avais nullement l’intention de couper malgré son état qui te fait ressembler à un chercheur d’or qui ne s’est pas lavé depuis 3 mois.
La face rouge, les yeux rouges, tu te brosses les dents en oubliant de fermer la bouche. Et de changer à l’eau froide.
Tu reviens à la chambre.
Regarde tes vêtements.
Jeans pâle. Jeans foncé. Jeans délavé. Pantalon. Tu prends le pantalon. Mets le pantalon. Enlèves le pantalon. Mets le jeans pâle.
Prends le premier t-shirt sur la pile. Pâle. Mets le t-shirt pâle. Réalises être ton sur ton. Tu changes le jeans pour plus foncé. Celui qui te fait un gros cul. Mais tu changes plutôt le t-shirt et tu prends le foncé.
Fuck.
Tu irais travailler à poil.
Si ce n’était de tout ce qui pend et dépasse.
Tu trouves finalement un truc qui fitte… dans la noirceur de la chambre. Mais à la lumière de la cuisine, ça craint. Mais tu te dis que tu vas passer la journée tout seul au bureau. Anyway.
What the fuck, hein?
Tu regardes la cafetière.
Y a de l’espoir.
Le café c’est l’héroïne du lève-tôt.
Ça, tu te dis, ça va me sauver la vie.
Vide.
Normal.
Ta blonde t’a demandé de t’en occuper avant d’aller se coucher.
T’aurais le goût de brailler. De te mettre en bretzel sur le tapis. Et tu repenses à ta nuit dans cette position et tu te dis que tu seras mieux au bureau, finalement.
Ton auto pue.
Tu regardes partout. Y a rien de vivant, à part toi, dans cette auto.
Tu ramasses un café et un muffin au MacDo.
Un lait, un sucre. Aux carottes.
Tu as l’impression que les ingrédients sont tous bons, mais pas dans le bon ordre.
Tu arrives au bureau.
Ton bureau pue.
Fuck.
Il est 7h30 et tu te demandes déjà comment tu vas réussir à passer à travers.
Au premier téléphone, ton client te demande si ça va.
– Super journée, tu lui réponds, l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt! Si je peux aller te rencontrer? Bien sûr J’arrive ! Tu raccroches en riant. En te brûlant sur ton café trop sucré, ton muffin en carton dont les graines tombent sur ton kit plus ou moins agencé.
Fuck.
Billets que vous pourriez aimer
Les trois mousquetaires

Nous n’étions pas destinés à être ensemble.
Quatre gars de milieux différents.
De quartiers, mais tout autant de statuts sociaux. Petit gars du centre-ville, un autre de Chicoutimi-Nord, un de Notre-Dame et un autre du quartier derrière les centres d’achats. 4 gars avec des métiers aux antipodes. Finance, droit, vente au détail, communication. Un qui aime la moto, l’autre Petula Clark, un qui adore la pêche aux saumons et l’autre qui lit de la bande dessinée.
C’est à se demander ce qu’ils ont en commun.
Rien.
Sinon ce lien unique d’être allé à la même école secondaire.
Pourtant, on n’est même pas devenus amis très jeunes. Ça aurait pu faire une belle excuse, expliquer cette rencontre comme une erreur de jeunesse, mais même pas. En fait, je ne me souviens pas trop où et quand cette belle amitié à vu le jour. Début vingtaine? Début trentaine? Pas tellement important, je dirais. Car aujourd’hui, je dirais depuis toujours.
Car j’ai l’impression qu’ils sont là depuis le début.
Et qu’ils le seront toujours.
Des gars à qui on raconte tout.
Des gars qui écoutent sans juger.
On raconte nos bonheurs comme nos malheurs. Sans aucune inhibition.
Nos soirées bien arrosées sont des histoires épiques dignes des contes de Cervantez. Nous sommes des Don Quichotte. Nous nous battons contre des moulins à vent. Nous sommes des hommes de taverne. Nous nous abreuvons même la vie. À grandes lampées. Chacun à notre manière, nous racontons nos vies avec autant de rires que de pleurs. Nos aventures sont épiques et nos plans rarement réfléchis. Quatre gars au bord de la cinquantaine, avec des cœurs dans la vingtaine, les yeux dans l’eau, qui parlent des vraies affaires.
Ou des affaires ordinaires.
Parce qu’on est comme ça aussi.
Des gars.
Dans tout ce qu’ils ont de plus insignifiant.
Dans tout ce qu’ils ont de plus édifiant.
Les mousquetaires de Dumas. Un pour tous et tous pour un. Notre amitié comme seul arme. Prêt à affronter des armées.
Dans le taxi qui me ramenait à la maison, je leur ai envoyé un texto truffé de fautes causées par l’alcool:
Y’a des jours ou je me dis quoiqu’il arrive dans la vie, je sais que vous serez toujours là. Et ça me rassure. Je vous aime.
Et je me suis évanoui.
Repu. En me flattant la bedaine.
Mais heureux.
Comme devait l’être Dartagnan.
Billets que vous pourriez aimer
Souvenirs sur 10 km
 Ce soir, j’ai enfilé mes espadrilles et suis parti courir dans le temps.
Ce soir, j’ai enfilé mes espadrilles et suis parti courir dans le temps.
km 1
En montant la rue Racine, en face de l’ancien Lycée du Saguenay avec du techno à plein volume dans les oreilles, j’ai tout de même cru entendre le rire de jeunes filles.
J’ai tout de suite eu une pensée pour la chanson de Vincent Delerm « Les filles de 1973 ont trente ans ».
Celles qui ont vu trois fois Rain Man
Celles qui ont pleuré Balavoine
Celles qui faisaient des exposés
Sur l’Apartheid et sur le Che
Celles qui ont envoyé du riz
En Ethiopie, en Somalie
Celles qui disaient « tu comprends pas »
Elles s’appellent Isabelle, Katia, Nathalie, Lucie comme on s’appelle tous Jean, Luc et Marc.
On a 12 ans et on va dans des écoles non mixtes. Comme l’amour nourrit le cœur, au lieu de manger, on échange nos heures de repas pour courir à mi-chemin entre nos deux écoles. Pour se cruiser. Avec l’espoir qu’elles soient là. Souvent on revient bredouille. La plupart du temps, je dirais. Mais on y retourne. Avec l’espoir au ventre. Et les hormones au plafond.
Nos premiers amours. Maladroits. Sans lendemain. Pourtant si intenses.
J’ai eu le cœur qui s’est mis à battre plus intensément. Mes mollets se sont contractés. J’ai grimpé la rue du Séminaire jusqu’à Jacques-Cartier. Juste en face du Cégep de Chicoutimi.
km 2
– N’ouvre surtout pas les yeux, Marc! J’arrive!
En plaçant mes mains sur mes yeux, j’ai entendu crier mon oncle qui descend à vive allure la pente enneigée du Grand Séminaire de Chicoutimi, devenu aujourd’hui le cégep.
Quand tu vis dans le centre-ville, tu profites des espaces verts de proximité. Comme ces pentes en plein coeur de la ville. En glissant sur mon Crazy Carpet™, j’ai enfilé directement dans une touffe de ronces. Les épines piquent ma peau, mon visage, et je suis pris, telle une mouche, dans une toile d’araignée. Robert m’agrippe le bras et me tire doucement pour me libérer de mon piège végétal.
J’en sors avec le visage tuméfié et plus de peur que de mal tandis que mon oncle Robert, lui, craint pas mal plus la réaction de ma mère en voyant ce visage égratigné. C’est tout de même un moindre mal, car si les arbustes n’arrêtaient pas ma descente, je me retrouvais dans le trafic.
C’était l’époque des mitaines de laines avec nos poignets rouges sciés par le froid et nos habits de neige non isolées qui nous laissaient transis dans nos caleçons gaufrés et surtout détrempés.
C’était l’époque des grandes familles qui prenaient soin de l’un ou l’autre de ses membres.
km 3
Au trot, j’ai descendu la rue Jacques-Cartier jusqu’à l’ancienne track de chemin de fer et bifurqué sur la rue Price.
En entendant le train qui s’en vient, je cours derrière la maison d’Alain, mon ami du primaire. Le fils du denturologiste Carrier. Ça m’a toujours fait rire. Carrier. Denturologiste. Sa famille et lui, habitent tout près du tracel, tout en bas de la côte Price. Dans cette maison unifamiliale, il y’a une salle de jeu immense avec une piste de course électrique. Je n’ai ni l’un ni l’autre. Encore moins de maison. Chez nous, on vit à quatre dans un minuscule appartement, en haut de chez ma grand-mère. Dans mes yeux d’enfant, je suis impressionné par toute cette richesse. Alain a tout. Sa chambre déborde de jouets de toutes sortes.
J’ai traversé la rue Price, monté une butte, toujours sur le chemin de l’ancienne voie ferrée, foulant le sol rocailleux sous cette arche improvisée, créée par les arbres.
km 4
Au-dessus du mur de ciment couvert de graffitis, j’ai aperçu les logements sociaux qui ont remplacés l’école St-Philippe où j’ai fait la majeure partie de mes études au primaire. Une école ordinaire avec un train qui passait quasiment dans la cour.
J’ai revu l’espace d’un instant les profs Jocelyne-qui-mâchait-ses-joues et Candide-qui-craquait-des-genoux. J’ai revu aussi Fortuna Ouellet qui m’avait enseigné en première année. Une vieille fille qui habitait derrière chez nous, en face de l’épicerie. Quand je suis revenu dans la région, il y a une vingtaine d’années, j’ai travaillé dans un bureau situé juste en face de son logement. Elle y habitait encore. Elle n’avait pas changé d’un poil. J’en avais convenu qu’elle avait toujours été vieille. Ou que le temps n’avait agi que sur moi. Uniquement sur moi.
J’ai traversé le boulevard Université pour rejoindre la rue Dubuc pour passer devant La Pulperie.
km 5
Avant d’être un musée, la Pulperie de Chicoutimi était notre terrain de jeux.
Sans crainte du danger, on y escalade les poutres d’acier, traversant du haut de nos 10 ans, la rivière située à plus de 90 pieds plus bas. On fait le tour du bassin d’eau en se tenant sur la rampe, glissant quelquefois le pied dans l’eau. On ne sait même pas nager. Insouciants. Invincibles. Le danger n’existe pas. Ou on en est simplement si peu conscients. On part flâner toute la journée sans que nos parents s’inquiètent. On revient au repas, sans se faire questionner sur l’endroit d’où on vient. Tant qu’on est à l’heure pour souper.
J’ai traversé le pont en face de l’église Sacré-Cœur, il y avait des enfants dans le skatepark aménagé sous le bassin. J’avais envie de leur dire que j’avais joué là moi aussi, il y a une quarantaine d’années. Et j’ai changé d’avis en me disant que j’étais dans le quartier tought de mon enfance.
km 6
Je pédale sans regarder derrière moi. J’ai les yeux dans l’eau et un suçon collé dans les cheveux. Pour être certain que je vais me souvenir de ne pas revenir dans le coin, les trois gars m’ont frotté la tête avec pour s’assurer qu’il reste bien en place, englué dans ma blonde tignasse.
Ça m’apprendra à me risquer en zone de combat.
En vélo, je me suis aventuré au petit dépanneur du Bassin, sur la rue Bossé. J’ai autour de 8 ans. Quand j’en suis sorti, on m’a tout de suite convié au combat. Je ne suis pas des leurs. Comme je suis monté sur un frame de poulet, je bondis sur ma bécane et préfère la fuite. En me filant un coup de pied, le plus grand de mes agresseurs a eu le temps de sortir un lollipop baveux de sa bouche et me le sacrer dans les cheveux.
Cette nuit là, je me suis couché en regardant le plafond et en me grattant le fond de la tête dégarni, à l’endroit même où ma mère avait enlevé au ciseau, les couettes collées de sucre.
J’ai pris le chemin du parc qui longe la sortie du pont Dubuc, traversé le boulevard jusqu’au rond-point qu’on appelait la goutte d’eau.
km 7
J’ai atteint les HLM. Les deux tours hideuses, au bout de la rue Racine. Quand on les a construites, j’avais à peine sept ou huit ans.
Deux immeubles à logements tout justes derrière la rue Smith.
J’ai un ami qui demeure dans cette rue délabrée. Je le vois seulement à l’école ou dans les ruelles de nos jeux d’enfants. Un midi, je me pointe près de chez lui et je vois son frère. Je le suis jusque chez lui afin de savoir où sa famille habite. Je monte les marches du logement insalubre, jusqu’à sa porte d’entrée, cogne et demande à voir Jean-Claude à un gros monsieur en camisole pas trop fraîche. Mes yeux restent fixés sur cette cuisine sale où sont jonchées, ici et là, de grosses bouteilles de bière vides et des assiettes encrassées. J’observe cette absence de meubles, de déco et de vie. Jean-Claude se pointe et c’est sous les cris et jurons de son père qui nous demande de sacrer notre camp dehors au plus criss que l’on courre à l’extérieur. Il me dit qu’il déteste son père.
Je pense avoir réalisé à ce moment précis, du haut de mes trois pommes, ce que représentait la pauvreté et la misère sociale. Chez nous, on n’était pas riche, mais on n’était pas pauvre, non plus. J’avais deux parents qui prenaient grand soin de moi, me gâtaient en me guidant du mieux qu’ils pouvaient.
Aujourd’hui, quand je cours près de cette rue, je pense souvent à Jean-Claude. Me demandant ce qu’il est devenu. On dit qu’il est difficile de se sauver de son propre destin, surtout s’il est malsain. J’espère que lui a pu.
J’ai tourné sur St-Anne et j’ai filé sur la rue Petit.
km 8
Je passe devant la maison de Sonia, de Serge, d’André, ces amis que j’ai revus un peu ici et là, à travers les années qui nous séparent de l’enfance.
Dans ma tête, je revois la table tournante du père de Serge, sa collection de Bécaud prônant sur le meuble du salon. Je vois le garage du père de Sonia ou on va se cacher pour jouer au docteur. Mais je ne vois pas le bloc ou André habite, disparu depuis le temps, dans un incendie. J’imagine qu’il a brûlé en une minute, comme une brindille sèche d’automne. L’immeuble était tellement vieux et sec.
J’aperçois notre minuscule logement, mais j’y croise surtout Laurette, ma grand-mère chérie que j’ai tellement pleurée.
Cette femme de caractère, forte comme un arbre centenaire, malgré sa chétivité. Cette vieille fille de 32 ans qui avait pris en charge la famille de son veuf de mari pour créer sa propre famille. Laurette à qui je vais conter mes histoires. Avec mes cheveux droits sur la tête, mes pantalons déchirés, elle dit aux autres membres de la famille que je suis original. Sans me juger. Je suis son préféré, je le sais. Je descends toujours la voir, chaque jour que je peux. Je déjeune avec grand-papa, le faisant rire.
Même rendu à Montréal, quand je descends deux jours à Chicoutimi, voir mes parents, je passe chez elle. Je m’assois sur la chaise à ses côtés, la regardant filer sa laine à travers ses doigts croches.
J’ai vécu des jours plus sombres ou j’aurais aimé qu’elle soit encore là. Pouvoir lui raconter les trucs qu’on ne disait à personne, profitant de sa surdité pour avouer nos pires travers.
J’ai quitté la rue Petit en essuyant la sueur qui me coulait dans les yeux. La chaleur a cette vertu de cacher nos sentiments les plus profonds. J’ai pris le chemin du boulevard Saguenay.
km 9
Devant le vieux pont de Sainte-Anne, j’ai foulé le sol de la zone portuaire.
En fermant les yeux, le parc a disparu et laissé place aux immenses contenants d’essence qui jonchait la place avant sa grande réfection des années 90.
Le Vieux-Port comme on l’appelle n’est pas visité par les jeunes familles et les marcheurs, mais par une faune beaucoup plus bigarrée. Toxicomanes et prostitués s’y donnent rendez-vous. Mon ami Yohan en a fait un sujet d’article fascinant dans le journal étudiant. Il décrit sa rencontre avec un étudiant qui fait des passes pour payer ses études. Alors que la presse néglige ce drame, ce jeune homme de 17 a mis ce secret au grand jour.
Le hasard a fait qu’on s’est retrouvés tous les deux, Yohan et moi, à Montréal à partager un logement. On dit que notre jeunesse nous forme. Je pense que c’est bien vrai. Yohan a continué à s’intéresser aux autres et travaille toujours dans le domaine communautaire. Brave homme.
km 10
J’ai quitté la zone portuaire, en longeant le Saguenay, profitant de la brise et de l’odeur de la marée basse.
Je suis revenu sur mes pas.
À mon point de départ.
En ayant eu pourtant l’impression d’avoir fait un si long voyage.
Billets que vous pourriez aimer
Merci Clef-Re
 Aujourd’hui, je suis retourné au bureau après un arrêt de 3 semaines.
Aujourd’hui, je suis retourné au bureau après un arrêt de 3 semaines.
La face gommée, le pas de travers, j’ai avancé à pas lents comme si cette façon de marcher retarderait la réalité.
Comme un boeuf qui sifflerait sur son chemin à l’abattoir.
Ma boîte aux lettres débordait de prospectus, de factures, mais pas de chèque.
Un indice de plus que la période des Fêtes est bel et bien terminée.
Fini les cadeaux.
Tout au fond du casier métallique, une intrigante enveloppe matelassée a retenu mon attention.
J’ai tout fourré dans mon sac, gravi les marches une à une en prenant le temps de les compter, convaincu que l’on avait ajouté un étage à l’immeuble pendant mon absence.
Arrivé au sommet, essoufflé d’avoir bu 22 jours de suite, je me suis retrouvé face à cette porte sombre où trône un T métallique à coté d’un clou qui jadis était recouvert d’un M.
J’ai ouvert la porte de mon bureau et une odeur de renfermé s’en est dégagée.
Rien pour me motiver.
Il y avait un squelette sur le sofa.
Mais j’ai fait comme si de rien n’était.
Rien n’avait bougé depuis mon départ.
J’ai déposé mon sac et la pile de courrier sur ma table à dessin.
Une pile par dessus une autre pile.
Comme des couches classées par catégories.
Des strates de revues.
Des strates d’esquisses.
Des strates-à-j’aime.
Une accumulation de preuves de ma légendaire procastination.
J’ai tripoté la grosse enveloppe.
Et j’ai lu Postexport.
J’ai alors réalisé qu’elle me provenait de France.
Y a que les Français pour écrire en anglais.
Je ne connais peu de personnes en France.
Quelques amis, ici et là.
Des amis réels que je vois rarement.
Des amis virtuels que je croise plus souvent.
En plongeant ma main dans le paquet, j’ai tout de suite touché des livres.
Et une carte.
Comme je viens d’une vieille génération et que mes parents m’ont toujours appris que c’est plus poli de lire les cartes avant de déballer un cadeau, j’ai fait à ma tête et regarder les livres.
Le contenu:
Le journal intime d’un arbre de Didier Van Cauwelaert.
Lyres de Francis Ponge.
Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi.
Et cette petite carte carrée.
Une petite carte illustrée d’une reproduction de Jean-Baptiste Santerre.
Jeune fille à la bougie.
1700.
Après J-C.
Une jeune vieille.
Avec une peau de toile craquelée.
À l’intérieur de la carte, une écriture fluide.
À l’encre bleue.
Du style fontaine.
Pas une encre sèche d’un vulgaire Bic.
Une encre attachante.
«Cher Marc, je vous envoie trois livres symboles qui me font penser à vous, à votre esprit, à votre en-vie lectrice palpable et vaillante…»
La suite du message je la garde pour moi.
C’était signé Claire.
Ou Clef-Re.
Lectrice de ce blogue.
J’ai déposé la carte sur les livres.
Et ouvert chacun de ceux-ci pour réaliser qu’ils avaient été paraphés.
J’ai senti un sourire naître sur mon visage.
Le premier de la journée.
Je me suis senti renaître.
J’ai fait le ménage de mon bureau.
Dépiler.
Repiler.
Jeter.
Ordonner.
Mais pas trop.
En regardant l’enveloppe, je me suis senti privilégié.
Choyé.
Apprécié.
Qu’une personne que je connais à peine, prenne le temps de m’envoyer ce présent, «d’outre-océan» comme l’écrit si bien Claire dans sa plume si vivante, m’a confirmé encore une fois que la gentillesse est une arme de séduction massive.
J’ai le goût de redonner vie à ce blogue.
Merci Claire, pour ce généreux présent.
Merci pour la pensée.
Merci pour le bonheur.
xxx.
Billets que vous pourriez aimer
Le sablier.
 Le temps est une matière insaisissable.
Le temps est une matière insaisissable.
Comme le sable sur mes orteils.
Je regarde mon pied, il a pris la forme d’un sablier. Chaque petit coup de vent libère un grain, le faisant rouler et se mêler aux autres. Un à un, ils s’enfuient, me quittent au gré de la brise saline, marquant de leur chute, le temps qui s’en va. Grain de sable anonyme. Vedette instantanée, oubliée tout aussi rapidement.
Mon regard est fixé sur la mer, mais je ne la vois pas.
Mes yeux sont fermés. Je ne dors pas. Je suis simplement perdu dans mes pensées. À prendre conscience du temps qui me file entre les orteils. À réaliser que l’on court après les secondes, sans jamais pouvoir les rattraper. Constamment en manque, nous sommes cold turkey du temps. Dépendant. D’éternels sniffeurs de notre propre ligne du temps.
Dans ma tête, aux rythmes des vagues qui viennent mourir sur la plage, je revois cette année folle qui s’achève. Je prends conscience que le temps file. À toute vitesse. Et que tout particulièrement cette année, j’ai souvent usé l’élastique à sa limite. Le temps est un hypocrite. Il nous donne souvent la fausse impression d’être extensible. Qu’on peut arrondir les coins et allonger les jours. On oublie que cette flexibilité est illusoire et se fait uniquement au détriment de sa propre ligne de vie. Comme du temps emprunté. Une dette à soi-même. Avec la possibilité de faire faillite. Une banqueroute plus dramatique que la simple perte financière. Si le temps, c’est de l’argent, l’argent ne t’accorde pas plus de temps. Une dette qui raccourcit ton terme.
Au loin, un rire d’enfant me fait ouvrir les yeux. Le garçon court dans le sable tentant de semer sa mère à ses trousses. Le contact est joyeux. L’étreinte est amoureuse. La femme fait tourner son enfant sur une chorale de rires partagés. Je vois le sable aux bouts de ses petits doigts de pied, le même sable que j’ai sur les miens. J’ai pourtant l’impression que mes grains tombent plus vite que les siens. Son fou rire réveille des souvenirs. Je pense à mes enfants. À leurs rires. Je pense à ces petits moments de bonheur. Passés, présents et en devenir. Nos enfants vieillissent trop vite, comme nos parents nous quittent trop prématurément. Le temps est un salaud.
Sous mes verres, une larme coule.
Est-ce le sable ou le sel, ou simplement le temps qui enfle ma gorge?
Peut-être parce que mon anniversaire approche. Rien d’angoissant. Une année de plus. Ou de moins. Y a pire que de vieillir. Y a mal vieillir. Le genre d’affirmation que je me dis sans trop y croire. Le temps est un emmerdeur.
Le temps est un train aux horaires imprécises qui te rappelle qu’il faut le prendre quand il passe.
J’ai la nette impression d’être enfin arrêté. Les vacances.
D’avoir mis le film de ma vie sur pause.
Le temps de prendre le temps.
De prendre mon temps.
Billets que vous pourriez aimer
Le gène heureux.
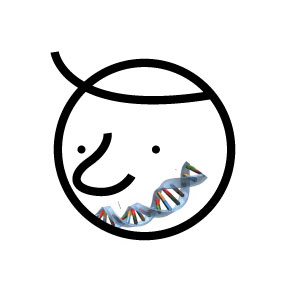 Je suis né dans une famille où la table de la cuisine avait la vertu magique de s’agrandir au nombre des personnes qui s’y joignaient. On arrivait chez nous sans s’annoncer et on y était toujours reçu comme si on attendait votre visite depuis des mois. Mes parents aimaient recevoir, avaient toujours de la bouffe pour tout le monde et si y en avait pas, ben y’en avait toujours quand même. Autour de cette table, on buvait, on mangeait, on parlait; il se dégageait une odeur de bonheur et de connivence. On discutait parfois fort, on cognait quelquefois sur cette table, on avait pas toujours la même opinion, mais on tombait tout de même dans un état de communion. Pas au sens religieux, mais à celui plus noble du terme, celui de la communication. Celui de donner et de recevoir. L’idée de prendre soin de ceux qu’on aime, d’apprécier la présence de gens importants à nos yeux, et surtout d’en connaitre de nouveaux. On apprend mieux à découvrir des personnes différentes quand le terreau est fertile aux échanges. Il faut avant tout avoir l’éponge facile. Se laisser imbiber des autres et vice versa. N’essaie pas de te mêler aux autres si tu n’as pas envie d’affronter des différences. Sinon, discute devant un miroir. Reste dans ton cercle homogène. Au sec.
Je suis né dans une famille où la table de la cuisine avait la vertu magique de s’agrandir au nombre des personnes qui s’y joignaient. On arrivait chez nous sans s’annoncer et on y était toujours reçu comme si on attendait votre visite depuis des mois. Mes parents aimaient recevoir, avaient toujours de la bouffe pour tout le monde et si y en avait pas, ben y’en avait toujours quand même. Autour de cette table, on buvait, on mangeait, on parlait; il se dégageait une odeur de bonheur et de connivence. On discutait parfois fort, on cognait quelquefois sur cette table, on avait pas toujours la même opinion, mais on tombait tout de même dans un état de communion. Pas au sens religieux, mais à celui plus noble du terme, celui de la communication. Celui de donner et de recevoir. L’idée de prendre soin de ceux qu’on aime, d’apprécier la présence de gens importants à nos yeux, et surtout d’en connaitre de nouveaux. On apprend mieux à découvrir des personnes différentes quand le terreau est fertile aux échanges. Il faut avant tout avoir l’éponge facile. Se laisser imbiber des autres et vice versa. N’essaie pas de te mêler aux autres si tu n’as pas envie d’affronter des différences. Sinon, discute devant un miroir. Reste dans ton cercle homogène. Au sec.
Dans ma famille, les amis des amis étaient toujours les bienvenus. La famille s’élargissait au nombre de patates. L’équation était simple: si-tu-me-trouves-intéressant-alors-tu-devrais-aimer-mes-amis étaient la règle. Tout ça était normal. On ne poussait rien. Normal. Comme la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, j’ai reçu de mes parents ce gène magnifique qu’est celui de la générosité. Recevoir, donner, m’impliquer a toujours fait partie de mon quotidien. Dans la normalité des choses. Aujourd’hui encore, je réponds toujours présent quand on me sollicite directement où quand mes amis ont dit oui à une cause qui les anime, et qu’ils demandent mon aide.
Je pense avoir transmis ce gène à mes enfants. Les deux s’impliquent dans leur communauté. C’est con, mais ça me rend aussi fier que leurs notes et leurs réussites scolaires. Réussir sa vie, c’est tellement pas d’avoir uniquement une grosse job. Vivre en société c’est surtout évoluer dans celle-ci en prenant soin des autres.
Dernièrement sur Facebook, une amie écrivait qu’un de mes clients, que j’estimais déjà énormément, donnait une partie de son stock invendu aux plus démunis. Comme ça. Et ce, dans l’anonymat le plus complet. J’aimais beaucoup ce client, mais aujourd’hui, je l’admire. Alors que d’autres en auraient profité pour se donner du capital, pour s’acheter de la sympathie ou mousser tout ça dans une pub, ce geste discret était fait dans une humilité parfaite. Parce qu’elle est là la vraie générosité. Quand elle est gratuite. Sans arrière-pensée. Quand elle va de soi. Sans un but caché de plaire, de profiter, de bonifier, etc.
L’essence même de la générosité est dans son innocence.
Si vous attendez un retour, vous tombez dans le business. Dans le devoir et l’avoir. Si vous attendez qu’on vous nomme, qu’on vous mette de l’avant, qu’on projette votre nom en bold sur un immeuble, vous êtes dans l’erreur. Donner est un geste impulsif et merveilleux, mais qui perd tout son sens et devient malsain quand il est programmé pour séduire.
Dans une société parfaite, nos petits gestes seraient vus comme des délicatesses. Dans le monde où nous vivons, il est devenu une nécessité de s’impliquer pour permettre à de plus démunis d’avoir un petit rayon de soleil à eux aussi. Le temps des Fêtes est une période plus difficile pour certains et souvent plus propice à une telle réflexion, mais il faut surtout y penser en juillet. En septembre, en mai, en avril. En fait, tous les jours.
Donner, ça rend heureux. À celui qui reçoit, mais tout autant, sinon plus, à celui qui donne.
Ne vous en privez pas.