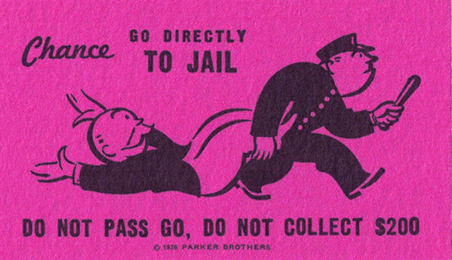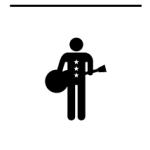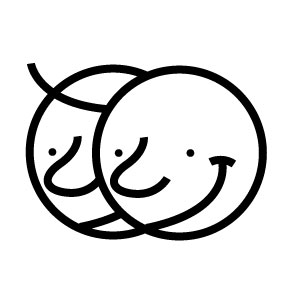Mon histoire.
 Mon histoire contient plusieurs chapitres, certains palpitants et d’autres sur lesquels on s’endort.
Mon histoire contient plusieurs chapitres, certains palpitants et d’autres sur lesquels on s’endort.
Mon histoire est un roman-fleuve et ce n’est pas l’amer à boire.
Mon histoire est à suivre, même si je ne connais pas la suite.
Mon histoire n’a aucun sens sans la tienne.
Mon histoire ne passera jamais à l’histoire.
Mon histoire est un livre d’images. Parfois multicolores. Parfois noir et blanc.
Mon histoire est une page blanche et des mots noirs.
Mon histoire est d’une durée limitée.
Mon histoire est tripante pour certains, flippante pour d’autres.
Mon histoire s’écrit à l’imparfait.
Mon histoire est unique.
Mon histoire est celle de Pierre, Jean, Jacques.
Mon histoire est pleine de maux.
Mon histoire est écrite au présent, pour oublier le passé et, surtout, pour ne pas anticiper le futur.
Mon histoire est à subir.
Mon histoire n’est pas toujours racontable.
Mon histoire s’écrit à la main, sur un iPhone, sur un ordinateur, mais ne vivra jamais sur un écran.
Mon histoire est remplie de clichés que je prends ici et là.
Mon histoire est construite de conjonctions, mais
tout autant de contradictions.
Mon histoire n’est peut-être pas celle que vous aimeriez entendre.
Mon histoire est celle d’un gars ordinaire.
Mon histoire est à prendre à la légère, même si je pèse mes mots.
Mon histoire a des humeurs quand il est question de rumeurs.
Mon histoire est pleine de ratures, toujours à la recherche d’un meilleur terme. L’ultime.
Mon histoire est remplie de fautes dont certaines que j’assume.
Mon histoire est un casse-tête dont il manque des pièces.
Mon histoire est un jardin de proses, même si parfois, elle ne rime à rien.
Mon histoire est d’une simplicité complexe.
Mon histoire commence parfois par la fin d’une autre.
Mon histoire est comme celle d’un milliard de personnes qui pensent qu’ils sont uniques.
Mon histoire. Sujet. Verbe. Complément.
Mon histoire est un récit de voyage dont je ne connais pas la destination.
Mon histoire est composée en Helvetica et imprimée sur du papier vélin.
Mon histoire est un bulletin météo avec des orages effrayants, des tempêtes à se perdre, mais tout autant de rayons de soleil qui rendent aveugle.
Mon histoire est celle d’un citoyen du monde sédentaire.
Mon histoire peut être totalement soluble avec celle de certaines personnes, insoluble avec d’autres.
Mon histoire est épicée, parfois salée, rarement sans saveur.
Mon histoire a un début et aura une fin, entre les deux ça se complique.
Mon histoire est parfois familiale, parfois amicale, parfois sociale, souvent individuelle.
Mon histoire pourrait être celle d’un autre, mais je ne vivrais pas celle d’un autre.
Mon histoire change au contact des autres.
Mon histoire est une série télé: j’ai souvent hâte à la prochaine saison et quand je la visionne je suis déçu.
Billets que vous pourriez aimer
Sophie.
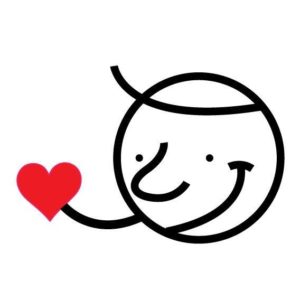 « Marc, il est super fin, mais faudrait pas qu’il s’imagine que je m’intéresse à lui, tsé… »
« Marc, il est super fin, mais faudrait pas qu’il s’imagine que je m’intéresse à lui, tsé… »
C’est à peu près comme ça que Marie-Claude, ma chum, m’a rapporté ce qu’elle avait entendu au café étudiant, ce matin même.
J’ai 17 ans. Au cégep. Depuis trois jours, j’ai passé tout mon temps au café étudiant, à la cafétéria, dehors ou dans les bars du centre-ville. Partout. Sauf dans mes cours. Partout, surtout, où Sophie est présente.
J’ai 17 ans et le cœur veut me sortir de la poitrine quand je la vois.
Petite. Incisive. La coupe au carré. Sophie parle de littérature, de musique, de politique, de n’importe quoi avec une assurance qui me fascine. Je suis un petit cul à côté d’elle. Elle a quelques mois de plus vieux que moi, mais j’ai l’impression qu’une décennie nous sépare.
Je veux être partout où elle va.
Mais elle s’en fout.
Allo, tu viens souvent ici, toi aussi. C’est cool comme place, non?
Non. Jamais. Je déteste cette place.
Je ne dis jamais ce qu’il faut.
Je force la note.
Elle est dans sa bulle.
Et moi je fabule.
À m’imaginer que je pourrais lui plaire.
Moi, le ti-cul du bas de la ville.
Elle, la chick du haut de la ville.
Faudrait pas que je m’imagine que je l’intéresse.
Tsé.
C’était y a plus de trente ans.
Un vendredi, sortant de chez un client en direction de ma voiture, j’ai recroisé Sophie. Assise sur un banc public. Tout juste devant mon véhicule. Je suis resté surpris. Je ne l’avais pas revu depuis une vingtaine d’années.
Je l’ai regardé.
Elle n’avait pas changé.
La coupe au carré.
Je lui ai souri.
Sans retour.
Le regard ailleurs que sur moi.
Elle n’avait vraiment pas changé.
Désintéressée.
J’ai continué mon chemin.
Comme y a trente ans.
Hier, en prenant la rue du Havre, pour rejoindre mon bureau, je suis passé devant la Soupe populaire. Comme toutes les fois, j’ai ralenti, car la rue est exiguë et plusieurs personnes sont à l’extérieur pour fumer ou jaser devant la porte de l’établissement.
Généralement des gars.
Depuis le temps que je fais ce trajet, j’en reconnais quelques-uns : ce grand barbu avec une tête plus petite que son long corps, le petit vieux qui ressemble au Père Noël ou cet autre marcheur qui déambule sur la Racine à vider les cendriers publics. Du monde plus ou moins amoché. Maladie mentale. Dépendance quelconque. Des victimes d’une vie pas facile.
Cette fois, les gars étaient en demi-cercle.
Au milieu y’avait une fille.
Assise sur le trottoir.
La coupe au carré.
Sophie.
Toujours le regard ailleurs que sur moi.
Comme y a trente ans.
Pourtant, moi, je n’ai jamais autant pensé à elle depuis.
À m’imaginer sa vie.
À m’interroger sur la mienne.
À tenter de comprendre comment celles-ci ont pu se croiser sans interagir.
D’hier à aujourd’hui.
Billets que vous pourriez aimer
411 840 secondes.
C’est le temps qui s’est écoulé entre deux courses.
La dernière de l’an passé et la première de cette année.
Long. Très long. Trop long.
Deux mois de mai différents.
Une fin. Un début.
Entre les deux, des visites chez des chiros, physios, ostéos.
Mais surtout un arrêt complet de course.
Bon, vous me direz qu’il y a pire dans la vie.
Et vous aurez raison.
Et tort.
Parce que vous n’êtes pas dans mes souliers. Encore moins dans ma tête.
Parce que dans mon cas, tout est connecté. Je suis de la tête au pied. Des pieds à la tête.
Les derniers mois ont donc été durs entre les deux.
J’avais le moral dans les talons.
Je crois à l’esprit sain dans un corps sain.
Ma tête prend son pied quand je suis sur la route.
La course me drille la tête et la fait respirer. Transpirer. Inspirer.
Je suis accro aux endorphines. Drogue dure. Euphorique. Gratos.
Donc, je suis de retour dans mes runnings.
Lent comme une tortue.
La bedaine qui me sort des shorts.
Je pompe l’huile.
Vieille F1 qui a abusé de la bière et du vin pendant son arrêt aux puits.
Je suis de retour avec un cardio de merde.
De minimes distances.
Une douleur latente.
Mais ma tête est heureuse.
Et, c’est ce qui compte.
Tout part de là. Le bonheur est là. Quelque part entre ses deux oreilles. Pas ailleurs.
Il est dans ma tête. Dans la tienne, aussi. Oui. Oui.
On peut greffer un paquet d’organes vitaux. Reconstruire des os broyés. Reconnecter les tuyaux.
Pour la tête, c’est différent.
Complexe.
Fragile.
Je suis de retour.
J’arpente à nouveau mes chemins de traverse.
J’anticipe les côtes.
Mon pied droit tire.
Le mollet se détend pour l’aider.
Je relève le bassin.
Lève le menton.
Tout le monde s’y met.
Travail d’équipe.
Je cours grand.
Mon sourire remplace ma bouche crispée.
La douleur s’évanouit.
Je pompe.
Pompe.
Le coeur s’emballe.
Je suis de retour.
Je cours malgré la douleur.
Parce que la douleur de la tête peut être plus grande.
Insupportable.
Je suis de retour.
Ça recommence à jaser dans le placard.
Les espadrilles font la fête.
On s’enlace.
Les odeurs d’effort émanent du panier à linge.
Ça sent le bonheur.
Ben oui, je sais.
Tout ça, c’est dans ma tête.
On prend son pied comme on peut.
Billets que vous pourriez aimer
Bing. Bang.
 Commander au restaurant. Faire des grands signes au serveur pour qu’il revienne. Changer du tout au tout ce que j’avais commandé. De quoi rendre folle une cuisine. Ça m’arrive. Bing. Bang.
Commander au restaurant. Faire des grands signes au serveur pour qu’il revienne. Changer du tout au tout ce que j’avais commandé. De quoi rendre folle une cuisine. Ça m’arrive. Bing. Bang.
Le matin d’un pitch, il m’arrive fréquemment de changer le slogan principal de la campagne, refaire rapidement un autre montage et remonter les maquettes. À une demi-heure de présenter. Jeter à la poubelle des heures de création. Bing. Bang.
Au magasin, je regarde la chemise bleue, essaie la grise, achète la noire. Toujours la noire.
Non, merci je ne bois pas. Non, merci. OK, mais un seul. Oui, svp. On peut ravoir une bouteille?
J’achète un truc. Ramène le truc à la maison. Regarde le truc. Regrette le truc. Ramène le truc au magasin. Échange le truc. Rachète le truc. Ramène le truc à la maison. Regarde le truc. Regrette le truc.
Écouter 18 épisodes d’une série en 24 heures. Étirer la saison 3 sur 2 ans.
Spotify a de la misère à me suivre. T’écoutes n’importe quoi, man. Pas n’importe quoi d’Éric Lapointe. N’importe quoi de Marc Gauthier.
Devant trop de choix, je suis paralysé. Incapable de réfléchir.
J’ai 8 ans devant ma boîte de Prismacolor.
Les couleurs et les typographies me rendent dingue.
Je voudrais vivre en noir et blanc. Et en Helvetica.
Y a deux mois, on planifie un voyage pour cet été. Taiwan. Achat de billets d’avion. Achat de guide. Achat de romans de voyage. Planification sommaire. Où. Comment. Pourquoi. Et là, samedi, au lit, le iPad sur les cuisses : une illumination. On n’y va plus. À deux semaines de partir. Quoi? Nan. Ben là. On change. On va ailleurs. Bing. Bang. Annuler les billets. Payer des pénalités. Ranger les livres. Pour plus tard.
Pas toujours facile la vie avec moi.
Je peux vous en parler.
Je suis la personne avec qui j’ai vécu le plus longtemps.
Je suis incapable de prendre le chemin le plus droit. Le plus rapide. Le plus simple.
Je me perds tout le temps.
En voyage. Sur la route. Dans ma tête.
Moi aussi, j’aurais sûrement découvert Haïti en cherchant l’Inde.
Il m’arrive d’envier les gens qui ont tout tracé leur vie d’avance.
Et puis je m’imagine comme eux. Et l’envie passe. Bing. Bang.
Je ne juge personne en disant ça. Je dis seulement que je ne suis pas fait pour ça.
Il m’arrive de penser qu’il me manque le gène de la décision.
Tu es certain? Non.
J’aurais été incapable de jouer à Who Wants To Be A Millionnaire. Incapable.
Marc, is it your final answer?
Heu…
Final?
Je. Sais. Pas. Trop.
Noui?
Billets que vous pourriez aimer
Le gazon.
 J’ai tourné le coin de la rue Germain, cette rue anonyme, sans vie, que je ne connaissais pas avant d’y habiter. Les rues sont comme les gens : avant de les croiser, on ne s’y intéresse pas.
J’ai tourné le coin de la rue Germain, cette rue anonyme, sans vie, que je ne connaissais pas avant d’y habiter. Les rues sont comme les gens : avant de les croiser, on ne s’y intéresse pas.
Elles font partie du décor, ont des noms, des vies, avec des enfants, des couples, des conflits, des amours, des joies et des peines qui nous sont complètement inconnus. On peut passer une vie entière sans en traverser une et tout à coup, bang! on ne pourra plus l’ignorer. Elle fait dorénavant partie de notre vie. Ou du parcours de celle-ci. Les rues, comme les gens, nous mènent ailleurs ou nulle part.
C’est selon. Cul-de-sac. Grand voyage.
Bref, j’ai monté la côte jusqu’à chez moi et j’ai réalisé que le gazon du voisin était vert. Oui, vert. Un vert fluorescent. Un vert parfait. Un green de golf. Une pub de Weed Man™. Un décor de soap des années 70. Irréel. Je n’en ai pas fait de cas immédiatement, tout le monde sait que le gazon est toujours plus vert chez son voisin. Surtout quand tu ne possèdes même pas un mini lopin de terre à toi. Je me suis dit que ma relation avec la pelouse avait peut-être changé. Peut-être étais-je devenu romantique depuis que je n’avais plus de tondeuse. Rêveur. Illusionniste. Imparfait. Ailleurs. Mais je m’éloigne. Je voulais seulement vous parler de la couleur de ce gazon. N’ironisez pas. Je sais que c’est sa couleur naturelle quand c’est la saison, mais au moment précis quand je l’ai aperçu, en tournant le coin, ce vert m’a bouleversé.
Depuis quand était-il aussi vert?
Ce matin? Aucune idée.
Hier? Encore moins.
Il y a une semaine?
Un mois?
Depuis quand sommes-nous le printemps?
L’été?
Le sommes-nous vraiment?
Bon. Vous rigolez.
Vous me croyez fou.
Peut-être.
Ou pas.
J’ai l’impression que ce gazon est passé de neige blanche, neige noire, à gazon vert. Sans que je le sache. Sans que je le réalise.
Le temps va si vite?
Le temps va si vite.
Ce n’était pas une question.
Plutôt une constatation.
Je tourne ce coin de rue deux fois par jour.
Deux fois.
In.
Out.
Et je n’avais rien vu.
Rien.
Jusqu’à ce soir.
Du gazon.
Du foin.
De jaune à vert.
Soudainement.
Si je n’ai pas vu ça, je n’ose pas imaginer tout ce que j’ai manqué.
Il vous est arrivé de quoi?
Vous avez changé de boulot?
Vous êtes malade?
Vous avez perdu un être cher?
Vous vous êtes marié?
Séparé?
Je lis deux à trois quotidiens par jour.
J’ai l’impression de ne rien connaître.
Je croise plein de monde.
Sans rien savoir d’eux.
Moi-même.
Je n’ai pas l’impression que j’en sais plus sur moi.
Pas plus que ça.
J’ai pensé retourner voir le gazon.
Celui du voisin.
Pour voir s’il était aussi vert que ça.
Pour voir comment.
Pour comprendre.
Pourquoi.
C’était peut-être uniquement l’effet de la pluie.
Il pleut tellement en mai.
On est en juin?
Vraiment?
Vous êtes certain?
Le temps passe si vite.
Si vite.
Billets que vous pourriez aimer
Éloge de la paresse.
 Toute l’avant-midi, j’étais en réunion de planification stratégique avec un client. On discute.
Toute l’avant-midi, j’étais en réunion de planification stratégique avec un client. On discute.
Autour de la table des jeunes, des moins jeunes et des encore moins jeunes. Vous ne saurez pas où je me situe. No Way.
Qui parle stratégie, parle campagne. Qui parle campagne, parle marchés ciblés. Qui parle marchés ciblés, parle médias différents.
Les plus jeunes arguent qu’il ne faut pas être trop verbeux.
Une image vaut mille mots.
Tant mieux si elle bouge.
Faut surtout pas trop en dire.
Sinon le consommateur décroche.
L’ère des 140 caractères.
Faut surtout pas trop en dire.
Utiliser des mots faciles.
On est tellement bombardé.
Faut comprendre.
On nous sollicite 1000 fois par jour.
Non.
Ça me fait chier tout ça.
Ce côté nivellement par le bas.
Pas trop écrire. Pas trop être compliqué.
Comme on était en brainstorming et que tout était possible, j’ai dit : fuck, racontons de longues histoires. Mettons de la chair autour de l’os. Démarquons-nous par nos textes à n’en plus finir. Devenons les Proust de la publicité.
Il y a un délire pernicieux dans la tendance de vouloir raconter des histoires à tout prix, mais de le faire facile, avec le moins de mots possible. En vidéo. Surtout, évitez la lecture. Eurk. La lecture. LA LECTUUUUUUURE.
Je rêve souvent aux publicités oldstyle, ou le copywriter nous menait une histoire tissée de mots savoureux. Où le body copy de la pub avait 4 paragraphes. Où la pub nous persuadait à coup de mots, d’arguments, de poésies, de rêve.
Pas de stupides hashtags de marde. #Insipides. #Anonymes. #Faciles.
Des mots.
Simplement.
Alignés. Avec des verbes. Des subjonctifs. Des idées.
Traitez-moi de vieux monsieur. De nostalgique. Vous avez le droit. Mais votre délire de vouloir tout réduire pour faciliter nous rend lâches comme des ânes. Quand j’étais gamin, on se moquait de nos amis qui lisaient le doigt sur la ligne de texte. Aujourd’hui : tout le monde balaie du bout de l’index le contenu résumé de leur application Facebook.
On ne lit plus.
On regarde.
On balaie.
On lit 10 mots et on se fait une idée.
Bravo.
Vous êtes bons.
Moi, il y a des jours, après avoir terminé un roman de 500 pages, j’arrive à peine à saisir où l’auteur voulait en venir.
Peut-être qu’il me manque une pièce au cerveau. Que je suis lent.
Nan.
Je vous niaise.
Oubliez ça.
C’est uniquement que les gens sont devenus paresseux.
On veut du tout-cuit-dans-le-bec.
Svp. Résumez-moi.
Facilitez-moi la job.
Je suis occupé.
Tellement.
Telllllleeeeeemmment.
Boulechite.
On-nivelle-par-le-bas.
Les réseaux sociaux nous rabâchent l’éternel « faut être vrai ». On n’aura jamais été aussi faux. Aussi stagé. Regarde comment je suis heureux. Regarde. REGARDE. JE SUIS FULL HEUREUX!!!!!. #heureux. #full. OK. Tu comprends mieux là?
Avec nos posts planifiés sur un calendrier – N’oubliez pas d’écrire 3 fois par semaine / même si vous n’avons rien à dire. Faut suivre le calendrier de notre consultant.
Pas de farce.
Vous ne trouvez pas qu’on a atteint le fond?
Que ça serait plus logique qu’on ait plus de profondeur.
Au lieu de.
Billets que vous pourriez aimer
Poqué run.
 Je suis né à Chicoutimi, sur la rue Petit. Dans un quartier ouvrier de l’époque. Aujourd’hui, on dirait défavorisé. Mes parents n’étaient pas riches, mais on vivait bien. Mieux que plusieurs de nos voisins. Je fréquentais la défunte école St-Philippe, aujourd’hui devenue une coopérative de logements sociaux. Une école bâtie derrière une voie ferrée. Par où nous traversions de manière à gagner du temps quand la cloche sonnait. C’était dans les années 70.
Je suis né à Chicoutimi, sur la rue Petit. Dans un quartier ouvrier de l’époque. Aujourd’hui, on dirait défavorisé. Mes parents n’étaient pas riches, mais on vivait bien. Mieux que plusieurs de nos voisins. Je fréquentais la défunte école St-Philippe, aujourd’hui devenue une coopérative de logements sociaux. Une école bâtie derrière une voie ferrée. Par où nous traversions de manière à gagner du temps quand la cloche sonnait. C’était dans les années 70.
Comme j’habitais le centre-ville, la faune qui gravitait autour de chez nous n’était pas toujours jojo. Les mauvaises fréquentations étaient faciles. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui tenaient le fort. Capables de me ramener à l’ordre quand c’était le temps. C’était pas toujours le cas pour mes amis ou voisins de quartier. C’est là que tu réalises que la ligne est mince entre choisir un chemin droit et un autre qui fait prendre à ton destin, une direction plus difficile.
Plus j’ai avancé dans la vie, plus j’ai eu à faire des choix. J’en ai fait des bons. Des moins bons. Je ne suis jamais tombé dans l’excès. Ou si peu.
Sans avoir un caractère fort, j’ai toujours eu cette indépendance qui m’a permis de ne pas suivre aveuglément les personnes que j’ai croisées dans ma vie. Leurs mauvaises décisions sont rarement devenues les miennes. Les mauvaises, je les prenais par moi-même. Je n’ai pas de mérite plus qu’il faut. J’ai eu la chance d’avoir des parents présents, d’avoir des passions comme le dessin, l’écriture, la lecture et plus tard, le sport. Tout ça m’a permis de m’accrocher dans les moments les plus durs.
Certains n’ont pas cette chance.
Quand tu regardes plus loin que ton nez, tu réalises que beaucoup d’enfants sont déjà des éclopés de la vie, même si celle-ci commence à peine.
Né dans un milieu défavorisé. Parents absents. Avec personne pour les écouter, pour en prendre soin. Problème de consommation d’alcool ou de drogues. Problème de violence. Problème mental.
Né poqué.
Né tout croche avant même que ta vie commence.
C’est fou comment on peut passer à travers la vie sans se rendre compte de tout ça.
En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. On lit les grands titres dans les médias. Quand un jeune fait une fugue ou commet un acte répréhensible, on juge le geste. En oubliant la plupart du temps que c’est une conséquence plutôt qu’une résultante. À un manque d’éducation / d’amour / d’argent. On oublie. Ou on préfère se fermer les yeux. C’est plus facile.
Le 13 mai prochain, je vais courir avec quelques jeunes qui ont déjà eu leur part de problèmes malgré leur jeune âge. Certains qui veulent s’en sortir, d’autres qui ne savent pas comment. D’autres qui ne voient pas la lumière.
J’ai accepté l’invitation de mon ami, Éric Larouche, de devenir ambassadeur de la Course de la Fondation de l’enfance et la jeunesse. On va rencontrer ces jeunes, leur parler, s’entraîner avec eux, financer leurs équipements et faire la course.
J’ai accepté même si je suis blessé, que je suis en convalescence et en retour progressif à la course. Parce que ma blessure est seulement physique. Et que celle de ces kids est plus profonde. Une âme amochée, ce n’est pas un tendon récalcitrant.
On va courir avec cœur. Ça devrait aller.
P.S vous avez du cash et/ou vous êtes coureur? Pourquoi ne pas venir avec moi?
Billets que vous pourriez aimer
Sous les couvertures
 Je suis né sous les couvertures.
Je suis né sous les couvertures.
Enveloppé dans le papier.
Comme un chocolat fin.
Les livres font partie de ma vie comme l’air que vous respirez.
Je m’en entoure.
J’en consomme.
Je suis un junkie littéraire.
J’ai acheté des livres.
Emprunté des livres.
Volé des livres.
J’ai déménagé des livres toute ma vie.
Ou toutes mes vies.
Criss.
C’est quoi cette boîte impossible à lever.
Des livres.
Criss.
Livres salon.
Livres cuisine.
Livres BD.
Livres bureau.
Livre maman.
– Marc, tu pourrais ramener tes livres chez vous?
Oui. Je sais. Mais, non.
Devant la bibliothèque de ma chambre (encore présente) dans la maison de ma mère, mon doigt descend l’épine des livres. Bob Morane. Les Coq d’or. Tout connaître. Je me renseigne sur. Métal Hurlant. Fluide Glacial. Thor. Spiderman. Hugo, Sartre, Druillet, Gotlib, Voltaire, Thériault. Savard.
Des livres laissés là.
Comme ceux qui se retrouvent dans mon bureau au bureau.
Ou ceux du bureau à la maison.
Y a aussi ceux du salon.
Lus. Pas lus.
Pourquoi lui il est là et pas moi. Pourraient-ils me dire en chœur.
Je n’en sais rien.
Je sais pourquoi vous vous retrouvez avec moi.
Mais je ne sais pas l’ordre dans lequel vous serez lu.
Si vous le serez.
Oh.
Ben oui.
T’arrives dans ma vie. Tu peux te retrouver sur une tablette, pour l’éternité. Ou être dévoré en 12 heures. Tu peux traversé 3 continents. Plié en deux dans un sac à dos. Ondulé sous l’humidité d’une plage. Mourru dans la poussière sous mon lit, un signet au milieu du corps. Relu deux ou trois fois. Tu peux être passé à quelqu’un sans jamais revenir. Je vous aime, mais je ne suis pas nécessairement attaché. Comme les lettres.
Pas assez de temps.
Trop de livres à lire.
À vivre.
Je suis né sous les couvertures.
Nourri par ma passion.
Et celle les autres.
Tante Monique qui m’initie à Reiser et San Antonio à un âge où il ne faut pas lire San Antonio. Encore moins Reiser. Ces profs avec leurs lectures obligés. Les amis qui nous disent qu’il faut lire ça. Les libraires qui m’ont pushé dans les narines, des romans et des bédés. Les revues littéraires. Les quotidiens. Le web. Le criss de web. Qui te fait découvrir la littérature du Monde.
Des livres venus d’ici et là.
Achetés neufs.
Usagés.
En ligne.
Sur place.
En français.
En anglais.
En espagnol. Abandonné après 3 chapitres. Incompréhensible.
Y’a toute sorte de dépendances.
C’est la mienne.
J’ai plus de livres que j’en ai lus.
Comme disait mon amie Monique Lo: on les lira à la retraite quand on aura plus d’argent pour en acheter. En attendant, consommons ces mots imprimés sur le papier comme si c’était un parfum qui nous donnerait la vie éternelle. Fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouissance. Surtout.
Les livres sont toute ma vie.
Je lis tout ça.
J’écris tout ça.
Sans écrire le mien.
Mon livre.
Un jour.
Oui. Oui.
Un jour.
À suivre.
Billets que vous pourriez aimer
Le beau monde.
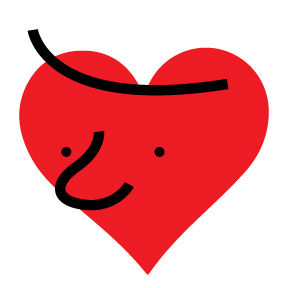 Une chaussée glacée.
Une chaussée glacée.
Une auto qui dérape.
En tentant de l’éviter, elle dérape à son tour.
360 degrés. X 10.
Ice Capade.
Et bang.
Un impact.
La voiture à l’horizontale.
Toujours attachée dans celle-ci, écrasée au fond de son siège, elle tente de bouger malgré le mal de dos causé par l’impact.
Une voix l’interpelle.
– Tu es OK?
Vous pensez que ce sont les grands mouvements qui sauveront le monde? Les grandes remises en question. Les grands rassemblements. Les grandes causes.
Vous avez tout faux.
Ce sont des phrases comme « Tu es OK? »
Ce sont de simples gestes.
L’humanité.
L’aide.
L’autre.
Ce sont les individus, eux-mêmes, qui feront la différence.
C’est ma fille qui était dans l’auto qui a dérapé.
Quelque part entre l’Étape et Québec. Dans le Parc.
Lundi dernier.
Ma fille a fait un tête-à-queue et s’est retrouvée prisonnière de sa voiture, au beau milieu de la route. Au milieu de nulle part. Dans le froid. Toute seule.
Et puis une personne s’est arrêtée.
Et puis une autre.
À leur deux, ils ont réussi à la secourir.
À vérifier si elle était OK.
Ils ont réussi à la sortir de la voiture.
La réchauffer.
Appeler la police. L’ambulance.
M’appeler moi.
Tout en la rassurant.
La consolant.
Tout en me rassurant.
Deux étrangers.
Arrêtés malgré le froid et le danger.
Un gars et une fille qui ne se connaissaient pas qui, l’espace d’un instant, se sont improvisés duo de sauveteurs.
– Merci pour ce que vous avez fait.
– Pas de problème, monsieur et rappelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit.
J’ai raccroché.
En réalisant ne jamais avoir demandé le nom de mes bons samaritains.
Quand je suis arrivé à l’Hôpital Saint-François d’Assise à Québec, rejoindre ma fille, elle m’a tout raconté. Comment ces gens se sont occupés d’elle. L’ont rassurés. En attendant les secours.
On peut parler de fraternité.
D’égalité. De tolérance.
On peut tenir de grands discours.
Dire que l’autre est important.
Dire qu’on est ouvert.
Mais quand vient le temps de le prouver, qui se lève vraiment?
Qui met vraiment ses principes en action?
Qui passe de la parole aux actes?
À mon retour de Québec, ma fille m’a texté.
Par Facebook, la fille qui l’avait aidé a communiqué avec elle.
Pour lui demander si tout allait bien.
Pour lui dire qu’elle avait pensé à elle toute la journée.
Ça m’a ému.
Les gens sont capables d’humanité dans les gestes les plus simples.
Quand les plus pessimistes diront que le monde est rendu fou.
Que le monde est à pleurer.
Que le monde est laid.
Que la planète est en guerre.
Il y aura toujours des personnes qui les feront mentir.
Qui feront la différence.
Qui placeront l’Autre en priorité.
Qui diront que le monde est beau.
Comme ces deux personnes dont je ne connais pas le nom.
Mais dont je connais maintenant la grandeur d’âme.
Merci.
Billets que vous pourriez aimer
L’âge dort.
Dans les quelques 500 billets parus, y en a au moins 8 qui parlent de ma fête.
Un à chaque année.
Qui parle de vieillir.
Négativement.
C’est poche de vieillir. C’est plate. C’est diminuant. Eurk.
Au-delà de 5000 mots vous vomissent la hargne que j’ai à déchirer la dernière page du calendrier.
Parce qu’en plus, je suis né en décembre. Ça fait que j’ai l’impression de vivre mon année à crédit et de vieillir à la fin de celle-ci.
Tiens, ton année est finie. Paie. Change de chiffre, bonhomme.
À mon dernier anniversaire, je n’ai rien écrit.
Niet.
Rien sur mon âge. Rien sur ma fête. Pas de mots poubelles.
J’ai fait parvenir des fleurs à ma mère pour la remercier de m’avoir mis au monde pour voir le Monde.
Bon, c’était facile puisque j’étais en Indonésie, vous me direz. Mais j’étais ailleurs les dernières années aussi.
J’étais peut-être à l’extérieur, mais j’ai eu l’impression d’être beaucoup plus à l’intérieur.
De moi.
Ce dernier voyage m’a fait constater un paquet de trucs que j’avais décidé d’ignorer. Pour toutes sortes de mauvaises raisons.
J’ai une bonne santé. Mon corps tient le coup. Un peu excessif, oui. Capable de me renverser d’aplomb. Alcoolo social. Je dors peu. Je mange bien. Même si souvent, trop. Je fais de l’exercice. Même blessé. Il y quelques méandres qui apparaissent sur mon visage. Des taches sur les mains. Des poches sous les yeux. La barbe de deux jours est blanche. Le muffin qui me sort des jeans. Mais la plupart des trentenaires que j’ai croisés, pendant mon voyage, me donnaient une dizaine d’années de moins. Take it man. TAKE IT. Je fuis moins les miroirs depuis mon retour.
Ma tête ne va pas si mal non plus. Elle est fragile. Capable de plonger dans le noir. Mais la lumière n’est jamais loin. Je suis en apnée. Je plonge, mais jamais trop loin pour ne pas en revenir. J’ai des idées noires. Mais tout autant des idées multicolores. J’imagine que tout ça s’annule. Équilibre? Peut-être. Je m’en balance. J’ai déjà vu neiger. Mes opinions sont plus grises qu’avant. Les grands débats me laissent de marbre. Je fuis les raccourcis. Je réfléchis.
Je suis privilégié. Bon, en fait nous le sommes pas mal tous ici quand on se compare au reste du monde, mais disons qu’ici, je fais partie des privilégiés. Je n’ai pas l’impression que c’est de la chance : je travaille au même rythme qu’à mes 20 ans. Soirs. Fins de semaine. Je travaille peut-être trop. Mais ma tête et mon corps le prennent bien. Et j’ai la «chance» d’aimer ça. Sinon je quitterais tout. Je suis conscient que tout ça repose sur moi. Que si je tombe malade, tout s’écroule. Que la retraite dépend uniquement des choix que je fais. Aucune organisation qui prendra soin de celle-ci. Je ne me plains pas : c’est la vie que j’ai choisi.
J’ai l’impression d’avoir atteint un point de bascule. D’avoir arrêté le temps. Que l’âge dort en moi.
Pour combien de temps?
Bof.
Qui sait.
Je suis capable de 180 degrés.
Je ne suis pas à un premier deni.
Capable de virer boutte pour boutte.
Je prends ce moment de répit.
Je me permets d’arrêter le temps.
C’est encore la meilleure façon de vieillir.
Lentement.