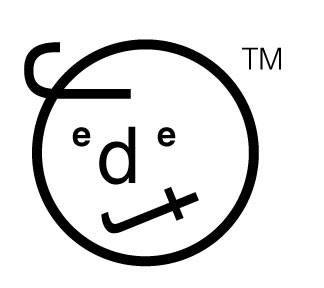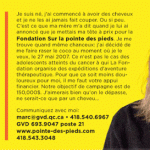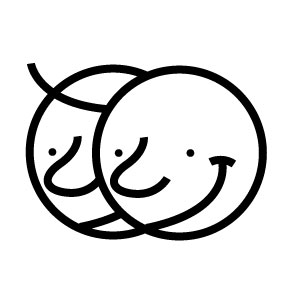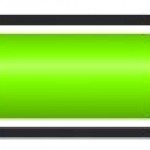…
Billets que vous pourriez aimer
Vieux con.
 Je ne pensais vraiment pas que j’étais rendu là. Je savais que je vieillissais de jour en jour, mais j’étais certain que c’était uniquement la carcasse qui prenait de l’âge (« … et du poids… » – hey, je vous ai entendu!!!). J’étais convaincu que je ne tomberais jamais dans le panneau. Jeune, je haïssais ce genre de discours. Les grandes affirmations qui commençaient par « Dans mon temps … ». Ben oui, mon oncle, ben oui. Dans ton temps, tout était mieux, dans ton temps tout était parfait, dans ton temps, vous étiez mieux que nous. Je haïssais ça à m’en confesser. Les fameux discours générationnels. Les générations d’avant qui pensent que les générations d’après sont moins ceci et plus cela. Il faut dire, pour en ajouter, que je fais partie de la génération X. Cette super génération incomprise serrée entre les géants boomers et sa princesse descendance Y. Ce X qui nous a marqués au fer rouge. Le même X que l’on voyait appliqué sur nos devoirs quand le prof voulait nous montrer que l’on s’était gouré et qu’il fallait recommencer. Recommencer est le mot d’ordre de cette génération : recommencer un nouvel emploi, une nouvelle relation, etc. Mais je m’éloigne là. Je disais que je ne pensais jamais que j’allais un jour, moi aussi, commencer à tenir des discours « dans mon temps… ». Ce n’est pas que j’ai voulu, cela m’a sauté aux yeux en regardant ce magnifique film : Maman est chez le coiffeur. Magnifique film par son esthétisme : la photo y est tellement belle, mais magnifique, aussi, par le jeu des jeunes comédiens qui interprètent des enfants des années soixante. (Vous me voyez venir, là hein?). En résumé, c’est l’histoire d’une femme (l’excellente Céline Bonnier) plaquant mari et enfants qui décide d’aller travailler à l’étranger. La situation serait banale aujourd’hui mais l’action se déroule en 1966. L’histoire nous est racontée par les enfants. Des enfants en 1960. Des enfants habillés de polyester et ratine de velours, avec des pantalons trop courts et des chandails de laine qui pique. Des enfants qui jouaient avec rien. Des enfants qui vivaient en parallèle de leurs parents. Des enfants qui vivaient leur vie d’enfant. Point. (Si vous ne me voyez pas venir, c’est que a) vous avez cessé de me lire (votre patron vient peut-être d’entrer dans votre bureau; b) vous regardez seulement les images de ce blog ou c) vous êtes né après 1980. J’ai retrouvé dans ce film, ma jeunesse; une jeunesse tellement différente de celle de mes enfants et de leurs congénères. Une enfance sans technologie, sans 2000 stations de télé, sans ipod, sans internet… Un jeu en réseau, c’était un jeu de quartier. Avec des vraies personnes. Une enfance avec les vieux vélos de nos cousins, frères, voisins. Nos vélos qui pesaient 200 livres. Les même 200 livres que pesaient les appareils dentaires de l’époque. La télé sur le UHF. Les cartes de hockey et la gomme dure qui faisait gricher des dents. Les mille et un personnages interprétés avec le même bâton comme objet. Nous étions tellement naïfs. Trop? Je ne pense pas. Aujourd’hui, les jeunes me semblent plus blasés qu’en notre temps. Désillusionés. Mmmm. Je pense vraiment que je deviens vieux. Un vieux con.
Je ne pensais vraiment pas que j’étais rendu là. Je savais que je vieillissais de jour en jour, mais j’étais certain que c’était uniquement la carcasse qui prenait de l’âge (« … et du poids… » – hey, je vous ai entendu!!!). J’étais convaincu que je ne tomberais jamais dans le panneau. Jeune, je haïssais ce genre de discours. Les grandes affirmations qui commençaient par « Dans mon temps … ». Ben oui, mon oncle, ben oui. Dans ton temps, tout était mieux, dans ton temps tout était parfait, dans ton temps, vous étiez mieux que nous. Je haïssais ça à m’en confesser. Les fameux discours générationnels. Les générations d’avant qui pensent que les générations d’après sont moins ceci et plus cela. Il faut dire, pour en ajouter, que je fais partie de la génération X. Cette super génération incomprise serrée entre les géants boomers et sa princesse descendance Y. Ce X qui nous a marqués au fer rouge. Le même X que l’on voyait appliqué sur nos devoirs quand le prof voulait nous montrer que l’on s’était gouré et qu’il fallait recommencer. Recommencer est le mot d’ordre de cette génération : recommencer un nouvel emploi, une nouvelle relation, etc. Mais je m’éloigne là. Je disais que je ne pensais jamais que j’allais un jour, moi aussi, commencer à tenir des discours « dans mon temps… ». Ce n’est pas que j’ai voulu, cela m’a sauté aux yeux en regardant ce magnifique film : Maman est chez le coiffeur. Magnifique film par son esthétisme : la photo y est tellement belle, mais magnifique, aussi, par le jeu des jeunes comédiens qui interprètent des enfants des années soixante. (Vous me voyez venir, là hein?). En résumé, c’est l’histoire d’une femme (l’excellente Céline Bonnier) plaquant mari et enfants qui décide d’aller travailler à l’étranger. La situation serait banale aujourd’hui mais l’action se déroule en 1966. L’histoire nous est racontée par les enfants. Des enfants en 1960. Des enfants habillés de polyester et ratine de velours, avec des pantalons trop courts et des chandails de laine qui pique. Des enfants qui jouaient avec rien. Des enfants qui vivaient en parallèle de leurs parents. Des enfants qui vivaient leur vie d’enfant. Point. (Si vous ne me voyez pas venir, c’est que a) vous avez cessé de me lire (votre patron vient peut-être d’entrer dans votre bureau; b) vous regardez seulement les images de ce blog ou c) vous êtes né après 1980. J’ai retrouvé dans ce film, ma jeunesse; une jeunesse tellement différente de celle de mes enfants et de leurs congénères. Une enfance sans technologie, sans 2000 stations de télé, sans ipod, sans internet… Un jeu en réseau, c’était un jeu de quartier. Avec des vraies personnes. Une enfance avec les vieux vélos de nos cousins, frères, voisins. Nos vélos qui pesaient 200 livres. Les même 200 livres que pesaient les appareils dentaires de l’époque. La télé sur le UHF. Les cartes de hockey et la gomme dure qui faisait gricher des dents. Les mille et un personnages interprétés avec le même bâton comme objet. Nous étions tellement naïfs. Trop? Je ne pense pas. Aujourd’hui, les jeunes me semblent plus blasés qu’en notre temps. Désillusionés. Mmmm. Je pense vraiment que je deviens vieux. Un vieux con.
Maman est chez le coiffeur de Léa Pool.
Billets que vous pourriez aimer
Résumé d’une semaine pas comme les autres.

Billets que vous pourriez aimer
À mon père.
Il y a un an tu t’es présenté devant une montagne plus haute que celles des Monts-Valin. Je n’étais pas trop inquiet; les montagnes, tu connaissais. En hiver, tu en avais tellement descendu avec tes amis. Des pentes de toutes les sortes : des poudreuses ou des glacées, des douces et des abruptes. Et dans ta vie aussi tu avais connu des descentes vertigineuses. Des versants si abrupts qu’on en perd le soleil. Tu avais même connu le vide. La perte de l’essentiel. La perte d’elle, ta fille. Même au plus bas de cette pente insurmontable, avec l’aide de ta compagne, tu avais su regagner, petit à petit, sans remonte-pente, le sommet de ta vie. Il y a un an, cette nouvelle montagne que tu devais affronter était plus maligne que toutes les autres. Elle ne te laisserait aucune chance. Même tes efforts surhumains, ceux de ma mère et de tes proches n’ont pu la vaincre. Il y a un mois, la nouvelle nous ensevelissait tous. Une avalanche nous emportait avec toi. Même nos larmes, la chaleur de nos coeurs ne pouvaient vaincre la neige qui te recouvrait. Même en creusant à nous casser les ongles, ton corps était le seul à fondre sous cette neige qui durcissait. Sous la neige, qui te dissimulait, on entendait ton coeur. Ce grand coeur. Ce coeur que savaient apprécier tes amis et craindre tes ennemis. Ce coeur qui savait battre le rythme. Ce coeur si vaillant. Maintenant que tu es plus haut que les montagnes, tu garderas un oeil sur nous. Il y a tellement à faire là-haut pour un gars comme toi. Tant de trucs à réparer. Tant de personnes à aider. Tu ne manqueras plus jamais de temps pour tout faire. Et quand tes proches auront une montagne à gravir, eux aussi, s’ils trouvent que la pente est plus douce que prévu, c’est que tu seras passé avant eux.
Billets que vous pourriez aimer
Incubateur de rêves.
 Quand mon garçon a terminé le secondaire et prit le chemin du Cégep, je lui ai écrit une lettre lui disant qu’il entamait l’une des étapes les plus passionnantes de sa vie : entrer dans le monde, le refaire, le défaire, le réinventer, mais surtout amener sa participation à celui-ci. J’ai toujours été un grand défenseur des Cégeps. Toutes les fois que des débats sociaux ont condamné ces institutions au pilori, je me suis souvenu de ma propre expérience en imaginant comment ma vie aurait été différente si je n’avais pas vécu à fond ma vie de cégépien. Au delà de ses qualités éducatives, la vie collégiale représente un incubateur de vie : l’endroit où se forge le citoyen de demain, l’endroit où tu découvres que tes passions peuvent t’amener ailleurs, où tu découvres, à la sortie de l’adolescence, l’embryon de ce que tu deviendras. Quand je suis entré au Cegep de Chicoutimi en 1982, je me voyais devenir écrivain ou journaliste. Je me suis impliqué à fond dans des activités connexes : journal étudiant, radio étudiante, improvisation, théâtre; tellement impliqué que cela a changé mon plan de carrière. Je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose que ce dont j’avais planifié. Que les expériences diverses vécues au Cégep m’avaient autant aidé à cheminer que les cours que j’avais suivis. Si je parle du terrain fertile des collèges, c’est que 3 cégeps de la région : Alma, Chicoutimi et St-Félicien se sont réunis pour promouvoir la « vision collégiale » en invitant les jeunes à réaliser leurs rêves. En leur disant que c’est possible de changer les choses, de façonner sa vie, de mettre en marche un projet, et que la formation qu’ils recevront leur permettra d’avancer dans leur propre vie. En s’associant ainsi, nos collèges régionaux font front commun afin de diminuer l’exode des jeunes vers les grands centres urbains que sont Québec et Montréal et font en sorte de promouvoir une formation à la fine pointe. C’est intéressant de travailler avec des gens qui, normalement, se font concurrence et de voir qu’avec une vision commune tout le monde y gagne.
Quand mon garçon a terminé le secondaire et prit le chemin du Cégep, je lui ai écrit une lettre lui disant qu’il entamait l’une des étapes les plus passionnantes de sa vie : entrer dans le monde, le refaire, le défaire, le réinventer, mais surtout amener sa participation à celui-ci. J’ai toujours été un grand défenseur des Cégeps. Toutes les fois que des débats sociaux ont condamné ces institutions au pilori, je me suis souvenu de ma propre expérience en imaginant comment ma vie aurait été différente si je n’avais pas vécu à fond ma vie de cégépien. Au delà de ses qualités éducatives, la vie collégiale représente un incubateur de vie : l’endroit où se forge le citoyen de demain, l’endroit où tu découvres que tes passions peuvent t’amener ailleurs, où tu découvres, à la sortie de l’adolescence, l’embryon de ce que tu deviendras. Quand je suis entré au Cegep de Chicoutimi en 1982, je me voyais devenir écrivain ou journaliste. Je me suis impliqué à fond dans des activités connexes : journal étudiant, radio étudiante, improvisation, théâtre; tellement impliqué que cela a changé mon plan de carrière. Je me suis rendu compte que je voulais faire autre chose que ce dont j’avais planifié. Que les expériences diverses vécues au Cégep m’avaient autant aidé à cheminer que les cours que j’avais suivis. Si je parle du terrain fertile des collèges, c’est que 3 cégeps de la région : Alma, Chicoutimi et St-Félicien se sont réunis pour promouvoir la « vision collégiale » en invitant les jeunes à réaliser leurs rêves. En leur disant que c’est possible de changer les choses, de façonner sa vie, de mettre en marche un projet, et que la formation qu’ils recevront leur permettra d’avancer dans leur propre vie. En s’associant ainsi, nos collèges régionaux font front commun afin de diminuer l’exode des jeunes vers les grands centres urbains que sont Québec et Montréal et font en sorte de promouvoir une formation à la fine pointe. C’est intéressant de travailler avec des gens qui, normalement, se font concurrence et de voir qu’avec une vision commune tout le monde y gagne.
Billets que vous pourriez aimer
Honnêteté électorale.

Je sais que les deux mots ne vont pas très bien ensemble, je ne suis pas le seul: clin d’oeil publicitaire d’une boutique de vélo en ce temps de campagne électorale.
(Traduction : Ils vous disent n’importe quoi pour gagner votre vote. Nous, nous voulons seulement votre argent.)
© La photo, prise sur Flickr, appartient à blakemasters.
Billets que vous pourriez aimer
Attention, vous traversez présentement une zone de confort!
 Voici l’image qui me vient en tête : vous êtes en avion et vous volez tranquillement vers votre destination préférée. Tout à coup, l’avion déconne. Des soubresauts se font sentir. Rien de bien rassurant. Le commandant prend la parole et crache par les haut-parleurs de l’avion : « attention, nous traversons une zone de turbulence ». Vraiment, vraiment, rien de bien rassurant. Vous envisagez les pires scénarios : explosion, écrasement, mort violente, etc.; votre vie se déroule pratiquement sous vos yeux avec ses remords et ses regrets. Inversons les choses pour la deuxième image qui me vient en tête : vous êtes en affaires, tout va bien. En fait, tout va tellement bien que vous n’avez quasiment plus le temps de vous arrêter. C’est un feu roulant. Les commandes, les clients, les ressources humaines, les relations publiques, vous roulez à fond de train. Vous êtes à votre mieux. Et soudain, tout baigne dans l’huile. Trop. Vous tournez les coins ronds. Plus de défi. Plus de feu sacré. La routine. Les répétitions. La rengaine. « Attention, vous traversez présentement une zone de confort! ». Vous voilà vulnérable. Parce que le feu sacré, la passion s’est transformée en petite braise ou en une minuscule petite flamme prête à s’éteindre au premier frémissement. C’est un sentiment que vous connaissez? C’est sûrement la pire des situations pour une entreprise et, selon moi, pour une personne. Je suis chanceux, je pratique un métier non-traditionnel et créatif, une job que je réinvente tous les jours; malgré cela, il m’arrive d’entendre la voix de mon commandant intérieur qui me dit d’attacher ma ceinture, parce que je vais traverser une zone… de confort. Et là je vois, moi aussi, défiler toute ma vie (créative), comme si j’allais m’écraser (dans un La-Z-Boy!) et (re)faire les mêmes concepts. Dans une plus grosse organisation, c’est pire. Il faut être en mesure de ne jamais tomber dans le piège de cette zone « interdite ». Il faut imaginer des stratégies pour que les membres de notre organisation ne tombent jamais dans la facilité du copier-coller. Ne jamais permettre une coupure de montée de sang au coeur. Vous avez tous dans votre vie connu le professeur-au-cartable-collé-au-ruban-gommée-et-pages-jaunies, vous savez le prof qui vous a remâché la même matière qu’à votre père et qu’il remâchera à votre fils dans 10 ans. Le prof qui livre la même matière année après année, sans se questionner si sa méthode est encore appropriée et pire encore, si sa matière est toujours à jour. Ou le consultant en marketing qui vous ressort année après année, le même plan-média (qu’il décale d’une journée (ou de deux jours, les années bissextiles) pour s’assurer de tomber dans les mêmes fins de semaine sans se questionner si le fameux plan est toujours pertinent. Ou le consultant en communication qui vous rabat les oreilles avec les mêmes idées, sous prétexte « qu’on ne change pas une solution gagnante ». Zone de confort. Zone d’inconfort. Parce même si organisation qui pratique l’immobilisme a souvent l’impression de reculer, c’est faux: ce sont ses concurrents qui avancent et qui lui en donne l’illusion.
Voici l’image qui me vient en tête : vous êtes en avion et vous volez tranquillement vers votre destination préférée. Tout à coup, l’avion déconne. Des soubresauts se font sentir. Rien de bien rassurant. Le commandant prend la parole et crache par les haut-parleurs de l’avion : « attention, nous traversons une zone de turbulence ». Vraiment, vraiment, rien de bien rassurant. Vous envisagez les pires scénarios : explosion, écrasement, mort violente, etc.; votre vie se déroule pratiquement sous vos yeux avec ses remords et ses regrets. Inversons les choses pour la deuxième image qui me vient en tête : vous êtes en affaires, tout va bien. En fait, tout va tellement bien que vous n’avez quasiment plus le temps de vous arrêter. C’est un feu roulant. Les commandes, les clients, les ressources humaines, les relations publiques, vous roulez à fond de train. Vous êtes à votre mieux. Et soudain, tout baigne dans l’huile. Trop. Vous tournez les coins ronds. Plus de défi. Plus de feu sacré. La routine. Les répétitions. La rengaine. « Attention, vous traversez présentement une zone de confort! ». Vous voilà vulnérable. Parce que le feu sacré, la passion s’est transformée en petite braise ou en une minuscule petite flamme prête à s’éteindre au premier frémissement. C’est un sentiment que vous connaissez? C’est sûrement la pire des situations pour une entreprise et, selon moi, pour une personne. Je suis chanceux, je pratique un métier non-traditionnel et créatif, une job que je réinvente tous les jours; malgré cela, il m’arrive d’entendre la voix de mon commandant intérieur qui me dit d’attacher ma ceinture, parce que je vais traverser une zone… de confort. Et là je vois, moi aussi, défiler toute ma vie (créative), comme si j’allais m’écraser (dans un La-Z-Boy!) et (re)faire les mêmes concepts. Dans une plus grosse organisation, c’est pire. Il faut être en mesure de ne jamais tomber dans le piège de cette zone « interdite ». Il faut imaginer des stratégies pour que les membres de notre organisation ne tombent jamais dans la facilité du copier-coller. Ne jamais permettre une coupure de montée de sang au coeur. Vous avez tous dans votre vie connu le professeur-au-cartable-collé-au-ruban-gommée-et-pages-jaunies, vous savez le prof qui vous a remâché la même matière qu’à votre père et qu’il remâchera à votre fils dans 10 ans. Le prof qui livre la même matière année après année, sans se questionner si sa méthode est encore appropriée et pire encore, si sa matière est toujours à jour. Ou le consultant en marketing qui vous ressort année après année, le même plan-média (qu’il décale d’une journée (ou de deux jours, les années bissextiles) pour s’assurer de tomber dans les mêmes fins de semaine sans se questionner si le fameux plan est toujours pertinent. Ou le consultant en communication qui vous rabat les oreilles avec les mêmes idées, sous prétexte « qu’on ne change pas une solution gagnante ». Zone de confort. Zone d’inconfort. Parce même si organisation qui pratique l’immobilisme a souvent l’impression de reculer, c’est faux: ce sont ses concurrents qui avancent et qui lui en donne l’illusion.
Billets que vous pourriez aimer
Votre logo sent la boule à mite?
 C’est impressionnant de voir à quel point certaines entreprises ont de la difficulté à se laisser convaincre de revitaliser un peu leurs logos. Même si ces entreprises sont pourtant souvent prêtes à se faire suggérer des nouveaux trucs, des concepts qui sortent de l’ordinaire, de nouvelles approches, mais lorsque vient le temps de parler du logo: niet, on n’y touche pas! La plupart des raisons évoquées pour refuser une telle opération sont une question d’identité ou de référence même si, à la base, les modifications suggérées sont pour la plupart pratiques ou esthétiques. Pourquoi une telle résistance alors que la plupart des grosses pointures mondiales ont toujours revampé petit à petit leurs signatures. Jamais dramatiquement, bien sûr, mais subtilement. Des marques prestigieuses comme Nike, Coca-Cola, Sony ou Ford (mon exemple) ont tour à tour adouci leurs courbes, amélioré un crénage, rajeuni une typographie, modifié une couleur. Pourquoi le font-elle? Pour suivre la parade. Pour rester jeune, pour s’adapter aux nouveaux médias, parce que les technologies changent tout autant que les tendances. Combien de logos se sont soudainement retrouvés sans saveur lorsque diffusés sur internet ou à la télévision? Une entreprise se doit de démontrer à sa clientèle qu’elle évolue, qu’elle est en avant de la parade et qu’elle s’adapte, sinon le message qu’elle envoie est clair : l’immobilisme est notre marque de commerce. Quand je parle de revamper une marque, je ne parle pas ici de complètement effacer ce qui a été fait, mais plutôt de moderniser celle-ci, lui redonner un second souffle. La plupart de ces changements sont souvent très simples, mais font toute la différence. Pas trop pour ne plus reconnaître la marque, mais assez pour la raviver. Bien sûr qu’il y a des coûts reliés à une telle opération : honoraires, réimpression des principaux outils de communications et d’affichage, etc. Mais comme les changements sont rarement drastiques, la cohabitation de l’ancienne et de la nouvelle identité se vit de façon très souple. Alors si votre logo sent la boule à mite ou semble sortir directement d’une émission de Symphorien, serait peut-être le temps d’y faire faire un petit shampoing…
C’est impressionnant de voir à quel point certaines entreprises ont de la difficulté à se laisser convaincre de revitaliser un peu leurs logos. Même si ces entreprises sont pourtant souvent prêtes à se faire suggérer des nouveaux trucs, des concepts qui sortent de l’ordinaire, de nouvelles approches, mais lorsque vient le temps de parler du logo: niet, on n’y touche pas! La plupart des raisons évoquées pour refuser une telle opération sont une question d’identité ou de référence même si, à la base, les modifications suggérées sont pour la plupart pratiques ou esthétiques. Pourquoi une telle résistance alors que la plupart des grosses pointures mondiales ont toujours revampé petit à petit leurs signatures. Jamais dramatiquement, bien sûr, mais subtilement. Des marques prestigieuses comme Nike, Coca-Cola, Sony ou Ford (mon exemple) ont tour à tour adouci leurs courbes, amélioré un crénage, rajeuni une typographie, modifié une couleur. Pourquoi le font-elle? Pour suivre la parade. Pour rester jeune, pour s’adapter aux nouveaux médias, parce que les technologies changent tout autant que les tendances. Combien de logos se sont soudainement retrouvés sans saveur lorsque diffusés sur internet ou à la télévision? Une entreprise se doit de démontrer à sa clientèle qu’elle évolue, qu’elle est en avant de la parade et qu’elle s’adapte, sinon le message qu’elle envoie est clair : l’immobilisme est notre marque de commerce. Quand je parle de revamper une marque, je ne parle pas ici de complètement effacer ce qui a été fait, mais plutôt de moderniser celle-ci, lui redonner un second souffle. La plupart de ces changements sont souvent très simples, mais font toute la différence. Pas trop pour ne plus reconnaître la marque, mais assez pour la raviver. Bien sûr qu’il y a des coûts reliés à une telle opération : honoraires, réimpression des principaux outils de communications et d’affichage, etc. Mais comme les changements sont rarement drastiques, la cohabitation de l’ancienne et de la nouvelle identité se vit de façon très souple. Alors si votre logo sent la boule à mite ou semble sortir directement d’une émission de Symphorien, serait peut-être le temps d’y faire faire un petit shampoing…
Billets que vous pourriez aimer
Artiste, moi? Jamais! Vraiment? Ben, un peu… Quoique un peu plus… heuuu… beaucoup, finalement.
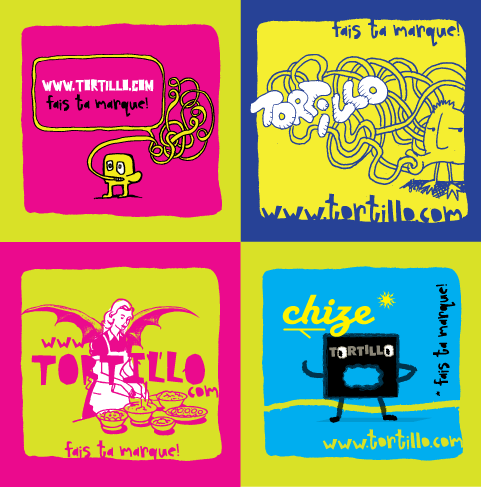 Étrange comme les choses changent dans une vie. Prenez par exemple l’image que j’ai de moi-même par rapport à ma profession. Quand j’ai débuté dans le métier, il y a une chose que je n’étais pas capable d’entendre à mon sujet : « haaa, vous êtes un artiste? », ou, « vous, les artistes… ». Je me débattais haut et fort. Je criais au monde entier que je n’étais pas un artiste! J’étais plus que ça. J’étais un communicateur. Un publicitaire. Un consultant. MAIS surtout pas un artiste. Parce que la notion d’artiste me semblait péjorative. Parce que, selon moi, un artiste n’en faisait qu’à sa tête, ne se basait que sur son pif, ne prenait aucune critique; bref, il manquait de professionnalisme. Pour moi, la différence était majeure entre un designer graphique et un artiste. Surtout vis-à-vis le client: l’artiste n’en avait pas : il avait des admirateurs ou des collectionneurs. Cela m’a pris presque 25 ans avant de réaliser que, finalement, je l’aime bien ce chapeau d’artiste dont l’on m’a coiffé. Que maintenant si un client me traite d’artiste, je trouve cela plutôt flatteur! Après des années de reniement me voilà serein devant l’évidence : ben oui, dans le fin fond, un graphiste c’est un artiste. Pas de la façon dont je le décrivais précédemment, mais plutôt comme un individu qui cherche à créer et briser les paradigmes qui nous entourent, qui cherche à réinventer; une personne dont la routine rend morose. Je pense que ce changement majeur de perception, par rapport à mon métier, vient en grande partie des observations que je fais des autres qui pratiquent le même métier que moi. Dans une certaine mesure, le métier de graphiste, designer graphique ou de communicateur a tellement changé depuis l’avènement des ordinateurs que la notion même du métier a changé. Auparavant, on était un dessinateur publicitaire. On devait avoir le talent de créer, de dessiner. Par la suite, il a fallu se mettre à conjuguer avec les nouvelles technologies. Qui dit technologie, dit production, dit série. Une certaine conformité s’est établie. On reconnaissait de plus en plus, dans le travail des graphistes, le logiciel qu’ils utilisaient afin de réaliser une production; on pouvait savoir la version du dit-logiciel par la façon d’utiliser certaines nouveautés rajoutées dans cette mouture. On dénote depuis quelques années un grand retour de l’illustration, des techniques manuelles, de créations se rapprochant plus des techniques mixtes de l’art que du graphisme par ordinateur. Peut-être parce que les « vrais » graphistes en ont marre d’être comparés aux spécialistes du copier-coller. Que les professionnels du métier veulent faire un pied de nez aux gens qui s’improvisent en leur disant : « OK, vous voulez jouer dans la cour des grands, suivez-nous! »; comme un skieur extrême qui amènerait un skieur du dimanche à une petite randonnée « free skiing » où la technique fait la différence. Un retour aux sources, quoi. Qu’on ne m’étiquette pas de traditionaliste : je ne me passerais plus jamais de mon mac même si j’aime bien encore griffoner et donner vie à une idée sur du papier. Finalement, il ne me manque que le chevalet, le béret et le foulard. Parce que moi, vous savez, je suis un artiste. Haa…? Et moi qui vous croyais graphiste… Vraiment? Ben, je le suis un peu… quoique un peu plus… heuuu… beaucoup, finalement. Comme les temps changent.
Étrange comme les choses changent dans une vie. Prenez par exemple l’image que j’ai de moi-même par rapport à ma profession. Quand j’ai débuté dans le métier, il y a une chose que je n’étais pas capable d’entendre à mon sujet : « haaa, vous êtes un artiste? », ou, « vous, les artistes… ». Je me débattais haut et fort. Je criais au monde entier que je n’étais pas un artiste! J’étais plus que ça. J’étais un communicateur. Un publicitaire. Un consultant. MAIS surtout pas un artiste. Parce que la notion d’artiste me semblait péjorative. Parce que, selon moi, un artiste n’en faisait qu’à sa tête, ne se basait que sur son pif, ne prenait aucune critique; bref, il manquait de professionnalisme. Pour moi, la différence était majeure entre un designer graphique et un artiste. Surtout vis-à-vis le client: l’artiste n’en avait pas : il avait des admirateurs ou des collectionneurs. Cela m’a pris presque 25 ans avant de réaliser que, finalement, je l’aime bien ce chapeau d’artiste dont l’on m’a coiffé. Que maintenant si un client me traite d’artiste, je trouve cela plutôt flatteur! Après des années de reniement me voilà serein devant l’évidence : ben oui, dans le fin fond, un graphiste c’est un artiste. Pas de la façon dont je le décrivais précédemment, mais plutôt comme un individu qui cherche à créer et briser les paradigmes qui nous entourent, qui cherche à réinventer; une personne dont la routine rend morose. Je pense que ce changement majeur de perception, par rapport à mon métier, vient en grande partie des observations que je fais des autres qui pratiquent le même métier que moi. Dans une certaine mesure, le métier de graphiste, designer graphique ou de communicateur a tellement changé depuis l’avènement des ordinateurs que la notion même du métier a changé. Auparavant, on était un dessinateur publicitaire. On devait avoir le talent de créer, de dessiner. Par la suite, il a fallu se mettre à conjuguer avec les nouvelles technologies. Qui dit technologie, dit production, dit série. Une certaine conformité s’est établie. On reconnaissait de plus en plus, dans le travail des graphistes, le logiciel qu’ils utilisaient afin de réaliser une production; on pouvait savoir la version du dit-logiciel par la façon d’utiliser certaines nouveautés rajoutées dans cette mouture. On dénote depuis quelques années un grand retour de l’illustration, des techniques manuelles, de créations se rapprochant plus des techniques mixtes de l’art que du graphisme par ordinateur. Peut-être parce que les « vrais » graphistes en ont marre d’être comparés aux spécialistes du copier-coller. Que les professionnels du métier veulent faire un pied de nez aux gens qui s’improvisent en leur disant : « OK, vous voulez jouer dans la cour des grands, suivez-nous! »; comme un skieur extrême qui amènerait un skieur du dimanche à une petite randonnée « free skiing » où la technique fait la différence. Un retour aux sources, quoi. Qu’on ne m’étiquette pas de traditionaliste : je ne me passerais plus jamais de mon mac même si j’aime bien encore griffoner et donner vie à une idée sur du papier. Finalement, il ne me manque que le chevalet, le béret et le foulard. Parce que moi, vous savez, je suis un artiste. Haa…? Et moi qui vous croyais graphiste… Vraiment? Ben, je le suis un peu… quoique un peu plus… heuuu… beaucoup, finalement. Comme les temps changent.
→ Le crayon à l’oeuvre: série d’auto-collants créé pour le fromage Tortillo. Fait entièrement à la main, oui oui, c’est pas beau ça?
Billets que vous pourriez aimer
iMarc ou la vie est belle sans Bell.
 Un mois. J’ai pu me retenir un mois. Un mois exactement. Depuis le 11 juillet , en fait que cela me titillait. Le mac évangéliste en moi était en sevrage… jusqu’à samedi dernier. J’ai couru chez Rogers me procurer mon iPhone! Enfin. Le téléphone le plus évolué, le plus sexy, le plus techno était enfin à moi! D’une pierre, deux coups je me débarrassais de mon Motorola (avec l’écran qui disparaît au soleil… remarquez que je n’ai pas eu trop de misère avec ce problème, cet été) mais tout autant de Bell. En changeant pour un iPhone, je devais changer de fournisseur de réseau. Apple ayant décidé d’avoir un fournisseur unique par pays et Rogers étant le seul à offrir la technologie 3G au Canada, je devais me résoudre à quitter Bell. C’est de l’ironie, bien sûr. En fait, j’étais très heureux de. Pourquoi? Parce qu’à plus d’une occasion, ils ont réussi à m’extirper le plus de dollars qu’ils pouvaient par des frais supplémentaires et me faire mourir en ligne avec un service à la clientèle déficient. Émilie (la chipie robotisée qui vous fait patienter en tentant de vous trouver un conseiller), je te quitte… juste un peu, quand même, puisque mon accès internet et ma ligne téléphonique sont encore hébergés chez vous… mais il y a comme une brèche de créée. Puisque l’on parle de Bell, ils ont changé leur logo la semaine passée. Que dire? Qu’ils ont tenté de revenir à la base, mais sans succès? Originalement conçu très sobre (par Frédéric Metz – quel designer et communicateur! – il me semble…), le logotype de Bell avait été remplacé dans les années 90 par l’affreux personnage avec un cerceau autour du crâne et une version italique de la typographie originale. C’était moche et de mauvais goût. Là, on revient à la base avec un logotype plus simple, mais le choix typographique ne me revient pas. Je suis un mauvais juge? Peut-être. Cela vous démontre les limites et la complexité d’une marque. Ma mauvaise expérience avec Bell ne me fait guère apprécier ses communications. Son slogan « La vie est Bell » n’a aucun impact sur moi, parce que, pour moi, la vie est mieux « sans » Bell. Aucune publicité, slogan, redesign ne me fera changer d’avis. La vie d’une marque est fragile et complexe. Une compagnie a beau tenter de rattraper le coup, tenter de reconquérir, son histoire d’amour avec sa clientèle tient plus à une expérience globale qu’à un voeu pieux publicitaire. Ma vie est belle quand je ne reçois pas de surfacturation de mon fournisseur de cellulaire. Ma vie est belle quand on répond à mon appel de service avant 1 heure. Ma vie n’est pas plus belle parce que l’on me dit que la vie est belle. La vie est belle parce que j’ai mon iPhone.
Un mois. J’ai pu me retenir un mois. Un mois exactement. Depuis le 11 juillet , en fait que cela me titillait. Le mac évangéliste en moi était en sevrage… jusqu’à samedi dernier. J’ai couru chez Rogers me procurer mon iPhone! Enfin. Le téléphone le plus évolué, le plus sexy, le plus techno était enfin à moi! D’une pierre, deux coups je me débarrassais de mon Motorola (avec l’écran qui disparaît au soleil… remarquez que je n’ai pas eu trop de misère avec ce problème, cet été) mais tout autant de Bell. En changeant pour un iPhone, je devais changer de fournisseur de réseau. Apple ayant décidé d’avoir un fournisseur unique par pays et Rogers étant le seul à offrir la technologie 3G au Canada, je devais me résoudre à quitter Bell. C’est de l’ironie, bien sûr. En fait, j’étais très heureux de. Pourquoi? Parce qu’à plus d’une occasion, ils ont réussi à m’extirper le plus de dollars qu’ils pouvaient par des frais supplémentaires et me faire mourir en ligne avec un service à la clientèle déficient. Émilie (la chipie robotisée qui vous fait patienter en tentant de vous trouver un conseiller), je te quitte… juste un peu, quand même, puisque mon accès internet et ma ligne téléphonique sont encore hébergés chez vous… mais il y a comme une brèche de créée. Puisque l’on parle de Bell, ils ont changé leur logo la semaine passée. Que dire? Qu’ils ont tenté de revenir à la base, mais sans succès? Originalement conçu très sobre (par Frédéric Metz – quel designer et communicateur! – il me semble…), le logotype de Bell avait été remplacé dans les années 90 par l’affreux personnage avec un cerceau autour du crâne et une version italique de la typographie originale. C’était moche et de mauvais goût. Là, on revient à la base avec un logotype plus simple, mais le choix typographique ne me revient pas. Je suis un mauvais juge? Peut-être. Cela vous démontre les limites et la complexité d’une marque. Ma mauvaise expérience avec Bell ne me fait guère apprécier ses communications. Son slogan « La vie est Bell » n’a aucun impact sur moi, parce que, pour moi, la vie est mieux « sans » Bell. Aucune publicité, slogan, redesign ne me fera changer d’avis. La vie d’une marque est fragile et complexe. Une compagnie a beau tenter de rattraper le coup, tenter de reconquérir, son histoire d’amour avec sa clientèle tient plus à une expérience globale qu’à un voeu pieux publicitaire. Ma vie est belle quand je ne reçois pas de surfacturation de mon fournisseur de cellulaire. Ma vie est belle quand on répond à mon appel de service avant 1 heure. Ma vie n’est pas plus belle parce que l’on me dit que la vie est belle. La vie est belle parce que j’ai mon iPhone.