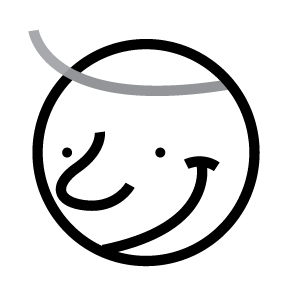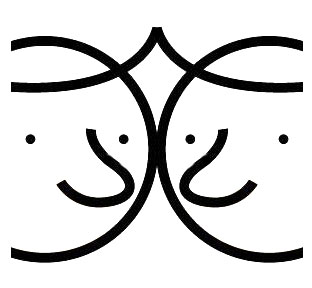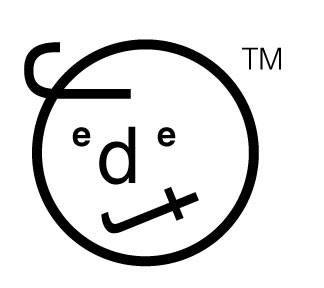Macho Macho Man, I’d rather be a…
 Cette semaine on a eu droit à une mini tempête médiatique au sujet d’une publicité virale diffusée sur YouTube mettant en vedette le joueur des Canadiens de Montréal, Georges Laraque et de séduisantes nymphettes jouant au hockey bottine pour nous vanter les vertus d’une boisson énergétique alcoolisée (la pub est ici). Publicité banale et insipide comme le sont ces centaines de publicités de bière avec des bébés-big-boobs et des mecs-aux-pecs-impecs : y a de la joie, du party, de la plage, de la séduction, bref, le genre de pub qui oublie de nous dire que finalement le seul attrait physique qu’on risque d’avoir si on consomme trop du produit vanté n’est pas celui présenté à l’écran, mais une énorme bedaine de bière. La communauté blogueuse a largement couvert l’événement et contribué, en la diffusant, à créer le buzz recherché. La tempête a été déclarée par Axelle Beniey, de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, traitant la publicité de dégradante pour les femmes, de mauvaises images pour la jeunesse, bla-bla-bla… La cassette. Je suis tanné de ces sempiternels sermons rétrogrades de féminisme post 68; nous sommes presque en 2010, bordel! Ce qui me fait doublement pomper c’est que nous n’entendons jamais ce genre d’exposé dénonciateur quand on ridiculise des hommes dans des publicités… Un article très intéressant paru en août dans la section « affaires » du Globe And Mail (« Why men in ads are dumb goofy or completely inept » pas de lien disponible, sauf si vous êtes abonné au GAM) parlait d’une nouvelle tendance en publicité, celle de la misandrie (ho! ho! beau mot à chercher dans le dico). La mode est à réaliser des pubs où, dans plein de contextes différents, les hommes sont dépeints comme des incapables, des simplets, des gaffeurs ou de parfaits imbéciles surtout si on les compare directement à leurs épouses. Exemple : un homme a le rhume et se transforme immédiatement en gamin; un homme incapable de se retenir devant une plaque de biscuit préparée pas sa gentille épouse se brûle les doigts et finalement un homme joue le rôle d’un chat qui cherche à se faire nourrir par sa maîtresse (je n’ose imaginer quelle onde de choc celle-ci aurait créée si on avait inversé les rôles des protagonistes!). Ironiquement, ces publicités, toujours selon l’article, plaisent énormément aux femmes qui ne voient rien de bien méchant dans celles-ci. N’est-ce pas là un exemple de double discours? Pour citer un commentaire d’un lecteur sur le blogue de Patrick Lagacé à ce sujet : « si ça avait été Alexandra Wosniak qui jouait au tennis avec des Cupidons en boxers, ça aurait été tout à fait correct.» Deux poids, deux mesures. Comme le principe de la discrimination positive (comment de la discrimination peut-elle être positive!!!). La publicité dans laquelle Laraque joue est une mauvaise publicité. Point. Il ne faut rien chercher de plus que ça. L’exploitation du corps de la femme n’y est pas plus évidente que dans des pubs du même genre. Ni plus, ni moins. Madame Beniey, choisissez vos combats, celui-là n’en vaut pas la peine.
Cette semaine on a eu droit à une mini tempête médiatique au sujet d’une publicité virale diffusée sur YouTube mettant en vedette le joueur des Canadiens de Montréal, Georges Laraque et de séduisantes nymphettes jouant au hockey bottine pour nous vanter les vertus d’une boisson énergétique alcoolisée (la pub est ici). Publicité banale et insipide comme le sont ces centaines de publicités de bière avec des bébés-big-boobs et des mecs-aux-pecs-impecs : y a de la joie, du party, de la plage, de la séduction, bref, le genre de pub qui oublie de nous dire que finalement le seul attrait physique qu’on risque d’avoir si on consomme trop du produit vanté n’est pas celui présenté à l’écran, mais une énorme bedaine de bière. La communauté blogueuse a largement couvert l’événement et contribué, en la diffusant, à créer le buzz recherché. La tempête a été déclarée par Axelle Beniey, de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, traitant la publicité de dégradante pour les femmes, de mauvaises images pour la jeunesse, bla-bla-bla… La cassette. Je suis tanné de ces sempiternels sermons rétrogrades de féminisme post 68; nous sommes presque en 2010, bordel! Ce qui me fait doublement pomper c’est que nous n’entendons jamais ce genre d’exposé dénonciateur quand on ridiculise des hommes dans des publicités… Un article très intéressant paru en août dans la section « affaires » du Globe And Mail (« Why men in ads are dumb goofy or completely inept » pas de lien disponible, sauf si vous êtes abonné au GAM) parlait d’une nouvelle tendance en publicité, celle de la misandrie (ho! ho! beau mot à chercher dans le dico). La mode est à réaliser des pubs où, dans plein de contextes différents, les hommes sont dépeints comme des incapables, des simplets, des gaffeurs ou de parfaits imbéciles surtout si on les compare directement à leurs épouses. Exemple : un homme a le rhume et se transforme immédiatement en gamin; un homme incapable de se retenir devant une plaque de biscuit préparée pas sa gentille épouse se brûle les doigts et finalement un homme joue le rôle d’un chat qui cherche à se faire nourrir par sa maîtresse (je n’ose imaginer quelle onde de choc celle-ci aurait créée si on avait inversé les rôles des protagonistes!). Ironiquement, ces publicités, toujours selon l’article, plaisent énormément aux femmes qui ne voient rien de bien méchant dans celles-ci. N’est-ce pas là un exemple de double discours? Pour citer un commentaire d’un lecteur sur le blogue de Patrick Lagacé à ce sujet : « si ça avait été Alexandra Wosniak qui jouait au tennis avec des Cupidons en boxers, ça aurait été tout à fait correct.» Deux poids, deux mesures. Comme le principe de la discrimination positive (comment de la discrimination peut-elle être positive!!!). La publicité dans laquelle Laraque joue est une mauvaise publicité. Point. Il ne faut rien chercher de plus que ça. L’exploitation du corps de la femme n’y est pas plus évidente que dans des pubs du même genre. Ni plus, ni moins. Madame Beniey, choisissez vos combats, celui-là n’en vaut pas la peine.
Billets que vous pourriez aimer
Prêt pour la « vraie » vie?
 Vendredi dernier, je recevais à mon bureau une jeune étudiante du Cégep de Jonquière inscrite en ATM (Arts et Technologie des Médias). Sa mère qui travaille dans le milieu des médias m’avait référé afin de lui brosser un tableau assez réel de la profession de créateur publicitaire. Sous forme d’entrevue, j’ai répondu aux questions à la fois candides et pertinentes de mon apprentie journaliste. Je dis candide avec beaucoup de respect, car je trouve que la jeunesse a cette qualité, souvent hélas de moins en moins véhiculée aujourd’hui, d’être animé par cette petite flamme qu’on appelle la passion. Si pour elle, cette entrevue avait pour but de mieux orienter son choix de carrière en optant pour la création publicitaire (au lieu d’animateur/ journaliste/ technicienne/ etc.), pour moi ce fut un bel exercice d’introspection. Même si ce blogue me permet assez souvent d’écrire des réflexions sur le sujet, le fait de répondre à des questions précises à quelqu’un dont le but est de suivre mes traces était un exercice différent pas mal intéressant. Dans ce genre de situation, je suis assez volubile. J’adore parler de ce que je fais dans la vie. Je me sens surtout privilégié d’exercer un métier que j’adore qui me permet de bien gagner ma vie tout en me réalisant personnellement. Je sais que c’est plutôt cliché comme affirmation, mais le fait demeure qu’autour de soi, trop peu de gens sont heureux de leurs sort professionnel, comptant les jours comme des détenus jusqu’à leur libération (lire retraite). Ce que j’ai particulièrement apprécié dans cette rencontre, c’est surtout le fait que cette étudiante décide de rencontrer quelqu’un comme moi qui travaille tous les jours dans le domaine afin de lui brosser un portrait juste et précis du quotidien qui l’attend à la fin de son cours. Non pas que je doute que ses professeurs le fassent, mais la pratique est souvent loin de l’apprentissage. Je pense qu’il est impensable de choisir une formation collégiale ou universitaire et de ne pas faire plusieurs stages en milieu de travail, ne serait-ce qu’au début de simples stages d’observation. Dans une autre vie professionnelle, j’ai eu l’occasion de prendre des stagiaires d’ATM, en fin de formation. Toutes les fois, je suis arrivé à la même conclusion qu’eux : pourquoi avoir attendu à la fin de leur formation pour leur faire découvrir la réalité qui les attendait? Trois ans en vase clos, dans une classe douillette, à apprendre « théoriquement » la profession, parce que la vraie vie est la plupart du temps bien différente des grandes théories. Je me souviens surtout de stagiaires gonflés à bloc, persuadés d’être prêts à faire flèches de tout bois, se dégonfler tout doucement pour se rendre compte que le métier n’était peut-être pas ce à quoi ils s’attendaient. Pas plaisant ça. Et surtout évitable. Je pense que les étudiants gagnent à se frotter au milieu, à mieux saisir leur futur, à mieux challenger leurs professeurs au retour d’un stage en leur soumettant des questions plus précises de manière à réorienter le tir; et c’est finalement le métier qui gagne, en fin de compte, à mieux former sa relève.
Vendredi dernier, je recevais à mon bureau une jeune étudiante du Cégep de Jonquière inscrite en ATM (Arts et Technologie des Médias). Sa mère qui travaille dans le milieu des médias m’avait référé afin de lui brosser un tableau assez réel de la profession de créateur publicitaire. Sous forme d’entrevue, j’ai répondu aux questions à la fois candides et pertinentes de mon apprentie journaliste. Je dis candide avec beaucoup de respect, car je trouve que la jeunesse a cette qualité, souvent hélas de moins en moins véhiculée aujourd’hui, d’être animé par cette petite flamme qu’on appelle la passion. Si pour elle, cette entrevue avait pour but de mieux orienter son choix de carrière en optant pour la création publicitaire (au lieu d’animateur/ journaliste/ technicienne/ etc.), pour moi ce fut un bel exercice d’introspection. Même si ce blogue me permet assez souvent d’écrire des réflexions sur le sujet, le fait de répondre à des questions précises à quelqu’un dont le but est de suivre mes traces était un exercice différent pas mal intéressant. Dans ce genre de situation, je suis assez volubile. J’adore parler de ce que je fais dans la vie. Je me sens surtout privilégié d’exercer un métier que j’adore qui me permet de bien gagner ma vie tout en me réalisant personnellement. Je sais que c’est plutôt cliché comme affirmation, mais le fait demeure qu’autour de soi, trop peu de gens sont heureux de leurs sort professionnel, comptant les jours comme des détenus jusqu’à leur libération (lire retraite). Ce que j’ai particulièrement apprécié dans cette rencontre, c’est surtout le fait que cette étudiante décide de rencontrer quelqu’un comme moi qui travaille tous les jours dans le domaine afin de lui brosser un portrait juste et précis du quotidien qui l’attend à la fin de son cours. Non pas que je doute que ses professeurs le fassent, mais la pratique est souvent loin de l’apprentissage. Je pense qu’il est impensable de choisir une formation collégiale ou universitaire et de ne pas faire plusieurs stages en milieu de travail, ne serait-ce qu’au début de simples stages d’observation. Dans une autre vie professionnelle, j’ai eu l’occasion de prendre des stagiaires d’ATM, en fin de formation. Toutes les fois, je suis arrivé à la même conclusion qu’eux : pourquoi avoir attendu à la fin de leur formation pour leur faire découvrir la réalité qui les attendait? Trois ans en vase clos, dans une classe douillette, à apprendre « théoriquement » la profession, parce que la vraie vie est la plupart du temps bien différente des grandes théories. Je me souviens surtout de stagiaires gonflés à bloc, persuadés d’être prêts à faire flèches de tout bois, se dégonfler tout doucement pour se rendre compte que le métier n’était peut-être pas ce à quoi ils s’attendaient. Pas plaisant ça. Et surtout évitable. Je pense que les étudiants gagnent à se frotter au milieu, à mieux saisir leur futur, à mieux challenger leurs professeurs au retour d’un stage en leur soumettant des questions plus précises de manière à réorienter le tir; et c’est finalement le métier qui gagne, en fin de compte, à mieux former sa relève.
Billets que vous pourriez aimer
On parle de goût, pas dégout.
 Ça arrive à l’occasion. Pas souvent, mais juste assez pour en parler ici. Je campe une situation tout à faite fictive. Dans celle çi, je présente la maquette d’un projet à un client, celui-ci réagit de cette façon : il aime bien le concept, l’idée générale, le slogan, le body copy, tout baigne, MAIS je vois bien que quelque chose le titille. Il me dit qu’il déteste la couleur dominante. Ce n’est pas dans sa palette. Il n’aime pas. Et il n’en démord pas. « Ce n’est pas beau! » Comme un enfant qui dit : « C’est pas bon! » Tu as beau expliquer que c’est une couleur très tendance, saisonnière, représentative, contrastante, différente, complémentaire, tendre, pimpante, apaisante, tonique, froide, chaude, distinctive, full 80’s, full 70’s, full mode-genre-truc… « Ce n’est pas beau! » Point. Il ne dit pas que cette couleur est inappropriée, ni qu’elle manque de contraste. Non. Il n’aime pas. Point. En fait, il serait quasiment prêt à saborder le concept tellement il la déteste. L’idée sort moins bien sur cette couleur, bla-bla, le slogan est moins bon sur cette couleur, bla-bla, bref, y a vraiment rien qui va. Uniquement par rapport à ses goûts personnels. Pas de logique. Pur sentiment. On parle de couleur, mais il va de même pour la typographie. « Haaaa, pas en italique! Je déteste les italiques… C’est laid des italiques! C’est moche des italiques! C’est croche des italiques! » « Pourquoi utilises-tu des italiques? Ce n’est pas beau! » Beau? Moi, je trouve le contraire. J’aime bien les italiques. C’est pourtant utile des italiques. Ça danse des italiques. Ça s’exprime des italiques. Ç’est délicat. Instable. Charmant. Plein de qualités. Mais ça ne passe pas. Les arguments techniques, professionnels, rationnels, historiques et métaphysiques n’ébranlent pas la haine que l’on peut porter à ce style typographique. Rien à faire. Le dégoût l’emporte. « Et mon logo, il pourrait être plus gros? Vraiment très gros! Parce que j’ai lu le livre de monsieur Truc – 101 trucs publicitaires – et il le dit, lui, à la page 64, que le logo n’est jamais assez gros… » Heu. Je suis bouche bée là. « Vous ne l’avez pas lu? » Non désolé, seulement feuilleté. Ce n’est pas mon truc, les trucs de M. Trucs. Mais, si c’est écrit, c’est donc vrai, non? Oui, comme ce blogue. « Mais vous n’êtes pas M. Truc! » Revenons à notre maquette, maintenant que je l’ai modifiée à votre goût. Pardon? Vous me demandez c’est quoi ces minuscules bidules autour de votre logo ? C’est votre concept, monsieur. J’ai pensé vous faire plaisir, alors j’ai mis votre logo gros comme la page et j’ai mis un tout petit concept, gros comme un pois (mais pas vert, car vous trouvez que c’est laid, le vert), minuscule, microscopique, de façon à ne pas nuire à votre logo, j’ai mis le slogan en minuscule Arial (je n’ai pas osé mettre Helvetica…). Place au logo! Comme Monsieur Truc le dit. En page 64. 101 trucs publicitaires. L’évangile selon Truc. Les recettes publicitaires de Truc. Ajoutez seulement de l’eau. Concept en poudre. Évitez d’inhaler. Peut vous donner une apparence normale, parfaitement comme tout le monde. Pour être certain de ne pas vous démarquer. N’est-ce pas qu’il est bien votre logo comme ça dans la page. Il prend toute la place et comme ça, tout le monde c’est que c’est vous qui annoncez. Génial non? Vous serez vu. C’est ce qu’on veut est être vu, non? . Pas nécessairement compris ou apprécié, mais vu.
Ça arrive à l’occasion. Pas souvent, mais juste assez pour en parler ici. Je campe une situation tout à faite fictive. Dans celle çi, je présente la maquette d’un projet à un client, celui-ci réagit de cette façon : il aime bien le concept, l’idée générale, le slogan, le body copy, tout baigne, MAIS je vois bien que quelque chose le titille. Il me dit qu’il déteste la couleur dominante. Ce n’est pas dans sa palette. Il n’aime pas. Et il n’en démord pas. « Ce n’est pas beau! » Comme un enfant qui dit : « C’est pas bon! » Tu as beau expliquer que c’est une couleur très tendance, saisonnière, représentative, contrastante, différente, complémentaire, tendre, pimpante, apaisante, tonique, froide, chaude, distinctive, full 80’s, full 70’s, full mode-genre-truc… « Ce n’est pas beau! » Point. Il ne dit pas que cette couleur est inappropriée, ni qu’elle manque de contraste. Non. Il n’aime pas. Point. En fait, il serait quasiment prêt à saborder le concept tellement il la déteste. L’idée sort moins bien sur cette couleur, bla-bla, le slogan est moins bon sur cette couleur, bla-bla, bref, y a vraiment rien qui va. Uniquement par rapport à ses goûts personnels. Pas de logique. Pur sentiment. On parle de couleur, mais il va de même pour la typographie. « Haaaa, pas en italique! Je déteste les italiques… C’est laid des italiques! C’est moche des italiques! C’est croche des italiques! » « Pourquoi utilises-tu des italiques? Ce n’est pas beau! » Beau? Moi, je trouve le contraire. J’aime bien les italiques. C’est pourtant utile des italiques. Ça danse des italiques. Ça s’exprime des italiques. Ç’est délicat. Instable. Charmant. Plein de qualités. Mais ça ne passe pas. Les arguments techniques, professionnels, rationnels, historiques et métaphysiques n’ébranlent pas la haine que l’on peut porter à ce style typographique. Rien à faire. Le dégoût l’emporte. « Et mon logo, il pourrait être plus gros? Vraiment très gros! Parce que j’ai lu le livre de monsieur Truc – 101 trucs publicitaires – et il le dit, lui, à la page 64, que le logo n’est jamais assez gros… » Heu. Je suis bouche bée là. « Vous ne l’avez pas lu? » Non désolé, seulement feuilleté. Ce n’est pas mon truc, les trucs de M. Trucs. Mais, si c’est écrit, c’est donc vrai, non? Oui, comme ce blogue. « Mais vous n’êtes pas M. Truc! » Revenons à notre maquette, maintenant que je l’ai modifiée à votre goût. Pardon? Vous me demandez c’est quoi ces minuscules bidules autour de votre logo ? C’est votre concept, monsieur. J’ai pensé vous faire plaisir, alors j’ai mis votre logo gros comme la page et j’ai mis un tout petit concept, gros comme un pois (mais pas vert, car vous trouvez que c’est laid, le vert), minuscule, microscopique, de façon à ne pas nuire à votre logo, j’ai mis le slogan en minuscule Arial (je n’ai pas osé mettre Helvetica…). Place au logo! Comme Monsieur Truc le dit. En page 64. 101 trucs publicitaires. L’évangile selon Truc. Les recettes publicitaires de Truc. Ajoutez seulement de l’eau. Concept en poudre. Évitez d’inhaler. Peut vous donner une apparence normale, parfaitement comme tout le monde. Pour être certain de ne pas vous démarquer. N’est-ce pas qu’il est bien votre logo comme ça dans la page. Il prend toute la place et comme ça, tout le monde c’est que c’est vous qui annoncez. Génial non? Vous serez vu. C’est ce qu’on veut est être vu, non? . Pas nécessairement compris ou apprécié, mais vu.
MAJ
Après les commentaires reçus sur Facebook à la suite de la parution de ce billet (j’aurais aimé avoir les commentaires ici, mais l’important c’est d’en avoir…), j’ai senti le besoin d’approfondir ce billet. C’est vachement drôle les perceptions. Je n’ai pas eu l’impression de me lamenter dans ce billet, mais plutôt de tenter d’expliquer uniquement qu’un client peut avoir de la difficulté (quelques fois) à prendre un certain recul par rapport à son entreprise. Le fait d’engager un gars comme moi est déjà une ouverture et surtout une manière d’accepter de se faire dire par quelqu’un d’autre qu’on serait mieux de se présenter de telle ou telle façon. Et de faire confiance. C’est surtout l’aspect majeur que je voulais que l’on comprenne de ce billet. Surtout pas que je considère mes clients comme des plaies qui agissent en bornés. J’ai trop de respect pour eux pour ça. Ce qui est difficile dans un métier comme le mien est de faire accepter des idées qui ne sont pas là pour faire plaisir ou plaire à mon client, mais bien aux clients de mes clients. C’est une nuance majeure. J’ai déjà présenté à un client un projet monté pour des adolescents. Lors du dévoilement de mon créatif, le client a eu une réaction intéressante : il m’a dit qu’il n’aimait pas vraiment le style de graphisme utilisé, mais qu’il considérait que c’était normal puisqu’il avait 55 ans et donc très loin du marché cible auquel cette production s’adressait. Pas facile comme exercice, mais tellement important et promordial. C’est ce que je pense qui fait toute la différence. Je ne fais pas de la pub ou du design pour moi, ni pour mes clients, mais pour les clients de mes clients. Il faut être en mesure de faire abstraction de ses goûts personnels, moi le premier, et penser en fonction de notre clientèle visée. Voilà, pour la mise à jour.
Billets que vous pourriez aimer
Vision 2025.
 Vendredi, j’assistais au Forum Vision 2025, forum sur l’enjeu de la relance économique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une activité organisée par le centre de recherche sur le développement territorial de l’UQAC. En fait, j’étais panelliste avec 5 autres intervenants à la table ronde sur « la mise en valeur du capital de créativité régional ». Bien que le forum fût un exercice très théorique, j’ai aimé l’expérience et apprécié échanger avec des gens de différents milieux sur le sujet fascinant qu’est la créativité. Voici le texte que j’avais préparé pour l’occasion…
Vendredi, j’assistais au Forum Vision 2025, forum sur l’enjeu de la relance économique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une activité organisée par le centre de recherche sur le développement territorial de l’UQAC. En fait, j’étais panelliste avec 5 autres intervenants à la table ronde sur « la mise en valeur du capital de créativité régional ». Bien que le forum fût un exercice très théorique, j’ai aimé l’expérience et apprécié échanger avec des gens de différents milieux sur le sujet fascinant qu’est la créativité. Voici le texte que j’avais préparé pour l’occasion…
Quand j’étais étudiant en design graphique à l’UQAM, mes professeurs venaient presque tous d’Europe. Ce qu’on m’enseignait était la façon de faire européenne en matière d’idéation : une façon de faire basée sur la créativité des idées et non sur leur faisabilité. Il y avait là une grande nuance. Alors que les autres universités préparaient des designers pratiquants, beaucoup plus bercés par des principes américains, l’UQAM, elle, forçait ses étudiants à se questionner, à trouver des idées nouvelles, sans se badrer des contraintes d’essayer de les réaliser. Libéré de cette emprise, naissaient des idées quelques fois farfelues, impossibles et parfois vertigineuses, mais rarement ennuyantes. Je suis avant tout un gars de pub. Un gars qui vous vend des trucs. Pas les siennes, celles de ses clients. Tous les jours, je me creuse la tête pour trouver une idée qui va me permettre de vous présenter mon client sous son meilleur jour. Tous les jours, je cherche une façon de démarquer mes clients par rapport à sa concurrence qu’elle soit locale ou nationale. Chaque jour, finalement, je suis imputable aux idées que je soumets à mes clients. C’est ma seule planche de salut. La créativité est mon leitmotiv. Mon Do It Or Die. C’est mon quotidien. Le dossier le plus difficile à réaliser est celui dont le budget n’a pas d’importance, dont les délais sont flous et les conséquences de retard absentes. L’ennemi de la créativité, c’est la liberté totale. De la contrainte naît la créativité. Et avouez que des contraintes, dans une région comme la nôtre, c’est assez facile à trouver. Il faut toujours faire plus avec moins. Il faut être en mesure de propulser nos forces et de combler nos faiblesses. Prenons par exemple le tourisme : pourquoi s’acharne-t’-on à jouer dans les mêmes plates-bandes que les autres régions. On n’arrête pas de nous dire que nos étés sont pourris, mais que notre hiver est époustouflant et que ça nous distingue, pour quoi ne pas faire de l’hiver, notre principale destination et laissez l’été aux autres. Pourquoi qu’à chaque fois qu’un entrepreneur nous épate avec un nouveau produit, on se précipite à faire la même chose pour être certain que le marché se dilue et devient obsolète. Pourquoi faut-il toujours que nos idées soient calquées sur des idées d’ailleurs. Pourquoi quand tout le monde zig, on ne zag pas? Il faut oser. Les gens qui réussissent à redéfinir leur profession, à sortir des sentiers battus, à créer des nouvelles façons de voir et de faire, le font souvent à contre courant des marchés, des demandes et des modes. Il faut cesser d’avoir peur d’être différent. Il faut cesser d’avoir peur des nouvelles idées. Il faut cesser d’avoir peur d’avoir peur. Vous me parlez de créativité, je vous parlerai de travail. Laissez-moi vous louanger les vertus de la sueur de bras. Laissez-moi surtout la chance de redonner au mot « labeur » ses lettres de noblesse. Parce que l’on a trop souvent dénigré, ces dernières années, les gens qui travaillent trop; vous comprendrez ici que le mot trop est entre guillemets. Parce que notre société de loisirs a décidé que la notion de travail ne devrait plus occuper la place qui lui revient. On a droit à une belle campagne qui nous dit qu’ici c’est possible, il faudrait en faire une aussi qui dit que travailler plus, c’est aussi possible et ça rapporte. Il faut valoriser les initiatives. Notre lourd passé syndical nous a fait rouler trop longtemps sur la voie de service; prenons notre place sur la grand-route et mettons-nous au travail. Félicitons les initiatives. Il faut se responsabiliser. J’adhère au principe de 1 % d’inspiration pour 99 % de transpiration. Des idées c’est assez facile à trouver, des bonnes, ça prend pas mal plus de temps. La région est-elle prête à mettre autant d’effort à s’en sortir? La région est-elle prête à prendre des risques? À se mettre à penser autrement? À se mettre à travailler plus fort? Rassurez-moi.
> Image générée par le site Mad Men Yourself – où il est possible de vous transformer en un personnage de ma série télé préférée.
Billets que vous pourriez aimer
Oser.
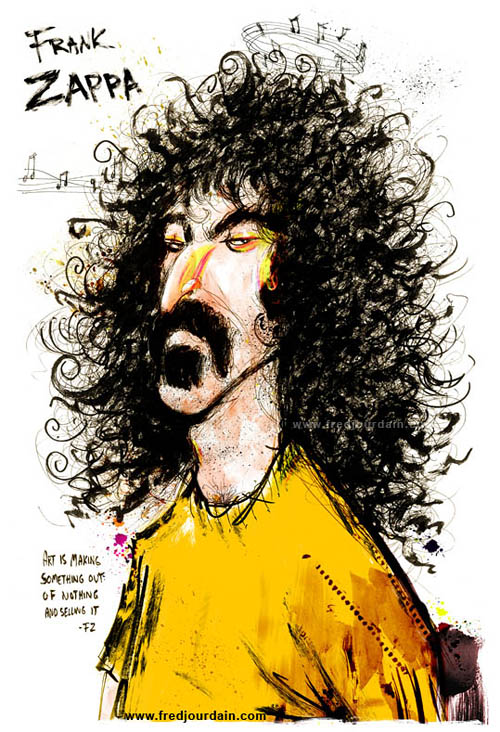 L’ami et commentateur régulier de ce blogue, Martin Larose de l’UQAC, m’a fait parvenir une entrevue vraiment intéressante de Frank Zappa prise sur YouTube. Le lien pour l’écouter est ici. Dans cette entrevue, Zappa raconte sa vision personnelle de l’industrie du disque et tente surtout d’y expliquer son déclin (on parle quand même d’une entrevue qui date de plus de 25 ans…). Une des pistes qu’il développe est la différence majeure d’attitude des anciens patrons de labels comparativement à celles des nouveaux (de l’époque…). Avant, dit Zappa, tu rencontrais le big boss d’une compagnie de disques qui ne comprenait rien à ta musique, l’enregistrait quand même et tu en faisais un autre si tu réussissais à en vendre contrairement aux nouveaux patrons qui décident qu’est-ce que l’on écoutera maintenant, en tentant d’établir la nouvelle tendance. Il arrive quoi alors? Une certaine standardisation de la musique, basée sur les modes, les cotes d’écoute et les émissions de radios insipides toutes ressemblantes les unes des autres. Ne faut surtout pas sortir du lot. Dans ce contexte, un gars comme Frank Zappa n’aurait jamais endisqué… Les propos du compositeur prolifique sont tellement encore aujourd’hui (et plus que jamais) criants de vérité qu’on aurait tendance à extrapoler ses conclusions vers d’autres domaines que celui de la musique : la pub et le graphisme, par exemple. Combien de concepts semblables circulent sous nos yeux? Combien de pubs sont créées quasiment dans des moules ou seul le logo différencie une marque d’une autre. Combien d’annonceurs réussissent à passer inaperçus en marchant dans les mêmes traces que ceux de leurs concurrents? Combien de clients demandent de faire une pub « à la sauce » telle? Comme ci. Comme ça. Trouvant rassurant l’idée de suivre la tendance, au lieu de risquer et de la créer. La faute n’est pas unidirectionnelle, vous vous en doutez bien. Les agences ont leur grosse part de responsabilité en préférant jouer sur des terrains connus, facilement exécutables avec à la clef une facture avec une meilleure marge. Travailler dans du connu, c’est rassurant et plutôt payant pour une boîte. Sortir des sentiers battus, c’est une autre paire de manches : les risques de déplaire aux clients, de travailler plus longtemps sur un dossier, dépasser une échéance due à l’estimation de temps plus complexe de l’inconnu. Quand un consultant, comme moi, décide de livrer un produit à forfait, la tentation de tomber dans ce qu’il fait le mieux (donc déjà moins créatif et nouveau) est le piège le plus difficile à éviter. Décider de prendre plus d’heures à réaliser un dossier et d’assumer ce dépassement et de ne pas le faire payer par le client n’est pas toujours une décision facile à prendre. Mais c’est souvent le prix à payer pour ne pas s’embourber dans des recettes qui goûtent le réchauffé. Quand je présente un concept différent qui casse le quotidien, j’aime qu’un client fasse comme ce vieux patron auquel Zappa fait référence dans son entrevue et qu’il prenne le risque de l’accepter et de créer un stunt avec. Au contraire, je ne comprends toujours pas pourquoi un client vient me voir pour me demander la même chose qu’il a vue ailleurs. Oser. Prendre des risques. Casser la routine. Comme disait Zappa : Why do you necessarily have to be wrong just because a few million people think you are?
L’ami et commentateur régulier de ce blogue, Martin Larose de l’UQAC, m’a fait parvenir une entrevue vraiment intéressante de Frank Zappa prise sur YouTube. Le lien pour l’écouter est ici. Dans cette entrevue, Zappa raconte sa vision personnelle de l’industrie du disque et tente surtout d’y expliquer son déclin (on parle quand même d’une entrevue qui date de plus de 25 ans…). Une des pistes qu’il développe est la différence majeure d’attitude des anciens patrons de labels comparativement à celles des nouveaux (de l’époque…). Avant, dit Zappa, tu rencontrais le big boss d’une compagnie de disques qui ne comprenait rien à ta musique, l’enregistrait quand même et tu en faisais un autre si tu réussissais à en vendre contrairement aux nouveaux patrons qui décident qu’est-ce que l’on écoutera maintenant, en tentant d’établir la nouvelle tendance. Il arrive quoi alors? Une certaine standardisation de la musique, basée sur les modes, les cotes d’écoute et les émissions de radios insipides toutes ressemblantes les unes des autres. Ne faut surtout pas sortir du lot. Dans ce contexte, un gars comme Frank Zappa n’aurait jamais endisqué… Les propos du compositeur prolifique sont tellement encore aujourd’hui (et plus que jamais) criants de vérité qu’on aurait tendance à extrapoler ses conclusions vers d’autres domaines que celui de la musique : la pub et le graphisme, par exemple. Combien de concepts semblables circulent sous nos yeux? Combien de pubs sont créées quasiment dans des moules ou seul le logo différencie une marque d’une autre. Combien d’annonceurs réussissent à passer inaperçus en marchant dans les mêmes traces que ceux de leurs concurrents? Combien de clients demandent de faire une pub « à la sauce » telle? Comme ci. Comme ça. Trouvant rassurant l’idée de suivre la tendance, au lieu de risquer et de la créer. La faute n’est pas unidirectionnelle, vous vous en doutez bien. Les agences ont leur grosse part de responsabilité en préférant jouer sur des terrains connus, facilement exécutables avec à la clef une facture avec une meilleure marge. Travailler dans du connu, c’est rassurant et plutôt payant pour une boîte. Sortir des sentiers battus, c’est une autre paire de manches : les risques de déplaire aux clients, de travailler plus longtemps sur un dossier, dépasser une échéance due à l’estimation de temps plus complexe de l’inconnu. Quand un consultant, comme moi, décide de livrer un produit à forfait, la tentation de tomber dans ce qu’il fait le mieux (donc déjà moins créatif et nouveau) est le piège le plus difficile à éviter. Décider de prendre plus d’heures à réaliser un dossier et d’assumer ce dépassement et de ne pas le faire payer par le client n’est pas toujours une décision facile à prendre. Mais c’est souvent le prix à payer pour ne pas s’embourber dans des recettes qui goûtent le réchauffé. Quand je présente un concept différent qui casse le quotidien, j’aime qu’un client fasse comme ce vieux patron auquel Zappa fait référence dans son entrevue et qu’il prenne le risque de l’accepter et de créer un stunt avec. Au contraire, je ne comprends toujours pas pourquoi un client vient me voir pour me demander la même chose qu’il a vue ailleurs. Oser. Prendre des risques. Casser la routine. Comme disait Zappa : Why do you necessarily have to be wrong just because a few million people think you are?
> Superbe illustration de Zappa réalisé par Fred Jourdain
Billets que vous pourriez aimer
Il y a de quoi fouetter un Shaw.
On peut dire que le consommateur d’aujourd’hui ne s’en laisse vraiment plus imposer. Il a en sa possession une arme de destruction massive : les médias sociaux. En un rien de temps, un groupe de protestation se forme, prend la parole et réussit à recruter des membres à la vitesse de l’éclair. Au début de l’été passé, j’avais écrit sur ce blogue un billet sur un groupe de consommateurs qui s’était formé contre Rogers, juste avant l’arrivée du iPhone au Canada. Le groupe avait tellement mis de la pression sur la corporation que celle-ci avait dû se plier aux exigences de ses clients. Dernièrement, un nouveau tollé de protestation a vu le jour, encore vis-à-vis un autre câblodistributeur canadien : Shaw. Le vidéo résume très bien la situation : l’entreprise a contacté les abonnés de son concurrent Novus (câblodistributeur localisé dans le centre de Vancouver) dans le but de de leur offir un abonnement au prix incroyable de 9,95 $ par mois (pour un forfait frisant le 150 $, normalement). Le but, non avoué de Shaw, étant de rafler une nouvelle clientèle, mais tout autant d’éliminer un petit joueur de la compétition. Le hic, c’est que l’offre n’est valable qu’aux clients de Novus, pas à d’autres. C’est ce qui a provoqué ce rassemblement virtuel de consommateurs insatisfaits : d’une part, les abonnés actuels de Shaw (Vancouver Centre) veulent avoir droit à la même promotion que les nouveaux courtisés, les abonnés d’autres entreprises que Novus aussi et finalement les clients de Shaw, d’un peu partout au Canada. Armés du site www.10buckstoo.com, de ce vidéo sur YouTube, de leur page Facebook ainsi que de leur compte Twitter, les opposants frappent fort et écorche la réputation de Shaw. Vous connaissez mon opinion sur les offres réservées uniquement aux nouveaux clients, je l’ai écrit ici. Il me semble que c’est plutôt malhabile de la part de Shaw d’avoir un tel comportement. Une entreprise a dorénavant de moins en moins de latitude par rapport à sa relation avec sa clientèle; au moindre écart de conduite, les consommateurs montrent les dents. Les rapports de force client/fournisseur changent et ne seront jamais plus les mêmes. Goliath n’a qu’à bien se tenir face à David…
Billets que vous pourriez aimer
‘Tit Kit éthique et tact
 Vous êtes sur la route et vous roulez à la limite permise. Pour être vraiment franc, vous roulez plutôt à la limite tolérée et tout à coup, venant de nulle part, arrive comme une fusée une camionnette qui vous colle au cul. Pas un peu. Votre parechoc est le dernier élément qui vous sépare d’un impact. Dans votre rétroviseur, vous pouvez voir distinctement le chauffeur. Vous voyez sa face qui grimace. Il voudrait pouvoir vous rouler dessus. Vous lui nuisez. Vous êtes un obstacle. Et comme il n’y pas de zone de dépassement possible, la seule façon de vous faire sentir que vous n’êtes pas à la vitesse que lui juge normal, il vous bouscule à la limite du tolérable en agitant les bras comme un excessif cherchant à vous intimider de toutes les façons possibles. Arrive enfin la perspective pour la camionnette de vous dépasser; le chauffard dingue en profite tout en vous infligeant un regard démoniaque. Il vous en veut. Pourtant, ce n’est pas son visage qui retient votre attention, mais bien le logo sur le côté de la fourgonnette. Ce camion n’appartient pas un particulier, mais à une compagnie. Ce camion est identifié d’une marque de commerce très connue. Et là, dans votre tête, ça fait clic!, le chauffard fou qui vient de vous menacer de son attitude de matamore n’est plus un simple dingue du volant, mais bien une marque de commerce. Vous pouvez maintenant mettre un nom sur celui qui vient de vous menacer par sa conduite dangereuse. Pas un nom personnel, mais un nom de compagnie. Vous stationnez votre voiture, marchez, et à une traverse de piéton, une automobile bien identifiée à une entreprise décide de ne pas vous laisser passer, bien que ce soit votre droit. La voiture passe à deux cheveux de vous rouler dessus. Vous arrivez quand même sain et sauf à votre restaurant préféré en maudissant cette voiture, son chauffeur et l’entreprise qui l’a engagé. Pendant que vous consultez le menu, voisin de votre table, un groupe de travailleurs habillés de leurs vestes bien identifiées du logo de leur employeur vocifèrent des propos agressifs et tiennent des discours dégradants sur des gens en ne prenant même pas la peine de taire leurs noms. Malgré votre regard désapprobateur, les hommes continuent à tenir leur tirade déplaisante. À votre retour au bureau, en consultant le profil de vos connaissances-amis sur Facebook, vous tombez sur certains qui déblatèrent que leurs employeurs sont comme ci, que leurs collègues de travail sont plutôt comme ça, sans retenue, sans vergogne, au vue de tous. Je ne comprends pas. Une entreprise peut dépenser des milliers de dollars en publicité, tenter de bien servir du mieux qu’elle peut ses clients, d’être un citoyen corporatif responsable et se voir juger et traiter de délinquant pour des gestes irréfléchis qu’elle n’a pas posés directement. Une entreprise sans reproche voit sa réputation ternie par des agissements inconcevables de certains de ses employés. Vous pouvez dire n’importe quoi sous votre nom, mais de grâce quand vous roulez dans une voiture identifiée à l’entreprise qui vous emploie, vous la représentez : VOUS êtes l’entreprise. Quand vous traitez quelqu’un de moron et que vous avez votre costume de travail avec logo, vous ne parlez pas uniquement en votre nom : VOUS êtes l’entreprise. Quand vous dites n’importe quoi sur Facebook, assurez-vous donc que votre profil n’est accessible qu’à VOS amis, pas à vos connaissances ni à vos clients. Si vous n’êtes pas d’accords avec ce que votre employeur pense, fait, produit, dites-le lui à lui, pas à nous. Ou quittez votre emploi, personne ne force personne à travailler pour soi. Ou démarrez votre propre entreprise. En espérant que vos employés ne soient pas comme vous…
Vous êtes sur la route et vous roulez à la limite permise. Pour être vraiment franc, vous roulez plutôt à la limite tolérée et tout à coup, venant de nulle part, arrive comme une fusée une camionnette qui vous colle au cul. Pas un peu. Votre parechoc est le dernier élément qui vous sépare d’un impact. Dans votre rétroviseur, vous pouvez voir distinctement le chauffeur. Vous voyez sa face qui grimace. Il voudrait pouvoir vous rouler dessus. Vous lui nuisez. Vous êtes un obstacle. Et comme il n’y pas de zone de dépassement possible, la seule façon de vous faire sentir que vous n’êtes pas à la vitesse que lui juge normal, il vous bouscule à la limite du tolérable en agitant les bras comme un excessif cherchant à vous intimider de toutes les façons possibles. Arrive enfin la perspective pour la camionnette de vous dépasser; le chauffard dingue en profite tout en vous infligeant un regard démoniaque. Il vous en veut. Pourtant, ce n’est pas son visage qui retient votre attention, mais bien le logo sur le côté de la fourgonnette. Ce camion n’appartient pas un particulier, mais à une compagnie. Ce camion est identifié d’une marque de commerce très connue. Et là, dans votre tête, ça fait clic!, le chauffard fou qui vient de vous menacer de son attitude de matamore n’est plus un simple dingue du volant, mais bien une marque de commerce. Vous pouvez maintenant mettre un nom sur celui qui vient de vous menacer par sa conduite dangereuse. Pas un nom personnel, mais un nom de compagnie. Vous stationnez votre voiture, marchez, et à une traverse de piéton, une automobile bien identifiée à une entreprise décide de ne pas vous laisser passer, bien que ce soit votre droit. La voiture passe à deux cheveux de vous rouler dessus. Vous arrivez quand même sain et sauf à votre restaurant préféré en maudissant cette voiture, son chauffeur et l’entreprise qui l’a engagé. Pendant que vous consultez le menu, voisin de votre table, un groupe de travailleurs habillés de leurs vestes bien identifiées du logo de leur employeur vocifèrent des propos agressifs et tiennent des discours dégradants sur des gens en ne prenant même pas la peine de taire leurs noms. Malgré votre regard désapprobateur, les hommes continuent à tenir leur tirade déplaisante. À votre retour au bureau, en consultant le profil de vos connaissances-amis sur Facebook, vous tombez sur certains qui déblatèrent que leurs employeurs sont comme ci, que leurs collègues de travail sont plutôt comme ça, sans retenue, sans vergogne, au vue de tous. Je ne comprends pas. Une entreprise peut dépenser des milliers de dollars en publicité, tenter de bien servir du mieux qu’elle peut ses clients, d’être un citoyen corporatif responsable et se voir juger et traiter de délinquant pour des gestes irréfléchis qu’elle n’a pas posés directement. Une entreprise sans reproche voit sa réputation ternie par des agissements inconcevables de certains de ses employés. Vous pouvez dire n’importe quoi sous votre nom, mais de grâce quand vous roulez dans une voiture identifiée à l’entreprise qui vous emploie, vous la représentez : VOUS êtes l’entreprise. Quand vous traitez quelqu’un de moron et que vous avez votre costume de travail avec logo, vous ne parlez pas uniquement en votre nom : VOUS êtes l’entreprise. Quand vous dites n’importe quoi sur Facebook, assurez-vous donc que votre profil n’est accessible qu’à VOS amis, pas à vos connaissances ni à vos clients. Si vous n’êtes pas d’accords avec ce que votre employeur pense, fait, produit, dites-le lui à lui, pas à nous. Ou quittez votre emploi, personne ne force personne à travailler pour soi. Ou démarrez votre propre entreprise. En espérant que vos employés ne soient pas comme vous…
MAJ – Selon un sondage de CareerBuilder.com (premier site d’annonces d’emplois aux États-Unis) 45 % des employeurs indiquent qu’ils utilisent les médias sociaux (comme Facebook) pour obtenir des renseignements sur les candidats; contre seulement 22 % l’an dernier… Raison de plus d’éviter de vous parader tout nu en disant des niaiseries sur votre Facebook… à moins que ce soit ce que vous voulez que les gens se rappellent quand ils pensent à vous…
À lire dans dans Technaute | Cyberpresse
Billets que vous pourriez aimer
Qui clique, s’y pique.
 Vous êtes-vous déjà demandé quel type de personne se laissait convaincre par les milliers de SPAM (ou pourriels) qui envahissent votre boîte de courriels, chaque jour? Le Messaging Anti-Abuse Working Group s’est penché sur la question et a réalisé une étude sur le sujet en juillet dernier. Les chiffres sont assez éloquents : 52 % des gens interrogés avouent avoir déjà cliqué sur le lien d’un pourriel, 12 % étaient tenté d’acheter un des produits mis en valeur comme le « Viagra », le »Penis Extender » ou des taux de crédits incroyables… Ce qui est le plus impressionnant dans cette étude c’est que malgré le faible taux d’accrochage (0,00001 % des internautes décident de passer à l’achat en cliquant sur le lien), le procédé est tout de même rentable pour les Spammers. Un seul achat par 12,5 millions d’envois suffit pour que ça le soit! Imaginez. Faut dire que le « spamming » représenterait 150 à 200 milliards de courriels par jour ou jusqu’à 97 % du volume d’échanges de courrier électronique selon Microsoft. Selon Rue89 : « Les estimations du coût moyen d’envoi d’un pourriel par des chercheurs de l’université de Vienne varient de 0,000005 à 0,004 euro. Quant aux revenus, ils sont fonction de la fréquence de réponse, qui oscille d’un produit à l’autre, mais aussi d’une étude à l’autre. Selon les mêmes chercheurs, la moyenne se situe entre 0,00001 % et 0,35 % (pour des études plus anciennes et désormais obsolètes, elle fluctuait entre 2 et 5%). Si l’on établit un lien entre la fréquence de réponse et le prix du produit, le rapport de l’université de Vienne définit à 0,00434 euro en moyenne le revenu potentiellement généré par chaque pourriel. Ce qui, pour un spammeur seul qui enverrait « seulement » un million de courriels par jour, rapporterait 130 000 euros par mois. » Si le pourriel est un fléau pour les internautes, il en est de même pour l’environnement. On a récemment estimé (selon une étude de l’éditeur d’antivirus McAfee – pour la télécharger) que l’empreinte carbone du pourriel à l’échelle mondiale correspond aux rejets de dioxyde de carbone de plus de 3 millions de voitures; 80 % de l’électricité consommée l’est d’ailleurs pendant que l’on purge nos boîtes de courriels de leur contenu indésirable… À part les instigateurs pirates qui sont à la base de ce marché illégal, personne ne bénéficie de cette calamité qu’est le pourriel. Même si on pouvait penser que les Bell et Vidéotron de ce monde profitent de ce problème pour pousser leur vente de logiciel de filtrage, les coûts attachés à leur élimination sont exponentiels.
Vous êtes-vous déjà demandé quel type de personne se laissait convaincre par les milliers de SPAM (ou pourriels) qui envahissent votre boîte de courriels, chaque jour? Le Messaging Anti-Abuse Working Group s’est penché sur la question et a réalisé une étude sur le sujet en juillet dernier. Les chiffres sont assez éloquents : 52 % des gens interrogés avouent avoir déjà cliqué sur le lien d’un pourriel, 12 % étaient tenté d’acheter un des produits mis en valeur comme le « Viagra », le »Penis Extender » ou des taux de crédits incroyables… Ce qui est le plus impressionnant dans cette étude c’est que malgré le faible taux d’accrochage (0,00001 % des internautes décident de passer à l’achat en cliquant sur le lien), le procédé est tout de même rentable pour les Spammers. Un seul achat par 12,5 millions d’envois suffit pour que ça le soit! Imaginez. Faut dire que le « spamming » représenterait 150 à 200 milliards de courriels par jour ou jusqu’à 97 % du volume d’échanges de courrier électronique selon Microsoft. Selon Rue89 : « Les estimations du coût moyen d’envoi d’un pourriel par des chercheurs de l’université de Vienne varient de 0,000005 à 0,004 euro. Quant aux revenus, ils sont fonction de la fréquence de réponse, qui oscille d’un produit à l’autre, mais aussi d’une étude à l’autre. Selon les mêmes chercheurs, la moyenne se situe entre 0,00001 % et 0,35 % (pour des études plus anciennes et désormais obsolètes, elle fluctuait entre 2 et 5%). Si l’on établit un lien entre la fréquence de réponse et le prix du produit, le rapport de l’université de Vienne définit à 0,00434 euro en moyenne le revenu potentiellement généré par chaque pourriel. Ce qui, pour un spammeur seul qui enverrait « seulement » un million de courriels par jour, rapporterait 130 000 euros par mois. » Si le pourriel est un fléau pour les internautes, il en est de même pour l’environnement. On a récemment estimé (selon une étude de l’éditeur d’antivirus McAfee – pour la télécharger) que l’empreinte carbone du pourriel à l’échelle mondiale correspond aux rejets de dioxyde de carbone de plus de 3 millions de voitures; 80 % de l’électricité consommée l’est d’ailleurs pendant que l’on purge nos boîtes de courriels de leur contenu indésirable… À part les instigateurs pirates qui sont à la base de ce marché illégal, personne ne bénéficie de cette calamité qu’est le pourriel. Même si on pouvait penser que les Bell et Vidéotron de ce monde profitent de ce problème pour pousser leur vente de logiciel de filtrage, les coûts attachés à leur élimination sont exponentiels.
> via Rue89
Billets que vous pourriez aimer
Baaaah, c’est pas compliqué…
Je fais un drôle de métier. Pas toujours évident à expliquer aux gens. Prenez par exemple ce petit vidéo de Peter Belanger qui démontre toutes les étapes de création de la couverture du magazine Macworld : 3 petites minutes pour expliquer un processus de plusieurs jours. Ce qui semble banal à première vue (une photo de deux iPhone déposés l’un sur l’autre) découle d’un long processus de réalisation. Ce qui manque à la vidéo c’est de donner l’ampleur du nombre de personnes impliquées dans le dossier : éditeur, rédacteur en chef, directeur artistique, infographiste, designer, photographe, assistant et styliste, et j’en passe quelques-uns. Ce n’est pas rien. Avec le numérique et la possibilité de tout un chacun de s’improviser « artiste » et « photographe », certains ont tendance à banaliser ce travail et penser qu’une photo se fait en claquant des doigts : Shoot and Use. Facile. C’est pas mal plus compliqué que ça. Ce genre de vidéo remet les pendules à l’heure. J’adore quand un client assiste à un shooting photo. Pour qu’il se rende compte de la complexité de la chose. Pour comprendre que tellement de détails peuvent faire la différence; une mauvaise relation sujet-photographe (dans le cas d’un mannequin), les soucis d’éclairage, les impondérables et le feeling du shooting en général. J’aime bien que le client assiste aussi pour qu’il comprenne mieux pourquoi ce shooting-là a pris deux jours au lieu d’un, que le soleil dans le cas d’un plan extérieur (et quand on shoote ailleurs qu’au Québec (blague!!!) peut nous jouer des tours quelques fois. Pour certains la présence du client est un stress supplémentaire sur un plateau. Je ne vois pas ça comme cela. Sa présence aux premières loges, au contraire, le force à donner son avis sur-le-champ, lui démontrant que ce qu’il aurait voulu qu’on tente de créer, s’il n’avait pas pu assister, est plus complexe maintenant qu’il fait partie intégrante du processus de validation en étant présent. Quand un client voit l’assistant du photographe tenter par tous les moyens d’annuler un reflet persistant sur son produit, il ne regarde plus jamais ses photos de la même manière et comprend mieux tout le travail qui se cache derrière, ce qu’il aurait appelé auparavant, un simple cliché.
Cover creation par Peter Belanger pris sur Vimeo.
Billets que vous pourriez aimer
Qui ne dit mot, con se sent.
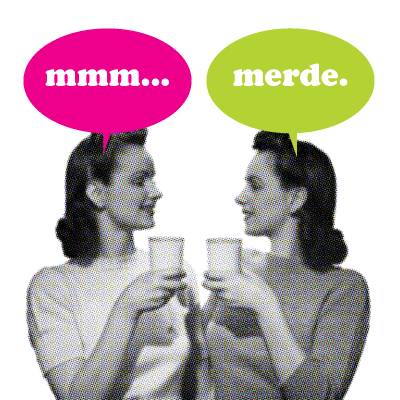 Je suis de ceux, et nous sommes nombreux, qui pensent que le web 2.0 a changé notre façon de consommer. Donner la possibilité à tous de se prononcer sur la qualité d’un produit ou d’un service via le web est une totale démocratisation des connaissances et une façon de faire vivre ses propres expériences au reste de la planète. Les cas de dénonciations d’un mauvais service ou d’abus de certaines compagnies sont maintenant légion sur les blogues, Facebook, Twitter et Youtube. Les forums consacrés aux critiques de musique, de voyages, de films sont disponibles et fréquentés par des millions de gens chaque jour. Je suis de ceux qui vérifient systématiquement quand vient le temps de me procurer un produit. Pourtant, deux trucs qui me sont arrivés pendant les vacances, m’ont fait réfléchir sur notre nouvelle façon de nous fier aveuglément (?) aux commentaires d’internautes sur des sujets nous concernant. Premier exemple : lors de ma planification de voyage à Barcelone (voir les billets traitant de), j’ai réservé via le site FeelBarcelona, un appartement dans Born, en plein coeur de la ville. La communication avec la compagnie était rapide, cordiale et efficace. À peu près aux mêmes dates, une cliente planifiait des vacances et passait aussi par la capitale catalane. En discutant, on se rendit compte que nous avions opté pour la même agence de location d’appartements. Lors de son retour, elle me fît part de son désappointement vis-à-vis l’appartement (sale et sombre), le propriétaire (absent) et l’agence (difficile à rejoindre). J’étais un peu ébranlé. Mais le dépôt étant déjà transmis et comme j’étais à une semaine de partir, il ne me restait qu’à espérer que son cas était isolé et que tout se passerait mieux pour moi. Effectivement, l’appartement était parfait, tel que décrit et encore plus propre que je ne l’espérais. Le représentant de l’agence était sympathique et le propriétaire, présent lors de la prise en charge. À mon retour, l’agence me demanda de compléter un mini-sondage sur mon séjour, ce que je fis de manière extrêmement positive. Quelques jours passèrent avant que l’agence me recontacte pour me demander de bien vouloir écrire quelques commentaires positifs sur des sites de références de voyages comme TripAdvisor, histoire de convaincre les futurs clients comment ils étaient gentils et bien attentionnés. Ce que je ne fis pas. Je n’avais pas le temps. Ça m’embêtait. J’étais dans le jus. Finalement, toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas le faire. Ma cliente, elle, au contraire, ne dérageait toujours pas du désagréable service auquel elle avait eu droit. Elle prit donc toutes les dispositions pour écrire, dans le plus grand nombre de forums, son histoire d’horreur. Normal. Quand on est victime d’un mauvais traitement, le réflexe numéro 1 est de s’en plaindre. Au plus grand nombre de personnes. Le monde entier si c’est possible. Et c’est possible, maintenant, grâce à internet. Nos deux histoires étaient totalement opposées. Sauf que vous ne connaissiez pas la mienne. Vous n’aviez qu’une seule version et elle était à faire dresser les cheveux sur la tête. Vous me direz que c’est un réflexe normal de se plaindre d’un mauvais service et de rarement remercier pour un bon, prenant pour acquis que ce soit normal qu’il le soit. Sauf qu’en web 2.0, le contre-poids d’une mauvaise critique se fait plus difficilement. Pour 100 personnes insatisfaites connues, combien de milliers de satisfaits silencieux? Ce qui me fait atterrir (comme on parle de voyage (!)) à mon exemple numéro 2. Lors de mon dernier passage à Puerto Morelos, comme j’étais parti avec toute ma famille (10!) et qu’il me fallait un véhicule de location assez spacieux pour nous déplacer, j’avais opté pour un Van Express. J’avais fouiné sur Kayak pour trouver le meilleur prix et j’étais tombé sur un site (America Car Rental) qui me garantissait un prix intéressant. Je réservai. Deux semaines avant de partir, je surfais sur TripAdvisor et me rendis compte que cette compagnie de location avait un long pedigree de mauvais commentaires : automobile non disponible, absence à l’aéroport et même clonage de carte de crédit (!). Je capotais un peu. J’étais responsable de 10 personnes. Je me suis mis à la cherche d’une alternative et optai pour une agence beaucoup plus connue (Ace Rent-A-Car) avec un site internet permettant de communiquer en direct (via chat) avec un agent, pour, bien sûr, 35% de plus que mon ancienne agence. Qu’à cela ne tienne, la prudence l’emporta sur le deal. J’annulai ma première réservation et confirmai la deuxième. Je reçus un courriel du service à la clientèle d’America Car Rental me demandant de bien vouloir leur donner les raisons de mon annulation dans le but d’améliorer leur service dans le futur. Ce que je fis par politesse. Et ce, très honnêtement, en leur divulguant les trucs appris sur leur compagnie, allant même jusqu’à signaler le cas de clonage de carte de crédit. Le responsable me répondit tout de go via internet, me disant qu’il était désolé que j’eue pris ma décision en me fiant à des commentaires non vérifiés et rajouta que la compagnie existait depuis 15 ans et quelle était présente partout en Amérique-du-Sud, bla bla bla. Bref, j’eus droit à la défensive totale. Le gros kit. Assez pour être ébranlé. Car je ne pouvais que lui donner raison sur certains points. Je m’étais fié aux 5 commentaires négatifs dont je n’avais aucune idée de la provenance, ni de la véracité, oubliant les on ne sait combien commentaires positifs, mais silencieux (comme les miens dans le cas #1)… Cheap. C’est à peu près comme ça que je me sentais. Deux histoires, deux conclusions très différentes. Qui disait vrai? Pourquoi avoir réagi de manière aussi contradictoire dans les deux cas? Je n’en sais trop rien. Le problème réside peut-être dans l’anonymat difficilement vérifiable des interventions. Pouvoir dire n’importe quoi sur n’importe qui, c’est aussi ça, le web 2.0. Et cela est bien dommage. Mais ce qui l’est encore plus, c’est d’y croire systématiquement, même si c’est faux. Mais, l’est-ce vraiment?
Je suis de ceux, et nous sommes nombreux, qui pensent que le web 2.0 a changé notre façon de consommer. Donner la possibilité à tous de se prononcer sur la qualité d’un produit ou d’un service via le web est une totale démocratisation des connaissances et une façon de faire vivre ses propres expériences au reste de la planète. Les cas de dénonciations d’un mauvais service ou d’abus de certaines compagnies sont maintenant légion sur les blogues, Facebook, Twitter et Youtube. Les forums consacrés aux critiques de musique, de voyages, de films sont disponibles et fréquentés par des millions de gens chaque jour. Je suis de ceux qui vérifient systématiquement quand vient le temps de me procurer un produit. Pourtant, deux trucs qui me sont arrivés pendant les vacances, m’ont fait réfléchir sur notre nouvelle façon de nous fier aveuglément (?) aux commentaires d’internautes sur des sujets nous concernant. Premier exemple : lors de ma planification de voyage à Barcelone (voir les billets traitant de), j’ai réservé via le site FeelBarcelona, un appartement dans Born, en plein coeur de la ville. La communication avec la compagnie était rapide, cordiale et efficace. À peu près aux mêmes dates, une cliente planifiait des vacances et passait aussi par la capitale catalane. En discutant, on se rendit compte que nous avions opté pour la même agence de location d’appartements. Lors de son retour, elle me fît part de son désappointement vis-à-vis l’appartement (sale et sombre), le propriétaire (absent) et l’agence (difficile à rejoindre). J’étais un peu ébranlé. Mais le dépôt étant déjà transmis et comme j’étais à une semaine de partir, il ne me restait qu’à espérer que son cas était isolé et que tout se passerait mieux pour moi. Effectivement, l’appartement était parfait, tel que décrit et encore plus propre que je ne l’espérais. Le représentant de l’agence était sympathique et le propriétaire, présent lors de la prise en charge. À mon retour, l’agence me demanda de compléter un mini-sondage sur mon séjour, ce que je fis de manière extrêmement positive. Quelques jours passèrent avant que l’agence me recontacte pour me demander de bien vouloir écrire quelques commentaires positifs sur des sites de références de voyages comme TripAdvisor, histoire de convaincre les futurs clients comment ils étaient gentils et bien attentionnés. Ce que je ne fis pas. Je n’avais pas le temps. Ça m’embêtait. J’étais dans le jus. Finalement, toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas le faire. Ma cliente, elle, au contraire, ne dérageait toujours pas du désagréable service auquel elle avait eu droit. Elle prit donc toutes les dispositions pour écrire, dans le plus grand nombre de forums, son histoire d’horreur. Normal. Quand on est victime d’un mauvais traitement, le réflexe numéro 1 est de s’en plaindre. Au plus grand nombre de personnes. Le monde entier si c’est possible. Et c’est possible, maintenant, grâce à internet. Nos deux histoires étaient totalement opposées. Sauf que vous ne connaissiez pas la mienne. Vous n’aviez qu’une seule version et elle était à faire dresser les cheveux sur la tête. Vous me direz que c’est un réflexe normal de se plaindre d’un mauvais service et de rarement remercier pour un bon, prenant pour acquis que ce soit normal qu’il le soit. Sauf qu’en web 2.0, le contre-poids d’une mauvaise critique se fait plus difficilement. Pour 100 personnes insatisfaites connues, combien de milliers de satisfaits silencieux? Ce qui me fait atterrir (comme on parle de voyage (!)) à mon exemple numéro 2. Lors de mon dernier passage à Puerto Morelos, comme j’étais parti avec toute ma famille (10!) et qu’il me fallait un véhicule de location assez spacieux pour nous déplacer, j’avais opté pour un Van Express. J’avais fouiné sur Kayak pour trouver le meilleur prix et j’étais tombé sur un site (America Car Rental) qui me garantissait un prix intéressant. Je réservai. Deux semaines avant de partir, je surfais sur TripAdvisor et me rendis compte que cette compagnie de location avait un long pedigree de mauvais commentaires : automobile non disponible, absence à l’aéroport et même clonage de carte de crédit (!). Je capotais un peu. J’étais responsable de 10 personnes. Je me suis mis à la cherche d’une alternative et optai pour une agence beaucoup plus connue (Ace Rent-A-Car) avec un site internet permettant de communiquer en direct (via chat) avec un agent, pour, bien sûr, 35% de plus que mon ancienne agence. Qu’à cela ne tienne, la prudence l’emporta sur le deal. J’annulai ma première réservation et confirmai la deuxième. Je reçus un courriel du service à la clientèle d’America Car Rental me demandant de bien vouloir leur donner les raisons de mon annulation dans le but d’améliorer leur service dans le futur. Ce que je fis par politesse. Et ce, très honnêtement, en leur divulguant les trucs appris sur leur compagnie, allant même jusqu’à signaler le cas de clonage de carte de crédit. Le responsable me répondit tout de go via internet, me disant qu’il était désolé que j’eue pris ma décision en me fiant à des commentaires non vérifiés et rajouta que la compagnie existait depuis 15 ans et quelle était présente partout en Amérique-du-Sud, bla bla bla. Bref, j’eus droit à la défensive totale. Le gros kit. Assez pour être ébranlé. Car je ne pouvais que lui donner raison sur certains points. Je m’étais fié aux 5 commentaires négatifs dont je n’avais aucune idée de la provenance, ni de la véracité, oubliant les on ne sait combien commentaires positifs, mais silencieux (comme les miens dans le cas #1)… Cheap. C’est à peu près comme ça que je me sentais. Deux histoires, deux conclusions très différentes. Qui disait vrai? Pourquoi avoir réagi de manière aussi contradictoire dans les deux cas? Je n’en sais trop rien. Le problème réside peut-être dans l’anonymat difficilement vérifiable des interventions. Pouvoir dire n’importe quoi sur n’importe qui, c’est aussi ça, le web 2.0. Et cela est bien dommage. Mais ce qui l’est encore plus, c’est d’y croire systématiquement, même si c’est faux. Mais, l’est-ce vraiment?