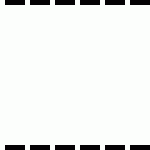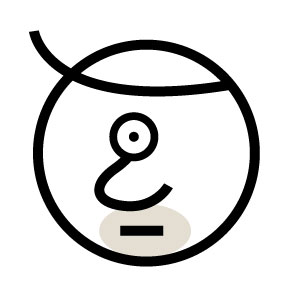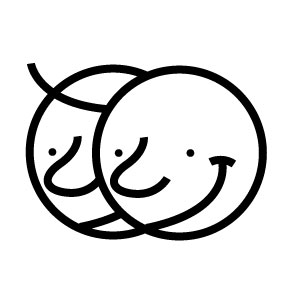Parle, parle, jase, jase.
 Discussion intéressante avec un client/ami lors d’un diner improvisé la semaine passée. On échangeait sur les gens qui parlent, mais qui n’agissent jamais. Ces sempiternels rabats-joies qui tirent sur tout ce qui bouge sans apporter une simple petite solution. Ces critiques acerbes qui ont de belles paroles pour décrier toutes les situations, mais en ont rarement pour apporter des réponses ou solutions concrètes à des problèmes. Comme s’ils étaient éternellement dans l’opposition. Des gérants d’estrade. Des sportifs de salon.
Discussion intéressante avec un client/ami lors d’un diner improvisé la semaine passée. On échangeait sur les gens qui parlent, mais qui n’agissent jamais. Ces sempiternels rabats-joies qui tirent sur tout ce qui bouge sans apporter une simple petite solution. Ces critiques acerbes qui ont de belles paroles pour décrier toutes les situations, mais en ont rarement pour apporter des réponses ou solutions concrètes à des problèmes. Comme s’ils étaient éternellement dans l’opposition. Des gérants d’estrade. Des sportifs de salon.
Ces gens-là me dépriment. Bla-bla contre ci, bla-bla contre ça. Jamais content. Toujours à comparer. Non pas que je sois contre toute critique, au contraire (ce blogue en est la preuve…), mais j’ai plus de respect pour les gens qui démontrent leurs convictions par des actions précises que par des bla-bla faciles et non concluants. Faut que les bottines suivent les babines. Faut que les actions suivent les pensées, sinon ça demeure du vent. De l’air.
Critiquer des situations sans tenter d’y opposer des alternatives ou des solutions est à la portée de tout un chacun. Proposer des changements et assumer ses prises de position demandent un peu plus de courage. J’ai beaucoup d’admiration pour les gens qui s’assument, même si je ne partage pas leur combat ou opinion. Argumenter. Définir sa pensée. Accompagné son « je n’aime pas » d’ingrédients plus précis et de finir par changer la recette.
J’aime beaucoup discuter avec ces entrepreneurs. Ces gars ou ces femmes-là qui mettent leurs tripes dans ce qu’ils créent. Ils vont toujours de l’avant. Ne vivent jamais dans le passé. Ils auraient souvent mille et une raison de se plaindre : contexte économique, compétition, lois trop sévères, etc., mais ils préfèrent garder leur salive pour se cracher dans les mains et travailler. Pour faire avancer leur entreprise. Et ceux qui préfèrent parler se font dépasser par ceux qui agissent.
Les réseaux sociaux ont permis une démocratisation de la liberté d’expression. Tout le monde a maintenant son porte-voix, son public et surtout des opinions sur tous les sujets. Les prises de position sur l’actualité sont dorénavant mises de l’avant à grand coup de changement de statut sur Facebook. On s’affirme à raison de 140 caractères sur Twitter. On écrit plus, certes, mais on réfléchit moins. On se laisse dicter notre pensée. Par ceux qui crient plus fort, par ceux qui tranchent le plus. On embarque dans un débat sans connaître toutes les facettes du sujet. Avec des idées préconçues. Avec nos valeurs. En jugeant toujours le sujet par rapport à soi. La fameuse saveur du moi.
Comment peut-on avoir une opinion sur tout? Et surtout, pourquoi avoir une opinion sur tout? Quand tu as plus d’opinions que de connaissances sur un sujet, ça devient inquiétant. Et toutes ces critiques défilant uniquement sur un fil RSS, sans se métamorphoser en prises d’actions précises, ça demeure du bla-bla. Un flot de mots. Un flot de maux.
Billets que vous pourriez aimer
Les pixels n’ont pas d’odeur.
 En fin de journée, j’avais un joli cadeau qui m’attendait au bureau. On venait de me livrer des exemplaires d’une affiche et d’un programme réalisés pour un client. Enveloppés dans du papier kraft, les deux paquets ressemblaient à des cadeaux sous un arbre de Noël. J’ai lentement déballé un à un ceux-ci en prenant mon temps, comme si je me faisais languir. Aussitôt le premier morceau de ruban gommé détaché, une odeur d’encre s’évadait par l’embouchure.
En fin de journée, j’avais un joli cadeau qui m’attendait au bureau. On venait de me livrer des exemplaires d’une affiche et d’un programme réalisés pour un client. Enveloppés dans du papier kraft, les deux paquets ressemblaient à des cadeaux sous un arbre de Noël. J’ai lentement déballé un à un ceux-ci en prenant mon temps, comme si je me faisais languir. Aussitôt le premier morceau de ruban gommé détaché, une odeur d’encre s’évadait par l’embouchure.
Ça sentait bon. Ça sentait l’imprimerie. Désolé pour mes amis programmeurs, mais la mise en ligne d’un site web n’a rien à voir avec la livraison d’une pièce imprimée. Les pixels n’ont pas d’odeur.
Dans mon bureau ça sentait l’imprimerie. Ça sentait le passé. Une bouffée de nostalgie. Des souvenirs se sont réveillés lorsque ces effluves ont disparu dans mes narines.
Léopold
En 1983, lorsque je suis entré pour la première fois à l’Imprimerie Léopold Tremblay, ce ne sont pas l’odeur, ni les presses qui m’avaient impressionné, mais le crucifix qui trônait dans le bureau en préfini du propriétaire des lieux. Léopold qui avait accepté d’engager ce jeunot apprenti de 17 ans que j’étais pendant les vacances d’été, était très religieux. L’Évêché de Chicoutimi et la congrégation des Soeurs du Bon-Conseil faisaient partie de ses clients importants. Ainsi que la chaîne de magasins Continental. Je n’avais aucune expérience, si ce n’est que celle acquise au Cégep au journal étudiant. Un vert au nombril bleu qui allait apprendre à mélanger d’autres couleurs.
J’allais surtout apprendre ce que serait mon métier plus tard.
Sous la supervision de Suzie, la graphiste, j’ai commencé à faire des petites jobs de montage : carte d’affaires, en-tête, factures, tous ces papiers utilitaires qu’on retrouve un peu partout, cette papeterie noble qu’on imprimait sur du papier NCR, ce papier révolutionnaire qui remplaçait le carbone permettant de faire des copies sans se tacher. Blanche au client, rose au livreur et jaune pour le commerçant.
J’étais tellement impressionné par la dextérité de Suzie. Sa propreté, cette ligne franche qu’elle traçait au Rapido Steadler à l’aide de sa règle parallèle. Sa facilité à glisser les galées de typo dans la cireuse chaude, à les déposer sur le carton en vérifiant que tout était droit. Ça l’était toujours tout de suite, elle devait replacer que très rarement ses colonnes de textes. Ses montages étaient des oeuvres d’art. Propres, précis, droits. Les miens, à côté, étaient des épouvantables collages malpropres. N’étant pas manuel, mes montages à force d’être repositionnés et repositionnés, laissaient des traces noires sur le carton, mes lignes laissaient des barbeaux immenses que je devais par la suite gratter à l’X-Acto causant des trous, des cicatrices dans mes montages. J’étais un mauvais apprenti. J’exaspérais Suzie. Je n’avais pas son adresse ni son expérience. Mais j’aimais ça. J’aimais ce métier d’artisan. J’aimais ces petits gestes que je devais poser. De prendre un carton couché, d’y tracer des lignes-guides bleues que la caméra serait incapable de reproduire, d’y poser par la suite les filets définitifs à l’encre noire; de créer des coins ronds au tire-ligne, de mesurer les éléments graphiques, comme un logo d’entreprise, que je déposerais par la suite sur mon montage après l’avoir réduit à la caméra dans la chambre noire.
J’aimais les odeurs. Ces odeurs. Celle âcre et vinaigrée des produits chimiques des PMT. Celle de l’encre; dense lorsque dans son pot de métal d’origine, presque poivrée quand elle venait s’écraser sur le papier et parfumée quand on enveloppait la publication terminée dans des paquets de papier kraft. Comme l’odeur de cet après-midi. J’aimais aussi l’odeur du papier. À l’arrière de l’imprimerie où étaient disposées les piles de grandes feuilles; glacées, texturées, de couleurs, l’humidité de l’endroit tranchait avec l’aridité des paquets éventrés d’où émergeaient des restants de feuilles dont on faisait des calepins pour les clients. L’odeur de la colle blanche qui servait à relier les volumes : Léopold Tremblay imprimait aussi des livres, ce qui était quand même rare pour une si petite imprimerie. Ruth, une collègue s’occupait de la reliure; à cette époque, les factures numérotées étaient assemblées à la main. Quand mes tâches étaient terminées ou que Suzie en avait assez de me voir détruire mes maquettes, j’allais rejoindre Ruth pour la suivre comme un petit chien, ramassant une à une les feuilles pour les assembler. Une job difficile. Pas complexe, non, mais tellement répétitive et abrutissante. Que faisait Ruth sans se plaindre. Ou madame Léopold qui venait lui donner un coup de main. Y avait aussi l’odeur des machines. Des presses. De la cigarette de Guy, le pressier principal. Cigarette au bec, il changeait les plaques d’impression sans la déposer. Guy et ses blagues cochonnes.
J’aimais aussi le bruit. Celles des presses omniprésentes, cacophoniques, souvent en canon. Celui de la radio de Guy. Transistor au fil pendant près des presses. Le son du téléphone amplifié par un haut-parleur pour l’entendre jusque dans l’entrepôt de papier.
J’ai passé un bel été en 1983. À apprivoiser ces odeurs et cette nouvelle vie qui s’offrait à moi. Ces odeurs que j’aime encore. Autant que ce métier.
Billets que vous pourriez aimer
Je suis de retour.
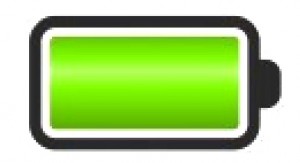 Ça serait mentir de vous dire que je suis heureux d’être de retour au travail. Ça serait aussi trop exagéré de dire que j’en suis malheureux. Trop facile. Ça serait comme nier l’évidence. Discuter d’un sujet stérile. Argumenter sur une fin inévitable. Comme vouloir croire que l’on ne vieillit pas. Qu’on ne mourra jamais. Impossible. Donc, comme tout le reste, les vacances ne sont pas éternelles. Les voyages, encore moins. Il faut le voir philosophiquement et se dire que l’on prépare le prochain…
Ça serait mentir de vous dire que je suis heureux d’être de retour au travail. Ça serait aussi trop exagéré de dire que j’en suis malheureux. Trop facile. Ça serait comme nier l’évidence. Discuter d’un sujet stérile. Argumenter sur une fin inévitable. Comme vouloir croire que l’on ne vieillit pas. Qu’on ne mourra jamais. Impossible. Donc, comme tout le reste, les vacances ne sont pas éternelles. Les voyages, encore moins. Il faut le voir philosophiquement et se dire que l’on prépare le prochain…
Je suis donc de retour sur les rails. I’Am Back. Comme Jack Nicholson dans The Shinning. Je suis de retour.
Je suis de retour chargé à bloc. Je suis le lapin d’Energizer. Ma pile est full.
Je suis parti les poches sous les yeux, je reviens avec moins de sous en poche. Joke.
10 trucs confirmés depuis ce dernier voyage
1. J’aime l’Europe
2. J’aime manger
3. J’aime lire
4. J’aime les gens différents
5. J’aime mettre mon cerveau à off
Donc, je suis de retour full motivé. Prêt à faire feu. Attachez vos tuques.
Une déception : mon bureau est resté dans le même état que je l’ai laissé. Unique preuve que je l’ai quitté à la sauvette. On sera dû pour de changement ici. Mon environnement doit refléter ce qui se passe à l’intérieur.
J’ai le goût de bouger. Goût de changements. J’élimine la touche « save as » de mon ordi. Que du neuf. Laissez-moi tranquille avec le passé.
Fini la contrainte du 600 mots minimum. Vaut mieux en écrire moins, plus souvent. J’écris ce que je veux, quand je veux. Ce blogue à trop été longtemps délaissé : je reprends du service. Voilà.
C’est ça qui est ça.
– – –
MISE À JOUR
Je devais être encore sur le beat vacances quand j’ai titré «10 trucs confirmés depuis ce dernier voyage » alors que j’en énumérais seulement 5.
Voici les autres:
6. J’aime le soleil
7. J’aime fureter dans des rues étrangères
8. J’aime écrire ce blogue
9. J’aime les gens qui m’entourent
10. J’aime ma vie
Merci Jay pour ton oeil de lynx…
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques helléniques – partie 5
 L’APOCALYPSE SELON ST-MARC
L’APOCALYPSE SELON ST-MARC
Scène 1
L’arrivée au port de Raffina vers 14h30 allait donner le ton à la journée. Bordélique et anarchique, beaucoup de gens dans la confusion tentaient de récupérer leurs bagages et de se frayer un chemin parmi d’autres gens qui eux cherchaient à monter à bord les premiers. Comme si personne n’avaient de billets réservés et que le nombre de passagers serait restreint. Je réussis tant bien que mal à récupéré nos sacs. Le temps est compté. Comme tous les transports en commun sont annulés, la seule façon pour quitter le port demeure le taxi. Pas besoin d’être comptable pour réaliser que plus de 300 passagers pour une vingtaine de taxis, il y aura bousculade et attente.
Plusieurs chauffeurs ont des affiches avec des noms écrits dessus. J’ai été con de ne pas y penser, j’aurais pu réserver moi aussi un transfert et ainsi m’assurer de pouvoir quitter rapidement. Un chauffeur avec le nom » Wins » (c’est un signe!) écrit sur son affichette m’aborde en me demandant où je vais. Quand je lui ai dit au coeur d’Athènes, son affiche a pris le bord et il a décidé de me rebaptiser. En route!
Scène 2
Sur la route, on échange sur nos modes de vies, mais surtout sur le conflit qui se joue en face du parlement. Il m’annonce tout de go qu’il sera très difficile de se rendre près de le place Syntagma : coeur de la manifestation et emplacement de mon hotêl, mais qu’il fera le nécessaire pour s’y approcher.
Scène 3
Quand on a entré dans Athènes, la vie semblait rouler comme à l’habitude. On était encore loin du noyau ou des pépins… Les embouteillages ont commencé à être de plus en plus fréquents, mais notre chauffeur est un rusé, plus de vingts ans à sillonner les rues de la capitale. Prenant des petites rues moins congestionnées, il réussit à contourner les premiers barrages policiers que nous apercevons. Il nous répète que ça sera pas facile. On le croit, on est comme dans un manège, tourne, retourne, recule, prend une ruelle, une autre, coupe une voiture, un scooter, un cycliste, tout en grommelant des mots grecs qui ressemblent à des jurons. Autour, des poubelles ont été vidé sur le sol, certaines brûlent encore. Nous arrivons dans un cul-de-sac, un barrage policier nous ordonne de passer et de tourner à droite. Notre chauffeur acquiesce sans remarquer la barrière en métal à sa droite qui jonche le sol. Un son strident de métal se fait entendre, mais qu’importe, nous continuons de rouler. Quelques 500m plus loin, on s’arrête pour constater les dégâts : la Mercedes jaune vif a une cicatrice de 48 pouces sur le pare-chocs avant. Les jurons sont plus fort. Commence à s’ennuyer des Wins notre chauffeur et nous annonce qu’il ne pourra pas avancer plus loin. Nous sommes, selon lui à 500m de notre hôtel…
Scène 4
Munis d’une carte et de nos valises, nous avançons dans les rues. Tentant d’éviter les détritus, demandant notre route à certains policiers qui surveillent les barrages, demandant surtout si la place est sécuritaire.
Au loin, on attends des pétarade de gaz lacrymogènes lancés par les forces de l’ordre aux manifestants, les sirènes font du vacarme aussi. Nous avançons toujours. Et puis, voilà le silence. Nous marchons au coeur d’Athènes, tout prêt du conflit et il nous semble que nous sommes seuls. Les rues désertes. Jusqu’à une nouvelles slave de bombardements ou la vue d’un autre barrage.
À trop vouloir contourner le Place Syntagma, nous nous sommes perdus. Notre carte ne contient pas ces petites ruelles qui changent de nom aux intersections. Nous demandons à un couple de nous aider à trouver notre chemin. La fille porte un masque de plastreur, a les sourcils blancs et son chum nous demande si on est vraiment obligés d’aller la-bas. Ce sont des manifestants qui ont pris part à cette grève générale. En nous expliquant le chemin à prendre, il nous souhaites bonne chance en nous donnant des mouchoirs pour couvrir nos bouches en nous ordonnant de ne pas enlever nos verres fumés. Yen aura pas de facile.
Scène 5
Alors qu’on est encore perdus, ma blonde aperçoit une agence de voyage où l’on pourrait se renseigner. Le proprio me dit ne pas me rendre sur place si je n’ai pas payé encore ma chambre. Je lui mens en me disant que je m’organiserai bien avec Visa à mon retour. Sous ses conseils, nous réservons un hôtel plus loin du conflit. Toute cette route faite avec nos bagages aura été vaine. Nous devrons prendre le métro pour se rendre à notre nouveau logis.
Scène 6
Dans le métro, on sent les gaz. On sent la frénésie. Les gens rencontrés ont tous des marques blanches sur leurs vêtements, certains le visage au complet. Résultat des gaz. Des jeunes avec des drapeaux et des porte-voix et des masques pour se protéger. Des moins jeunes, avec des complets cravates. Des plus vieux. Des femmes et des hommes. Il serait malhonnête, comme le font les médias, de dire qu’uniquement des jeunes ont manifesté en avant du Parlement. Des gens ordinaires à bout de nerfs. Autour de nous, des gens pacifiques aux visages quelques fois tuméfiés, mais toujours fiers semblent consternés par ce qui vient d’arriver. À la sortie du métro, des autobus organisés attendent les manifestants : on est venu des quatre coins de la Grèce pour manifester son désaccord sur ces coupures sévères et surtout cette loi que s’apprête à entériner le gouvernement, cette loi qui rendra l’austérité encore plus sévère.
Scène 7
On a mangé une pizza en carton dans une chambre dégeu. Après avoir réussi à passer toute cette aventure sans incident, il était plus logique de rester ici. Dans cet hôtel sans wifi…
Scène 8
En prenant un café, sur une terrasse ou je squate le wifi, je vois ces vieux qui jasent, argumentant sur la journée d’hier. La paix semble revenue. Le quotidien se déploie. Faudra voir…
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques helléniques – partie 4
 De grève en grève
De grève en grève
Après avoir foulé la grève dorée de Mykonos, l’inexistante de Santorini et la poudreuse de Paros, voilà que demain nous foulerons celle d’Athènes. Une autre genre de grève j’en conviens. Pas de sable fin, ni d’eau salée, mais une avec une peu plus de vagues je pense. Voilà que la Grèce toute entière est mise sous arrêt. Une grève générale perturbe le pays mettant en tutelle tous transports en commun et services publics. Le traversier qui devait nous mener de Paros au port de Pirée est paralysé par celle-ci. Nous avons dû trouver un plan B : passer par un autre port, çelui de Raffina, à quelques 30km de la capitale. On verra comment se rendre par la suite à notre hôtel… en plein coeur du centre-ville d’Athènes. Les voyages forment la jeunesse. On verra demain si on a encore la fibre adolescente de l’aventure…
On est au ralenti… comme le pays.
Si nous avons atteint le neutre et que la vie se passe tout doucement pour nous, il y va différemment pour les Grecs. On sent bien que les touristes ont boudé cette destination cette année : terrasses plutôt vides, rues moins achalandées, mêmes les îles voient leur économie ralentir. Cette artiste de qui nous avons acheté des bijoux, cassant le français, heureuse de nous dire qu’elle connaissait des canadiens en Ontario qui nous confessait qu’il y avait si peu de touristes cette année à ces serveurs qui en mettent un peu plus qu’à l’habitude, il faut être aveugle pour ne pas sentir que les choses ne tournent pas rond ici. Austérité, peut-être, mais malveillance, jamais. Avant notre départ, plusieurs personnes s’inquiétaient ou tentaient de nous faire peur sur les possibilités que notre séjour soit perturbé d’une façon ou d’une autre, mais jusqu’à maintenant les grecs rencontrés nous ont parus très sympas. Un peu bourrus, comme le sont les méditerranéens, mais gentils, drôles… et fumeurs! Diable que nous n’étions plus habitués a être boucanés de la sorte. Sur les terrasses, dans les restos, plages, etc, toujours cette fumée secondaire qui nous agresse. L’ancien fumeur en moi a su distinguer certaines marques, mais pas d’envie d’y regoûter.
Assis à un café, en attente du bateau, j’écris ces quelques lignes à la sauvette afin de replonger dans mon roman au plus vite. Je tenterai de prendre quelques clichés des manifestations à Athènes…
Billets que vous pourriez aimer
Chroniques helléniques – partie 3
 En relisant mon dernier billet, j’ai ressenti un certain malaise. De ceux qu’on a quand on se rend compte que ce qu’on a écrit en 600 mots auraient pu se résumer en 25 derrière une carte postale. Des balivernes. Des mots qu’on aligne un après l’autre pour rassurer les proches, des mots clichés sans saveur. Il fait beau, on pense à vous. Mon dernier billet avait le sex-appeal d’un Guide Michelin et goutait l’agenda. Voilà, c’est terminé. N’en parlons plus. Parlons désormais des vrais affaires:il faut beau, on pense à vous.
En relisant mon dernier billet, j’ai ressenti un certain malaise. De ceux qu’on a quand on se rend compte que ce qu’on a écrit en 600 mots auraient pu se résumer en 25 derrière une carte postale. Des balivernes. Des mots qu’on aligne un après l’autre pour rassurer les proches, des mots clichés sans saveur. Il fait beau, on pense à vous. Mon dernier billet avait le sex-appeal d’un Guide Michelin et goutait l’agenda. Voilà, c’est terminé. N’en parlons plus. Parlons désormais des vrais affaires:il faut beau, on pense à vous.
Miam.
Quand je reviens de voyage, il ne faut pas me demander ce que j’ai vu ou fait, il faut m’interroger sur ce que j’ai mangé. À Athènes, un resto trouvé grâce à mes recherches sur internet, Kuzina, a réussi a bouleverser mes papilles. Le restaurant réinvente la cuisine grecque, puisant dans sa riche histoire des recettes oubliées ou de nouvelles interprétations de classiques, et ce, toujours avec un souci d’utiliser des aliments frais de provenance. C’est ici que j’ai goûté pour la première fois à la bottarga, une pâte créée à partir d’oeufs de poisson, salés et séchés que l’on tranche en fines lamelles et réveille d’un filet d’huile d’olive sur un petit pain. Délicieux, ça m’a rappelé un peu l’anchois et la sardine. Je tenterai d’en apporter innocemment dans mes valises.
À Mikonos, en soupant à la Taverna Matthew, j’ai eu la chance d’échanger quelques mots avec une gentille dame d’une table voisine. Grecque émigrée aux States, elle venait passer quelques mois dans sa maison à Ano Mera. Elle a eu la gentillesse après un toast d’ouzo, de m’orienter sur le menu. Les anchois marinés étaient fabuleux! Je pesterai encore pendant plusieurs mois contre ceux que j’achète, même chez Milano à Montréal, en pensant à ce goût sans saumure si savoureux. Je vivrai le même backslach qu’à mon retour de Barcelone. Misère.
De Santorini, je ramènerai des feuilles de câpres. J’aurais bien ramené des tomates, mais je doute que Douanes Canada approuve. Il faut savoir que le volcan n’a pas que laissé un paysage à couper le souffle à cette île grecque, son sol ravagé par la lave a vu son ADN se modifier. Sa terre devenue très fertile a développé des saveurs que l’on ne retrouve nulle part ailleurs; aubergine blanche, tomate miniature a peau croquante, fava, etc. Même chose pour les fromages; depuis mon arrivée j’ai mangé du feta tous les jours, sans jamais avoir eu l’impression de manger le même fromage. J’en bave à en parler.
Des kilomètres de mots.
Y a pas que la bouffe qui me fait vibrer depuis que j’ai posé le cul ici. Ça n’a rien à voir avec le pays, mais avec mon état d’esprit. J’ai repris le goût à la lecture. Pas que je l’avais perdu, mais je ne lisais que des trucs reliés au travail, des magazines, etc. Je m’apprête à entamer les romans de ma blonde, je suis venu à bout des miens. Des milliers de pages englouties voracement, je m’en voudrais de passer sous silence Middlesex . Ce roman racontant l’histoire d’un hermaphrodite et plus largement l’histoire d’une famille : des immigrés grecs arrivés aux États-Unis en 1922 après avoir fui leur ville natal envahi par les Turcs. Des terres d’Asie Mineure aux quartiers de Detroit, Jeffrey Eugenides, celui à qui l’on doit Virgin Suicides – mis en film par Sophia Coppola, dresse un portrait de l’Amérique des années 20 aux années 70. Un livre difficile, mais terriblement beau. Trouvaille qui allait parfaitement avec ma destination. Il parait que le goût d’écrire vient avec celui de lire. Ça me donnera le coup de pied au cul pour cesser de négliger ce blogue.
Sinon, en 25 mots : il fait beau, le paysage est époustouflant (marcher la dizaine de kilomètres à flancs de montagne, reliant Fira à Oia, pour y voir mourir le soleil dans la mer Égée fût génial) et on a hâte de vous revoir (pfff, quel menteur!).
Billets que vous pourriez aimer
Le pourboire.
 Je vous parle souvent des relations privilégiées que j’aime développer avec mes clients. Au-delà du service à accomplir, il me semble que faire des affaires aujourd’hui c’est plus qu’uniquement réaliser un mandat. Il y a tout ce qui gravite autour. Les rencontres de travail et les prises de mandat sont tout autant des opportunités pour mieux connaître son client, de voir la personne derrière le titre, de voir plus loin que la relation bête client-fournisseur. Oui, bien sûr toutes notions de professionnalisme doivent être respectées, mais celle de sentir qu’une relation de confiance mutuelle s’installe entre le client et le consultant est encore plus gratifiante.
Je vous parle souvent des relations privilégiées que j’aime développer avec mes clients. Au-delà du service à accomplir, il me semble que faire des affaires aujourd’hui c’est plus qu’uniquement réaliser un mandat. Il y a tout ce qui gravite autour. Les rencontres de travail et les prises de mandat sont tout autant des opportunités pour mieux connaître son client, de voir la personne derrière le titre, de voir plus loin que la relation bête client-fournisseur. Oui, bien sûr toutes notions de professionnalisme doivent être respectées, mais celle de sentir qu’une relation de confiance mutuelle s’installe entre le client et le consultant est encore plus gratifiante.
Il y a quelques semaines de ça, j’ai reçu un courriel vers 22 h. Ça venait d’un client qui travaille dans le « public » (j’écris l’heure et le type de client, surtout pour faire réagir les personnes qui pensent qu’il y a uniquement dans le privé que l’on travaille le soir…). Long courriel donc, pour me remercier du travail accompli dans le cadre d’un mandat. J’avoue avoir été surpris, mais surtout flatté. Recevoir ce type de message quand tu ne t’y attends pas, c’est le gros pourboire que tu laisses au resto après une belle soirée quand le service passe d’anodin à expérience jouissive. C’est la tape dans le dos qui fait du bien. C’est la récompense des efforts déployés. Que ce client prenne la peine le soir, hors de son temps de bureau, pour m’écrire ce courriel venait ajouter un bonus à mes honoraires. Oui, chaque travail mérite salaire, mais un remerciement de la sorte, ça n’a pas de prix.
Depuis que je travaille seul, il m’est arrivé à plusieurs reprises de recevoir ce type d’encouragements. Je le dis sans vanité. Pas plus tard qu’hier, sur mon babillard de Facebook, un client me disait combien il aimait le travail que je venais de réaliser pour son organisation. L’autre matin, au téléphone, un autre m’appelait uniquement (!!!) pour me dire qu’il aimait travailler avec moi, sans pour autant demander quoi que ce soit. Des courriels me souhaitant bonnes vacances. D’autres qui disent bravo. Des maudits beaux pourboires.
De mon côté, je tente de plus en plus à le faire aussi. Je dis souvent que je travaille seul, mais c’est faux : les photographes, imprimeurs, programmeurs qui forment mon équipe ont souvent droit, eux aussi, à leur part justifiée du pourboire. Comme au resto, si le service a été rondement, c’est que dans la cuisine on a pas chômé. Ça serait trop facile de garder le mérite à soi, quand il ne te revient pas au complet. C’est pourquoi c’est important de leur souligner. Même si tu as déjà payé ta facture.
Un merci, un bon mot demeurent la façon la plus efficace de valoriser le travail effectué. Il ne faut pas les garder pour soi et le dire aux personnes concernées. Ce sont des cadeaux-surprises. D’autant plus si vous êtes du type critique, balancer avec des remerciements demeure une belle façon de rendre vos relations d’affaires plus humaines.
Aimer ce que vous faites comme travail est primordial pour un équilibre de vie. Que les autres aiment ce que vous faites pour eux, ça n’a pas de prix.
Billets que vous pourriez aimer
Le gavage.
 Vous recevez une demande d’amitié Facebook d’une entreprise. Bon. Vous savez que ce n’est pas la procédure normale. Qu’une entreprise devrait plutôt se créer une page qu’elle moussera dans son réseau pour la faire connaître afin d’y recruter le plus d’adeptes possibles. Vous déciderez vous-même d’y adhérer et même jusqu’à la partager à vos propres amis si vous pensez que ça leur conviendrait à eux aussi. Mais bon, vous vous dites que l’entreprise qui sollicite votre « amitié » n’est peut-être tout simplement pas au courant et vous faites : bah, ce n’est pas la fin du monde en cliquant « accepter » pour augmenter votre propre réseau.
Vous recevez une demande d’amitié Facebook d’une entreprise. Bon. Vous savez que ce n’est pas la procédure normale. Qu’une entreprise devrait plutôt se créer une page qu’elle moussera dans son réseau pour la faire connaître afin d’y recruter le plus d’adeptes possibles. Vous déciderez vous-même d’y adhérer et même jusqu’à la partager à vos propres amis si vous pensez que ça leur conviendrait à eux aussi. Mais bon, vous vous dites que l’entreprise qui sollicite votre « amitié » n’est peut-être tout simplement pas au courant et vous faites : bah, ce n’est pas la fin du monde en cliquant « accepter » pour augmenter votre propre réseau.
Les jours passent et cette entreprise vous sollicite à un événement. Une activité pour mieux connaître ses services. Un genre porte ouverte. Vous cliquez que « non », vous ne serez pas présent. Ça ne cadre pas dans votre horaire. Et vous n’avez pas vraiment le goût. Vous êtes plutôt fermé aux portes ouvertes… Deux jours après, le même nouvel ami-entreprise vous demande si vous aimeriez essayer un truc qu’il vend. Qu’il serait disponible pour vous en faire une super démonstration! Une autre belle façon de mieux vous connaître. Vous cliquez « non ». Sans plus. Ça n’est pas votre truc tout ça. À vrai dire, ça vous dérange. Le lendemain, cette entreprise vous rappelle sur votre mur Facebook que vous pouvez toujours profiter d’un paquet d’avantages si vous venez acheter chez lui! Vous vous en doutiez. D’ailleurs, l’un de ses avantages est de ne jamais avoir la paix. Vous hésitez entre le désamifier ou simplement l’ignorer. Vous choisissez la deuxième option en espérant que votre silence lui donnera une piste de votre désenchantement. C’est mal connaître la détermination de votre super ami. Les jours se suivent et se ressemblent. D’invitations des plus anodines aux questions les plus stupides en passant par une avalanche de liens encore plus insipides et inintéressants, il continue à vous bombarder de conneries testant vos limites… à leur limite. À bout de patience, vous cliquez sur désamifier et vous voilà enfin soulagé. C’était un bon gars, mais bordel qu’il vous a gonflé avec cette sollicitation extrême et impertinente.
Pour vous relaxer de cette mésaventure, vous commandez en ligne des livres. Vous êtes plutôt pressé, vous omettez de cocher sur les cases qui vous épargnent de recevoir par courriel les nouveautés, coups de coeur et ventes de l’année. Vous vous dites : pourquoi pas? Ça pourrait êre pratique de recevoir toutes ces mirobolantes offres. Et vous cliquez « envoyer » en savourant ce plaisir simple de magasiner en bobettes sur le sofa du salon, pendant qu’il neige en ce début de juin. Le lendemain, vous recevez un courriel de ce commerce en ligne, vous disant qu’au-delà d’un achat de 39 $, la livraison sera gratuite. Cool. Même si vous le saviez déjà. Puisque vous venez justement de commander. La veille. Hier. Il y a à peine 24 h. Pour plus de 39 $. Et que vous n’avez justement pas payé de shipping. Se succèdent les jours suivants : la sélection des livres que vous pourriez aimer, la sélection des livres de la fête des Pères/mères/amoureux/Noël du campeur/ramadan/,etc… Puis suivent les promotions à 10 %/20 %/30 %. Et toujours cette livraison gratuite au-delà d’un achat de 39 $. Vous passez tellement de temps à lire ces courriels que vous n’avez même plus le temps de lire les livres que vous avez commandés. Quand vous décidez que c’est assez. Vous vous connectez à votre compte et vous décochez toutes les cases qui leur permettent de vous emmerder.
Y a cette compagnie de vêtements qui vous embêtent tous les jours qui vous déclinent leur collection un morceau à la fois, ce magazine qui vous offre de vous abonner tout le temps (même si vous l’êtes déjà!!!), ces recettes qui vous arrivent tous les matins… et le sempiternel envoi gratuit à l’achat de 39 $.
D-O-S-E-R. Sachez doser. Cessez de gaver vos clients. Ça leur engraisse la foi qu’ils peuvent avoir en vous. Laissez-les digérer les infos que vous voulez leur transmettre. Trop, c’est comme pas assez. Doser.
Je le sais que vous voulez des clients. On en veut tous. Mais ce n’est pas en les écoeurant à outrance que vous les attirerez. Facebook, les courriels, les infolettres, sont tous des moyens géniaux et à peu de frais de solliciter une clientèle, mais de grâce faites la différence entre partager et agresser. On se faisait une drôle d’image du vendeur d’assurances qui mettait son pied dans la porte pour empêcher le client de la fermer, mais quand vous ne cessez de pousser jour après jour des offres (qui souvent n’en sont même pas) vous vous faites plus de tort que de bien et leur ressemblez.
Savoir doser son information. La rendre intéressante, originale, mais surtout pertinente fera de vous, une entreprise plus respectée. Pas une machine à envoyer des courriels. Bon je vais aller vérifier si l’offre de 39 $ — livraison gratuite — tient toujours….
Billets que vous pourriez aimer
Vendre à tout prix
 Je n’aime pas les vendeurs.
Je n’aime pas les vendeurs.
Les vendeurs de chars, de pub, d’assurances, etc. Nommez-les tous.
Ce n’est rien de personnel. Croyez-moi. Je ne vise personne en particulier, je parle du métier de.
Je n’aime pas la façon qu’ils ont de nous aborder avec leurs phrases apprises par coeur.
Je n’aime tout simplement pas leur vision de trimestre. Leur vision à court terme. Tous ces faux sentiments dictés uniquement par mes futurs achats. Je n’aime pas l’amour qu’ils nous déclarent quand on signe le contrat, le dénigrement que nous subissons quand nous osons refuser. Ces vendeurs capables de faire semblant de nous trouver intéressants. Ces vendeurs prêts à dire n’importe quoi sur n’importe qui pour vendre leur salade. Je ne les aime pas.
Je n’aime pas ces vendeurs aux produits toujours #1. Ces vendeurs qui sont toujours les meilleurs. Et les autres, qui sont tous des pas bons.
Je n’aime pas leurs arguments bidons tirés d’un chapeau. À grand renfort de superlatifs. J’aime pas qu’on me prenne pour plus con que je suis.
Je n’aime pas entendre : ce gars-là, c’est tout un vendeur! Yé capable de vendre un frigo à un esquimau. Ha bon. Ce qui vous impressionne, me désole. Ça me les rend encore plus antipathiques.
Je n’aime pas qu’un vendeur pleure à mes clients que je ne connais pas un tel média, uniquement parce que je viens de lui refuser une offre.
J’aime encore moins ce nouveau titre de conseiller des ventes dont ils se sont affublés depuis quelques années; un malentendant n’est plus un sourd, un non-voyant, un aveugle… eux ne vendent plus, mais conseillent. Des conseillers qui vous conseillent d’acheter… leurs trucs. Uniquement les leurs. Parce que ceux des autres, c’est de la marde.
Je n’aime pas.
J’aime qu’on me respecte. J’aime qu’on respecte mes clients. Surtout si je dis non. Surtout s’ils disent non. Trop facile de nous aimer, sinon.
J’aime qu’on me dise la vérité. Qu’on ne me monte pas un bateau. Qu’un vendeur me donne l’heure juste, même si ça risque de se tourner contre lui.
J’aime les relations durables. Qui se bâtit sur le long terme. Sur des valeurs partagées. Pas sur des prix.
J’aime quand je sens que le vendeur s’intéresse vraiment à ce que je fais dans la vie. On n’est pas obligés d’avoir les mêmes passions. Alors si oui, faut que ça soit vrai.
J’aime qu’un vendeur me dise qu’il ne sait pas un truc, mais qu’il va se renseigner et me revenir avec une réponse au lieu de me dire n’importe quoi.
J’aime quand je peux compter sur un vendeur pour mieux m’aiguiller, même si à court terme c’est moins payant pour lui parce que je lui demande de s’investir.
J’aime qu’il me dise que je suis dans l’erreur, si je le suis. Au lieu de me vendre à tout prix, en me disant que je suis beau et fin.
J’aime qu’un vendeur avoue que le produit d’un concurrent est aussi intéressant que le sien. Qu’il me parle de ses avantages à lui, sans me démontrer uniquement les désavantages des autres.
J’aime quand je sens qu’un vendeur travaille pour moi. Pas pour lui. Même si, dans le fond, à la fin, c’est pour lui.
J’aime entendre : c’est bon je m’en occupe. Et que c’est vrai. Maintenant ou plus tard.
Je connais des vendeurs dans les deux catégories. Ceux que j’aime se reconnaîtront. Les autres continueront de faire semblant… de m’aimer.
Billets que vous pourriez aimer
Hey c’est pas à toi. Ni à moi, d’ailleurs.
 Et si on parlait typographie? Surtout de leur utilisation par les boîtes de graphisme.
Et si on parlait typographie? Surtout de leur utilisation par les boîtes de graphisme.
Il m’est arrivé une anecdote, aujourd’hui qui m’a rappelé un truc dont je voulais parler depuis longtemps sur ce blogue. Une agence amie (oui, oui ça se peut!) m’envoie un courriel pour me demander le nom de la typographie utilisée dans le cadre d’un projet pour un client commun. Comme il devait faire une création pour celui-ci, il voulait continuer dans la même lignée de celle que j’avais élaborée. Puisqu’il ne trouvait pas la typographie choisie dans sa collection, il m’a recontacté en me demandant de lui faire parvenir ladite typo. Ce que j’ai refusé. Pas par méchanceté ou mauvaise compétition, mais parce que je ne pouvais pas lui remettre ce qui ne m’appartenait même pas.
Je vous explique.
Les typographies achetées nous donnent uniquement le droit de les utiliser personnellement; en fait, les polices de caractère sont régies de la même manière que les logiciels : elles ne peuvent être copiées ni échangées. Quand tu réalises un mandat pour un client, c’est un concept que tu lui vends, un concept créé avec une typographie; point à la ligne; tu ne lui vends pas une typographie (puisqu’elle ne t’appartient même pas de toute façon et que tu paies pour l’utiliser). Quand le client veut utiliser ultérieurement la même typographie; deux choix s’offrent à lui : l’acheter lui-même pour ses besoins internes ou demander à son agence de se la procurer. Comme un logiciel. Le client ne peut pas, non plus distribuer sa typo, de la même manière qu’elle ne peut donner un logiciel.
Sur son site, Typographe trace un portrait assez juste de la propriété intellectuelle d’une police :
Les caractères typographiques (la création) relèvent de la propriété intellectuelle et artistique, au même titre que le travail de création d’un designer ou de produits industriels propriétaires. Compte tenu de l’ubiquité et de la facilité de partage des fontes numériques (nommés également “polices de caractères”) entre utilisateurs, les considérations juridiques et morales liées au fait même d’utiliser ces fontes (dans le sens logiciel, support numérique des caractères typographiques) sont souvent négligées.
Définition de la contrefaçon
La contrefaçon est aux droits intellectuels ce que le vol est aux biens matériels. Il s’agit de l’atteinte aux droits exclusifs de l’auteur, tant moraux que patrimoniaux, sur son œuvre et l’usage de celle-ci sans son autorisation (art.L355-2 et 3 CPI).
Nous pouvons énumérer les quatre bonnes pratiques suivantes…
- Si vous utilisez une fonte numérique, que ce soit sur votre ordinateur ou sur celui de quelqu’un d’autre, assurez-vous que vous disposez d’un licence pour utiliser cette fonte ;
- Si vous souhaitez utiliser une fonte numérique qui n’est pas installée sur votre ordinateur, vous devez au préalable vous assurer soit que vous ou votre employeur disposez d’une licence pour installer la fonte ou bien en faire l’acquisition ;
- Si vous avez la moindre question à propos de la licence d’une fonte numérique, n’hésitez pas à contacter la fonderie ou le revendeur de la police (si vous n’avez pas cette information, n’importe quelle fonderie ou n’importe quel revendeur — ou peu s’en faut – peut vous aider à identifier l’origine de la fonte) ;
- Ne prêtez pas, ne donnez pas vos fontes numériques à autrui. Vos amis, clients, collègues de travail doivent faire l’acquisition des droits pour les utiliser. Quand on vient à aborder la question des licences de fontes numériques, l’aspect éthique de leur utilisation fait sens, tant d’un point de vue légal que financier. Violer les termes d’un contrat de licence met en danger le designer, le client et peut hypothéquer l’avenir de leurs relations professionnelles. Une approche éthique de l’utilisation des fontes et du respect des contrats de licence est synonyme à la fois de bonnes pratiques des affaires et, partant, d’affaires bien menées. *
De plus, j’ajouterais que l’acquisition de typographies autres que celles souvent fournies par les suites de logiciels de création comme celle d’Adobe permet à une agence de se différencier de ses concurrents, de produire des productions originales : ça devient son coffre à outil personnel et sa marque de commerce. Dans le passé, avant de connaître les règles régissant la typo, à toutes les fois que je fournissais des polices de caractère à un imprimeur ou une autre agence, je voyais apparaître dans le marché des productions faites à partir de celles-ci. Coïncidence? Permettez-moi d’en douter. Parce qu’il est là aussi le problème : après le mandat en cours réalisé, les typos que j’avais envoyées se retrouveraient dans le coffre à outils d’une autre agence ou d’un imprimeur qui l’utilisait à son tour pour créer. Sans avoir eu à débourser une cenne. En toute illégalité.
Voilà. Vous vous coucherez plus intelligent ce soir. Tout en faisant des ZZZ en Helvetica Bold.
* Source : Typographe